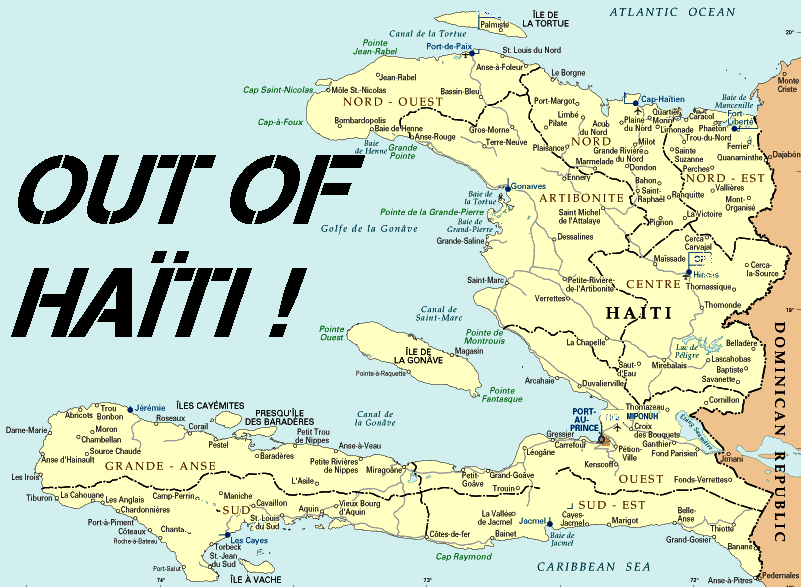02/01/2013
A propos d'un livre consacré à John Cowper Powys

A propos de la publication d'un livre consacré à
John Cowper POWYS
par
Les Perséides
Nous dédions ce petit post sans prétention à Monsieur Manuel de Dieguez, philosophe entre les philosophes, infiniment nécessaire à notre temps de Tohu et Bohu, qui eût excité le plus vif intérêt chez l'ermite de Blaenau Ffestiniog, comme lui jusqu'au bout indéfectible champion des humiliés et des offensés. Quelle chance nous aurons eue d'être les contemporains de ces chênes qu'on n'abat pas !
2 octobre ! C'est le 2 octobre que ce livre a été présenté dans une librairie de la Rive Gauche en présence de ses deux auteurs. Et nous voici le 2 janvier, à venir enfin vous en parler ! Non, l'intendance ne suit pas toujours, quoi qu'en ait dit mongénéral. Cela étant, et même si les bons livres, comme le bon vin, peuvent s'accomoder sans mal de quelques années de cave, mieux vaut en parler avant que l'absence de bruit les ait envoyés au pilon. Retard, donc. Circonstances indépendantes de notre volonté. Notre faute quand même !
Adonc, ce livre, écrit en français, consacré à l'auteur anglais John Cowper Powys, et plus spécifiquement à sa philosophie, venait de sortir aux éditions Les Perséides. Et comme on ne parle jamais trop des « petits » éditeurs en train de sauver l'honneur de l'édition en France, un mot d'abord sur ces dernières, situées au coeur du village de Bécherel, qui est à la Bretagne ce que Redu est à l'Ardenne et Hay-on-Wye au Pays de Galles : un village du livre.
[ http://www.becherel-autour-du-livre.com/categorie-1079014...
http://il-bouge-le-livre.blog.lemonde.fr/2009/04/16/beche...
http://www.redu-villagedulivre.be/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hay-on-Wye ]
En plein accord avec la philosophie du lieu, Les Perséides sont à la fois une maison d'édition et une librairie, qu'animent Thomas van Ruymbeke et Solen Cueff.
5 rue du Faubourg Bertault 35190 Bécherel
Tél. 02 99 66 68 79 - 06 70 44 74 83
Ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures sauf le mardi après-midi.
e-mail : lesperseides@free.fr
Nous ne croyons même pas nous avancer trop en ajoutant qu'on peut aussi y prendre le thé, mais il vous est loisible, chers internautes, de leur rendre, sans attendre le printemps, une petite visité électronique :
http://lesperseides.fr/la-librairie-les-perseides-2/
Pour être brefs, Les Perséides est une maison d’édition de littérature et d'histoire fondée à Rennes en 2004, qui décline sa production en plusieurs collections : La Lune Attique, qui alterne les fictions inédites d'auteurs contemporains, des textes à dominante surréaliste à redécouvrir et des œuvres traduites issues du patrimoine de la littérature mondiale. La collection Aux Sources de l'histoire, qui décrypte les mythes de l'histoire de France à travers des textes clés. Enfin, Le Monde Atlantique, qui s'adresse aux chercheurs et étudiants en histoire atlantique, et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des révolutions ou à celle de l'esclavage et du colonialisme.
Il semble aussi que la maison ait à coeur de mettre, quand elle le peut, le pied à l'étrier aux écrivains de la région, ce qui est tout à son honneur.
Le livre :

Pierrick Hamelin
Goulven Le Brech
John Cowper POWYS`
Une philosophie de la vie
Bécherel, Les Perséides, 2012
21 x 14 cm, 128 pages, 15 €
Les auteurs :
Goulven Le Brech est archiviste et il vit à Gentilly. Spécialiste du philosophe Jules Lequier auquel il a consacré une biographie (La Part Commune, 2007), il est aussi l’auteur d’un récit de pérégrinations en Nouvelle-Calédonie, (Sur le Caillou, Petit Pavé, 2010).
Pierrick Hamelin vit et enseigne en Loire-Atlantique, près de Nantes. Aux Editions Les Perséides, il a déjà publié Point de fuite (2005), Une dernière fois la mer (2007), Promenades philosophiques (2009) et Manège (2010).
Quant à John Cowper Powys, qu'en dire sinon qu'il est d'autant plus cher à notre coeur que nous l'avons, dans une autre vie, traduit et publié nous-mêmes.
*
Nous ne dirons rien de la première partie, « L'expérience de la vie », traitée par Goulven Le Brech, parce que notre ami Edouard Lecèdre nous a envoyé, là-dessus, un compte-rendu si enthousiaste, que nous ne voyons pas ce que nous aurions pu vous en conter de plus intéressant.
Nous avons donc (votre servante a) l'agréable tâche de dire tout le bien qu'il faut penser du travail de M. Pierrick Hamelin, qui a choisi, lui, d'aborder l'espèce d'Himalaya dont il avait à rendre compte en moins de quarante pages sous la forme d'un « Abécédaire ».
Ce parti pris peut paraître étrange à ceux qui ne connaissent pas du tout Powys, mais les powysiens, eux, y reconnaîtront au passage des plages, des pics, des promontoires dont ils sont familiers et admettront que ces « bornes d'histoire littéraire» sont aussi pertinentes qu'elles pouvaient l'être pour présenter l'auteur à ceux qui n'en savent peut-être rien encore. Il fallait bien commencer par quelque part et dieusait que l'entreprise n'était pas facile. Impossible de celer qu'en rédigeant ces lignes, il nous est venu à l'esprit, de façon irrésistible, des mots ou des expressions qui eussent pu être ajoutés au choix fait par M. Hamelin. Ils viendront peut-être, qui sait, étoffer une réédition future. En attendant, que les lecteurs ne boudent pas leur plaisir, celui de la découverte pour les uns, de la reconnaissance parfois amusée pour les autres.
Bibliographie :
Un bémol cependant : l'ouvrage est suivi d'une bibliographie qui serait parfaite si elle était complète, d'autant qu'elle est suivie d'une recension détaillée des moindres articles consacrés à John Cowper Powys par divers sites et revues de langue française. A l'évidence, les auteurs ont consulté, de bonne foi, une source qui pratique l'apartheid. Ce sont des choses qui arrivent.
Bouchons donc les trous et ajoutons aux oeuvres de JCP traduites en français. :
Jugement suspendu sur Oscar Wilde, (avec L'âme de l'homme sous le socialisme d'Oscar Wilde), Verviers, La Thalamège, 1986, (traductions de Suspended judgements : Oscar Wilde et de The Soul of Man under Socialism par Catherine Lieutenant)
Spectres réels, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de Real Wraiths, par Catherine Lieutenant.
Le Hibou, le canard et Miss Rowe ! Miss Rowe !, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de The Owl, the Duck, and Miss Rowe ! Miss Rowe ! par Catherine Lieutenant, la réédition de 2007 par l'Atelier de l'agneau (Saint-Quentin-de-Caplong) reproduisant et modifiant sans autorisation, l'édition originale.
Manque aussi (ostracisme aussi ?) dans la liste des articles consacrés à Powys, un texte de Marc-Edouard Nabe, qui a pourtant paru en son temps dans la Powys Review. Faute de pouvoir le retrouver, signalons, parce qu’elle le mérite, sa préface à l’édition française de Dostoïevski, chez Bartillat :

http://www.alainzannini.com/index.php?option=com_content&...
*
UNE VIE PHILOSOPHIQUE
Edouard Lecèdre
Qui en France aujourd’hui connaît suffisamment bien John Cowper Powys (1872-1963) pour se tenir à l’affût des soubresauts de l’actualité éditoriale le concernant et réagir promptement au moindre écrit dont il serait le sujet ? Car, à ce jour, l’iceberg que représente cet immense auteur garde encore profondément immergée une part importante de son œuvre, qu’il s’agisse par exemple de Atlantis, ou de Porius, deux monuments encore non traduits, ou de rééditions d’ouvrages devenus introuvables (on pense à Une philosophie de la solitude, à La vision complexe…), de ses poèmes, ou encore d’essais sur son œuvre, (il vaudrait mieux ici parler de facettes de son œuvre tellement sa production est vaste et variée).
Apparemment, si l’on en croit les deux auteurs et le petit groupe de spécialistes qui étaient présents à la présentation du livre le 2 octobre dernier à la librairie « L’écume des pages » située près de l’église Saint Germain-des-Prés à Paris, les connaisseurs et les amateurs de l’homme et de l’œuvre seraient plus nombreux qu’on ne le croit, malgré le silence tonitruant dont John Cowper Powys fait l’objet dans la sphère littéraire française. Ils seraient assez nombreux pour permettre à la France de se distinguer parmi les premiers pays où ses livres sont traduits et diffusés….et donc lus. Que penser alors de l’embrasement des esprits des milieux autorisés, comme on dit, si des articles, voire des dossiers Powys étaient publiés dans les suppléments livres des quotidiens nationaux ou dans les magazines spécialisés en littérature, à la place des recensions obligées sur la pitoyable création littéraire française contemporaine !
C’est pourquoi il faut saluer l’événement que constitue la sortie du livre John Cowper Powys – Une philosophie de la vie et remercier les auteurs d’avoir effectué ce salutaire travail de sensibilisation à l’œuvre si dense de Powys, écrit sous forme d’une présentation générale, se voulant simple, rédigée dans le but d’une appropriation aisée et rapide de l’univers powysien par le lecteur néophyte. Une sorte de propédeutique donc, pour comprendre, sinon appréhender l’œuvre complet de cet auteur important. Et pour cela, le livre se compose de deux parties très différentes. Il revient à Goulven Le Brech le mérite d’avoir très bien développé au long des soixante-douze pages de son essai, ce qu’il y a derrière le sous-titre même de l’ouvrage « Une philosophie de la vie » en nous présentant de façon claire et appétissante, les principes de vie qui dirigèrent Powys dans sa vie et dans ses écrits.
Pierrick Hamelin, quant à lui, a choisi d’établir un abécédaire, forcément restreint tant l’œuvre est immense, où il a retenu les thèmes, les termes et parfois les thèses, qui lui ont semblé être assez représentatifs de l’univers powysien pour figurer dans une sorte de guide pratique avant voyage et de boussole si on est perdu dans les romans ou les essais.

La première partie, rédigée de façon scrupuleuse est une réussite (on sent immédiatement que Le Brech a à la fois découvert l’auteur - qui l’a intrigué - et a apprécié sa vision des choses). Une sensation de confort s’installe dès les premières pages, due autant à la clarté du propos qu’à la conjugaison harmonieuse de l’inévitable axe narratif de la chronologie, avec la mise en valeur thématisée des grandes données conceptuelles et philosophiques de l’œuvre powysienne. Le lecteur a l’impression d’être guidé pour pénétrer dans un monde singulier, parfois complexe, voire difficile, de la même façon qu’il serait mis en confiance sur un sentier de randonnée pédestre inédit, grâce à la carte d’état major qu’on lui aurait remise en main. Comme toute randonnée, celle-ci comporte également des étapes. Le Brech a choisi, pour nous expliquer à la fois la philosophie de John Cowper Powys et sa genèse, du moins son évolution, de faire halte sur certains ouvrages, et pas des moindres. Qu’on en juge : La vision complexe, Wolf Solent, Les sables de la mer (Weymouth Sands), Le Hibou, le Canard et - Miss Rowe ! Miss Rowe !, Une philosophie de la solitude, L’Art du bonheur, Apologie des sens, Le sens de la culture.
On ressort de cette lecture très galvanisé. Découvrir, ou, pour les connaisseurs, apprécier de cette nouvelle façon, une partie significative de l’univers powysien, fait prendre conscience de la grande modernité de cet auteur et de la pertinence de ses textes pour comprendre ce XXIème siècle si confus, si incertain, sans dessein de civilisation. Une fois le livre refermé, on est lesté de plusieurs gros concepts que Goulven Le Brech a réussi à faire suffisamment apparaître pour donner envie d’aller plus loin. Il appartiendra ensuite à chacun de les étudier de plus près. Pour cela il a fait le choix particulier de prendre comme matrice de départ le premier essai que Powys écrivit à l’âge de quarante-huit ans, La vision complexe, sur lequel il consacre l’important premier chapitre qui agit à son tour comme matrice du livre. La vision complexe étant hélas introuvable aujourd’hui, on ne peut que remercier l’auteur d’avoir fait une très bonne synthèse de ses quatorze chapitres, jusqu’à détailler les plus importants. Pour lui en effet, les idées force qui structurent la pensée de Powys prennent naissance dans ce premier essai. On peut les regrouper en quatre ensembles qui sont intimement liés et donc se recoupent.
Le premier concerne le principe de volonté comme principe premier pour atteindre le bonheur malgré toutes les vicissitudes de la vie. Pour Powys en effet, l’harmonie avec soi-même s’obtient par un combat permanent contre l’adversité, représenté notamment par la façon dont s’organise la société moderne. Afin de lutter contre [l’état dépressif], l’individu a la capacité de se rapporter aux objets qui l’environnent non seulement par la raison et la sensation, mais aussi par l’éventail des ouvertures de la conscience au monde qu’offrent la volonté, le sens esthétique, l’imagination, la mémoire, la sensation, l’instinct, l’intuition et l’émotion. Mais, est-il précisé fort heureusement, la philosophie de la vision complexe n’a rien à voir avec la jouissance et n’est pas une nouvelle forme d’hédonisme. Pour Powys, le but de la vie dans sa haute signification philosophique n’est pas la recherche de la jouissance, mais l’art de ne pas s’attarder sur les moments de déplaisir (on pourra lire dans L’art d’oublier le déplaisir, comment Powys développe cette idée). La note en bas de la page 57 est à ce titre éloquente, tirée d’un passage de Une philosophie de la solitude : « …à chaque crise, quand nous sommes harassés, surmenés, poursuivis, persécutés, totalement confondus, misérablement humiliés, nous avons besoin d’une image mentale significative à laquelle nous puissions sans délais recourir, image qui soit en même temps un acte et une idée, une peinture mentale et une incitation à l’effort psychologique, image qui représente déjà en soi-même un effort psychologique. ».
Le deuxième ensemble conceptuel porte sur le fait de convoquer la culture pour combattre l’adversité (les ennuis quotidiens, la médiocrité de la vie moderne). Ce concept est très important. Dans notre société appelée post-moderne, où toutes les valeurs se valent, où il faut être consensuel en toutes choses pour ne pas choquer et où les mots ont perdu leur véritable sens, le mot culture est l’un des plus galvaudés. Le Brech présente très efficacement la pensée de Powys dans ce domaine en exprimant clairement les choses pour éviter les confusions. Powys insiste sur le fait que la culture, comprise comme le développement de soi, n’a rien à voir avec l’érudition. Effectivement ! Et plus loin il ajoute : [Powys] distingue par conséquent l’attitude de l’homme cultivé avec l’attitude de l’homme éduqué. Ce dernier, même doté d’une grande érudition, s’il ne conçoit pas le développement de sa culture comme un moyen de densifier son rapport personnel à la vie et se sert uniquement de ses connaissances pour briller en société, n’a rien de commun avec l’homme cultivé. L’intelligentsia germanopratine appréciera !!! Plus loin encore : La culture […/…] est, selon Powys, une attitude personnelle adoptée face aux vicissitudes de la vie, qu’il convient d’élargir et d’approfondir tout au long de son existence. […/…]. Face aux aléas de l’existence, face aux diktats de la science et de la religion, face aux nécessités économiques de son pays, la culture est le socle inaliénable à partir duquel chaque individu se construit. De la culture, on passe bien sûr à la littérature comme principe actif dans la vie quotidienne et non pas comme un stock froid de connaissances livresques. Conscient des maux de la société […/…], des horreurs perpétrées un peu partout sur la surface de la Terre […/…], son attitude se nourrit de l’ironie désabusée qu’il trouve dans les œuvres des […/…] grands écrivains et poètes. Son optimisme forcené n’est pas sans ignorer par exemple les tourments de l’homme du souterrain de Dostoïevski ou les errements de Jim dans Lord Jim de Conrad. On ne peut éviter de penser ici aux travaux de Frédérique Leichter Flack qu’elle a présentés dans son livre Le laboratoire des cas de conscience. Le Brech nous donne un très bel exemple d’application de ce principe powysien à travers un long extrait d’un de ses essais écrit en 1929 : Le sens de la culture (pages 49 à 51) qu’on laisse aux lecteurs le soin de savourer.
Le troisième concept a trait à l’érection de l’imagination créatrice comme antidote à la mort sociale et intellectuelle. Même s’il recoupe les thèmes précédents, ce principe philosophique, développé dans La vision complexe, est un fil rouge qui traverse tous les récits de Powys, notamment ses grands romans (Givre et sang, Wolf Solent, Les sables de la mer…). C’est une attitude mentale de refuge de la conscience grâce au pouvoir sans borne de l’imagination. Cette conscience est comparée à un instrument précieux qu’il faut maintenir vivant. Philosopher consiste à maintenir pur l’éclat de ce cristal […/…] et le polir sans cesse. Empruntant aux philosophes William James (1842-1910) et surtout Henri Bergson (1859-1941) et en convergence par ailleurs avec le courant de l’individualisme-anarchisme John Cowper Powys affirme l’irréductible liberté créatrice [qui se trouve] au cœur de l’homme. Il partage avec les penseurs de ce courant la conviction que les hommes peuvent être libres et égaux, non par le biais de l’action d’organisations collectives, mais par leur propre effort individuel. Pour développer ce point, Le Brech s’appuie sur un ouvrage de David Goodway : Anarchist seeds beneath the snow – left-libertarian thought and british writers from William Morris to Colin Ward, où est établie une filiation entre Powys et des auteurs comme Oscar Wilde, Herbert Read, Aldous Huxley ou George Orwell.
Mais, s’agissant à la fois de ce dernier auteur, et dans la mesure où Le Brech indique dans sa préface la pertinence de l’œuvre de Powys encore aujourd’hui, on aurait pu citer comme référence contemporaine, à la fois sur la philosophie anarchiste et sur l’infinie puissance créatrice du cerveau humain, un auteur aussi essentiel que Noam Chomsky, dont les travaux en linguistique et les conceptions philosophiques anarchistes sont en rapport avec le sujet.
Plus loin, sur la force de l’imagination créatrice, Le Brech n’oublie pas d’indiquer que Powys insiste en particulier sur le sens esthétique qu’il place au-dessus […/…] car orienté vers les racine mêmes de la vie. […/…]. Néanmoins, il ne s’agit pas pour l’artiste, l’écrivain ou le poète d’exercer son talent uniquement en direction de hautes idées esthétiques et morales, car ce qui est révélé par le sens esthétique est aussi une lutte, un conflit, une guerre, une contradiction, situés au cœur des choses. Le sens esthétique ne révèle pas seulement la beauté et le bien, il révèle aussi le grotesque, l’étrange, le scandaleux, l’indécent et le diabolique. Ceci nous renvoie aux travaux du philosophe Jacques Rancière et notamment à un de ses derniers ouvrages Aisthesis : Scènes du régime esthétique de l'art dans lequel il dresse une sorte de contre-histoire de la modernité artistique en s’interrogeant sur la notion d’événement culturel et en montrant que le sens artistique se transforme en accueillant des images et des objets opposés à l’idée du beau.
Le dernier concept, la philosophie ichtyosaure ou le concept de la Cause Première est exposé dans un chapitre particulier. C’est sans doute le principe le plus original développé et pratiqué par John Cowper Powys au long de sa vie. Exprimé la première fois dans La vision complexe, il y développe le fait que chaque être vivant, chaque élément naturel possède une personnalité, une conscience propre ou âme-monade unique […/…]. Sur le plan cosmogonique, Powys explique que ces âmes-monades existaient déjà il y a des millions d’années. […/…]. La conscience de soi, élément primordial de l’âme-monade de l’homme était présente dans un état rudimentaire dans des temps immémoriaux, quand il n’existait ni plantes, ni animaux, ni terre, ni mer, mais une nébuleuse. Même si ce n’est pas cité ici, on pense à l’univers de H. P. Lovecraft qui part du même postulat mais en le développant dans le fantastique monstrueux.
Il s’agit donc d’adopter la position vertueuse consistant à pratiquer une conscience immanente et poétique du monde, étendue aux domaines du végétal et du minéral ; jusqu’à être l’égal du plus petit insecte, du moindre caillou ou de la plus fragile plante. Revenu au Pays de Galles, il suggère à son lecteur de s’imaginer dans la peau d’un chétif insecte, tel un banal et inoffensif ver de terre. En se plaçant de ce point de vue, le lecteur situera son illusion vitale au degré le plus bas qu’il soit et ne sera plus choqué et meurtri par les outrances qui lui sont infligées au quotidien. Plus loin : « …ce mode de vie […/…] consiste à affirmer, dans le secret de son for intérieur, son égoïsme contemplatif à l’encontre de l’égoïsme vulgaire faisant de la quête du plaisir grossier, actif, grégaire qui représente l’essentiel de la vie des esclaves de notre temps, asservis qu’ils sont à la Machine… ». Plus loin encore : «…l’égoïsme ichtyosaurien, indolent et rêveur, s’opposant à l’égoïsme terre à terre et atrabilaire de l’homme moyen, n’est pas synonyme de repli sur soi ou d’amour propre. Il est au contraire un facteur d’ouverture vers autrui car pour celui ou celle qui se place du point de vue éternel et immuable des éléments, les différences et les barrières créées par la société n’ont plus lieu d’être… ».
Le Brech souligne à juste titre ici l’ombre de Jean-Jacques Rousseau et des stoïciens et précise que pour Powys, cette attitude relevait quasiment d’une sorte de nouvelle religion païenne dont il se serait fait le prophète pour montrer l’extase d’être simplement en vie sur la terre. On est évidemment loin des thèses et des pratiques pullulantes de la psychanalyse d’aujourd’hui, devenue la nouvelle religion des temps modernes ; psychanalyse que Powys, à la fin de sa vie, avait en aversion et qu’il jugeait antiphilosophique. Considérant l’inconscient comme l’enfer des prédicateurs d’autrefois, il suggère d’ailleurs à son lecteur d’être son propre psychiatre.
John Cowper Powys - Une philosophie de la vie est un livre qui a été écrit pour mettre en appétit le lecteur, l’invitant à entrer dans l’œuvre protéïforme de Powys. S’agissant d’une « introduction à », on aurait toutefois aimé que Goulven Le Brech propose, aux lecteurs, en aparté, une autre voie d’accès, celle qui est généralement recommandée par les fervents powysiens, à savoir commencer par « Autobiographie » qui est de l’avis quasi unanime, le point de départ au voyage. Puis alterner, sur le plan chronologique, romans et essais car ils sont intimement liés, en se réservant les derniers romans (La fosse aux Chiens, Atlantis, Owen Glendower, Morwyn, Porius) pour la fin, car leur complexité est due au fait qu’ils réunissent tous les thèmes powysiens à la fois, n’hésitant pas à mêler personnages historiques, fictionnels et mythologiques, tout en les émaillant de ses principes philosophiques.
Une question, philosophique, restera sans réponse. Comment Powys arrivait-il à concilier ces deux valeurs antagoniques qu’il érigeait comme principes : d’une part l’articulation de l’état ichtyosaure, où règne la primauté des sens de la façon la plus primitive possible, sans intervention de la Raison donc ; et d’autre part, la convocation du fonds culturel et littéraire pour chasser les déplaisirs, qui relève, lui, d’une position totalement opposée puisqu’il repose sur un niveau supérieur et élaboré de l’individu.
Goulven Le Brech termine son essai par un très bel extrait de Powys, qui mérite d’être cité in extenso : « …supposons que je sois cloué sur mon lit dans une de ces petites maisons toutes semblables, noircies par la fumée, quelque part entre Birmingham et Wolverhampton, et que j’aie seulement de pâles souvenirs de jeunesse, randonnées de vacances dans le région avec étapes à l’auberge ou chez d’aimables logeuses. Je ne suis pas sûr que certaines des grandes vérités des Anciens sur lesquelles repose ma philosophie ne me permettraient pas, après tout, de m’en sortir. Peut être, quand je verrais des gouttes de pluie sur ma vitre, ou la fumée de la maison d’en face, ou une branche de frêne portant encore exactement onze feuilles, telle ou telle pensée célèbre d’Héraclite, de Pythagore, de Rabelais, de Goethe ou de Walt Whitman me tirerait d’affaire, transformant en un triomphe le combat qu’en cymrique obstiné je mène pour me contraindre à jouir de la vie. »
On ne peut éviter, en lisant ces lignes de penser à un autre témoignage tout autant émouvant ; celui de Tony Judt, écrivain, historien anglais, penseur à contre-courant des mythes intellectuels européens, né de parents juifs, et devenu progressivement antisioniste, voire pro-palestinien, mort il y a deux ans. Dans ses mémoires parues sous le titre Le chalet de la mémoire il y décrit librement, alors qu’il est atteint de la maladie de Charcot, sa quadriplégie (perte de la voix, des membres, perte des sensations, puis immobilité totale) et la façon dont il arrive à vivre malgré tout avec bonheur : « …plus de sensations, mais pas de douleur. On est donc libre de contempler à loisir la catastrophique progression de sa propre dégradation. Ma solution a été de dérouler ma vie, mes pensées, mon imagination, mes souvenirs, exacts ou déformés, et ainsi de suite jusqu’à tomber par hasard sur des événements, des personnes ou des récits dont je puisse me servir pour distraire mon esprit du corps dans lequel il est engoncé. Je me réjouis de pouvoir utiliser les mots. Ils sont tout ce que nous avons. »
John Cowper Powys aurait certainement apprécié.
*
Et la philosophie de Powys pour les nuls ?

Nous entendons par là ceux qui, l’ayant lu dans tous les sens possibles, ne savent pas quel rapport il peut y avoir entre leur inclassable auteur et les « vrais » philosophes, les patentés, ceux qui ont laissé un nom « de philosophe » dans l’histoire.
Pas un vrai philosophe, Powys ? Euh... Si, comme le démontrent fort bien MM. Le Brech et Lecèdre. Mais pas un philosophe doté d’un système déterminé bien à lui. Pas un Descartes, un Spinoza, pas un Hume, pas un Nietzsche (même si Nietzsche l’a fasciné).
C’est qu’à nos yeux d’autodidactes, Powys paraît plutôt avoir été un pragmatique, voire un empirique de la philosophie ; quelqu’un en tout cas qui tenait pour certain qu’aucun système philosophique n’a jamais aidé personne à vivre. D’où, semble-t-il, la forme prise par ses ouvrages philosophiques, ambitieux ou modestes, qui se présentent surtout, pour certains, comme de petits vade-mecum, des manuels pratiques destinés avant tout à aider les humains dans leurs efforts quotidiens d’adaptation aux aléas de la vie.
Il y a eu aussi des raisons pratiques à cela : un certain nombre de ces écrits lui ont été commandés par des éditeurs américains, à l’intention d’un public U.S. très friand de ces choses.
[ Lorsqu’il sillonnait « tous les Etats Unis sauf deux », y donnant plus de dix mille conférences devant toutes les sortes de publics imaginables, il avait pour compagnon d’écurie, si on ose ainsi parler, son ami-ennemi de toute une vie, le trop méconnu écrivain édouardien Louis Wilkinson (« Louis Marlowe »), lequel, le voyant un jour en action, ne put s’empêcher de s’écrier « et, en plus, il les aime ! » ]
Cette rencontre de Powys avec le public américain des années 10, 20 et 30, avec ses aspirations et ses particularités – qualités pour les uns, travers pour les autres – est à ne jamais oublier quand on pense à John Cowper Powys philosophe de la vie et adversaire des systèmes philosophiques. De cette période et de ces nécessités (oui, certains des manuels de philosophie de Powys furent des potboilers), sont sortis The War and Culture, The Complex Vision, Psychoanalysis and morality, The Secret of Self-Development, The Art of Forgetting the Unpleasant, A philosophy of Solitude, The Art of Happiness, The Art of Growing Old et In Spite of, sinon l’Apologie des sens. Par ailleurs, Le Brech et après lui Lecèdre le font bien comprendre, Obstinate Cymric ou Ma philosophie à ce jour telle que me l’inspire ma vie au Pays de Galles a été au contraire l’expression d’une véritable nécessité interne. Il ne faut pas oublier non plus que, simultanément, Powys n’a pas cessé d’approfondir sa connaissance de Lao Tseu et surtout de Tchouang-Tseu, que lui avait fait découvrir sa compagne américaine, Phyllis Playter.
Et, bien sûr, il y a eu Rousseau !
Votre servante ne se pardonnera jamais d’avoir essayé de convertir l’historien Henri Guillemin à Powys en lui donnant à lire l’essai sur Jean-Jacques, extrait de Suspended Judgements. Pas du tout convaincu, le flamboyant catholique, par ce qui n’était en effet pas « son » Rousseau, mais un autoportrait éhonté du flamboyant gallois. Et pourtant, il y a du vrai Rousseau quand même dans ces quelques pages. On a l’impression, en les lisant, d’avoir sous les yeux un hologramme, où tantôt le visage de l’un tantôt celui de l’autre apparaissent. Bref, on n’a pas fini de sonder Rousseau, on n’a pas fini de sonder Powys, et on n’a pas fini de méditer sur leurs troublantes et profondes ressemblances.
Ce qui affleure en définitive, de la montagne d’écrits (essais, romans, analyses dithyrambiques, poèmes, correspondance, journal) c’est une espèce de recherche du bonheur. Ou, pour mieux dire, une définition de ce que pourrait être le bonheur, mais aussi et surtout de ce qu’il n’est pas, des voies d’accès possibles, de celles qui sont légitimes et de celles qui ne le sont pas, souvent par le biais des mille cas de conscience qui se posent à des personnages de roman, dont chacun est l’auteur lui-même.
Peut-on l’appeler une philosophie ?
Risquons-nous-y.
Il nous paraît évident qu’il n’existait pas, pour Powys, de bonheur imaginable en dehors de la contemplation. On a rarement exécré autant que lui les gens actifs. Ce que nous appelons contemplation allait, dans son cas, jusqu’à une communion totale, une fusion avec tout et n’importe quoi, puisqu'on sait qu'il convoquait à volonté l'extase à partir d'un peu de lichen sur un vieux mur. Ses moments de bonheur le plus intense – et qu’il a réussi à communiquer dans ses œuvres – donnent une impression de dilatation empathique vers tout, de « perméabilisation » à tout ce qui est matière (ou éther) en quoi se fondre ou se perdre, une forme de communion avec tout ce qui existe, atome par atome, ion par ion et ainsi jusqu’au plus infime. Il ne s’est pas pour rien inventé le mot « multivers », univers ne lui suffisant pas. Car ce drôle d’homme que d’aucuns prennent pour un mystique fut peut-être le plus grand matérialiste de tous les temps. Matérialiste au point de diviniser la matière, de l’appeler Déméter, de la prier lorsqu’il assistait à la messe dite par son fils, prêtre catholique, et de s’en confier à l’officiant, s’attirant un désolé « Papa, tu blasphèmes», qu’il balayait d’un « Mais non, mon petit, c’est toi, n’importe, l’essentiel est que tu sois heureux ».
Et voilà, on y revient. Au bonheur.
Lequel ne va pas, nous l’avons dit, sans questions corollaires , dont la principale était : « Comment jouir d’un bonheur légitime, c’est-à-dire de manière inoffensive ? » Ceci n’étant pas une clause de style, car Powys a souffert toute sa vie et jusqu’à un âge très avancé, de pulsions sadiques. Le soulagement qu’il a exprimé lorsque, enfin, sa libido a lâché prise, en témoigne, et témoigne en passant de l’origine sexuelle du sadisme, si jamais quelqu’un en doutait.
Petite digression historique à propos de philosophie
Une des notions qui se retrouve de manière presque obsessionnelle chez Powys est que la plupart des malheurs des hommes leur viennent d’une fausse conception du bonheur. Le vrai bonheur, idée toujours neuve en Europe, bien plus qu’on ne le croit ! Il nous semble que cette quête du bonheur et cette interrogation sur sa nature rendent Powys très proche de ceux qui ont posé pour la première fois la question non pas philosophiquement mais politiquement.
Difficile pourtant d’imaginer hommes plus dissemblables que ce pur produit de l’ère victorienne, descendant d’une longue théorie de prêtres poètes (John Donne et Francis Cowper entre autres) et les jeunes juristes fondateurs de la première vraie démocratie. Cependant, quoi qu’il ait nourri à leur égard les préventions de qui a lu Burke plutôt que Stanhope, il y a une parenté philosophique réelle entre John Cowper Powys et cette poignée de jacobins qui a rêvé de poser les bases du bonheur du monde.
Après tout, pourquoi l’ami d’Emma Goldman n’eût-il pas pu être aussi celui d'un Marat aussi maltraité qu'elle ? Et, bien sûr, lien essentiel entre eux et lui, il y a Rousseau, même si le Rousseau de Powys est celui des Rêveries et le leur celui du Contrat social.
Ce qu’il y a de sûr et d’important, c’est que le chemin qu’ils ont pris passe par le même chas d’aiguille : celui de l’individualisme (voilà qui surprendra ceux qui ont fait de Maximilien Robespierre l’ancêtre du collectivisme, en le prenant pour Babeuf). Cette voie de l’individualisme non égoïste est la voie la plus longue et la plus difficile qui soit. C’est la seule aussi qui ne soit pas sans issue.
Certes, les explorateurs partis, en 1793 à la découverte de cette dimension encore inconnue, ont dû verser le sang, ne fût-ce qu’à la guerre. A Powys aussi, il est arrivé de faire du mal, à ceux surtout qui lui étaient les plus proches. La biographie que lui a consacrée le Dr. Morine Krissdottir ne permet pas d’en douter. Cela n’infirme rien. Nous sommes des créatures faillibles, incomplètes, inachevées, et les révolutions ne se font pas in vitro.
Par ailleurs, nous avons la conviction profonde, absolue, que le lien originel, organique, la racine commune à l’excentrique Gallois et aux renverseurs de trônes, ce n’est pas tant Rousseau que Rabelais, grand-père de notre République et notre premier prophète du bonheur.
Powys lui a voué un culte. En le prenant pour un quaker, certes, mais en le comprenant aussi, sur certains points très intimes, infiniment mieux que les plus autorisés seizièmistes.
Des choses que Powys n’a pas sues mais qui furent.
Quand l'occasion s'en présentera, il faudra que nous vous racontions plus à loisir comment François Villon s’est trouvé un jour à décider du sort futur de la France, en prenant, devant un petit couteau taché de sang, une décision de juriste aux conséquences incalculables. Rabelais et ses contemporains (Dolet, entre autres) ont profondément admiré Villon. Pas seulement pour ses vers sublimes, soyons-en sûrs.
La transgression de Villon et celle des régicides furent du même ordre. Et la question du bonheur avait été, dès la première, posée.
Après, il n’y avait plus qu’à laisser glisser. Rabelais n’avait plus qu’à imaginer la manière idéale de gouverner (par la persuasion) ; son verbe n’avait plus qu’à se faire chair, et Saint-Just n’avait plus qu’à attirer notre attention sur l’idée neuve du bonheur. En Europe. Car il est vrai que Lao Tseu et Tchouang Tseu ne sont pas rien.
Des choses que Powys et lui seul a sues
Rabelais a passé et passe encore, dans cette révolution qui n’est pas finie, pour un misogyne. Rien n’est plus faux. Il fut, en revanche, indéniablement matriphobe, ce qui est bien plus radical encore qu’il n’y paraît, s’agissant d’en finir avec le pouvoir infantilisant du patriarcat. Or, ce n’est pas Abel Lefranc, ni Manuel de Dieguez, ni Jean Paris, ni Mikhaïl Bakhtine qui ont mis le doigt sur la blessure jamais refermée qui fut à l’origine de sa détestation des mères, étendue de la sienne à celles de ses enfants, c’est Powys – le grand imaginatif – s’identifiant au gamin de six ans et demi habillé, tondu et trahi par celle qui lui avait donné le jour, c’est-à-dire envoyé par elle à la mort civile, sous couleur d’aller « voir le geai parleur de l’oncle Frapin ».
Et puisqu’on en est là, comment ne pas se rappeler le jeune Saint-Just trahi lui aussi par sa mère, sans s’étonner de ce que les deux fils aient traité leurs génitrices respectives de « simpiternelles » (avec un i, dans les deux cas) et se soient semblablement soignés comme ils pouvaient : par le rire.
Rabelais n’a jamais pardonné. Saint-Just, au moment d’aller « chercher la mort » à Fleurus et d'y conduire trois fois la charge sans une égratignure, a fait un crochet par Blérancourt pour s’y réconcilier avec la terrible Marie Anne. Selon toute apparence être trahi à la fin de l’adolescence ou à «même pas sept ans» n’est pas tout à fait la même chose.
Fin de la parenthèse « Philosophie du bonheur et histoire de France. »

*
Que reste-t-il à découvrir de Powys pour les francophones ?
Malgré le très grand nombre d’œuvres déjà publiées en français, il en reste. A commencer par son mastodonte de chef d’œuvre, Porius – 1589 pages de manuscrit – qu’aucun éditeur n’a pris le risque, au moment où il fut écrit, de publier intégralement. Après qu’il eût, la mort dans l’âme, réduit son roman de plus d’un tiers et que MacDonald eût accepté de le publier, en 1951, comprimé en 600 pages, il restait à l’auteur 15 £ à la banque.
Nous l’avons lu, pour notre part dans l’édition spartiate, à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux, de l’intrépide Jeffrey Kwintner.
![6. powys_porius_1 - thumb[2].jpg](1845508733.jpg)
John Cowper Powys
PORIUS
Londres, The Village Press, 1974.
Il a fallu des années à d’érudits powysiens des deux côtés de l’Atlantique, pour restaurer autant que faire se pouvait le texte d’origine. Cela se passa en deux temps. La première version (la plus longue) fut celle de Wilbur T. Albrecht (1994, Colgate University Press).

Porius: A Romance of the Dark Ages
Powys, John Cowper; Albrecht, Wilbur T. (Editor & Foreword)
Elle fut suivie, en 2007, de la version estimée définitive :

John Cowper Powys
PORIUS - A novel
Edited by Judith Bond et Morine Krissdottir
Overlook – Duckworth & C° Ltd.
Réimpression en 2011
Ambitieux projet que celui de peindre ce « blank century » (le Ve A.D.) d’un Pays de Galles abandonné par les impériaux romains (oui, comme demain le seront l’Afghanistan, l’Irak et la Palestine), où Artur, dux bellorum, impatient de prendre leur suite, piaffe, sa féodalité sous le bras., dans les coulisses. Un Pays de Galles avec son matriarcat en fin de règne (« nos grands-mères, les reines de Marrakech », c’est là), et ses strates de populations diverses : autochtones sans nom, dits « gens de la forêt », Gaëls, Gallo-Romains, envahisseurs vikings et, déjà, missionnaires chrétiens. Avec, même, ses derniers géants, mais aussi (multivers oblige) ses règnes cohabitants : humains, animaux, végétaux et minéraux.
Qui peut oublier cette langue de petit chien sur le museau d’une jument morte, surprise d’y rencontrer un insecte « de la famille des scarabées » qu’elle dérange ? Qui peut oublier la première apparition de Merlin, où Powys, par le verbe, égale le Goya du Colosse ?
Où est passée l’édition française capable de publier un tel livre ? Celle qui en aurait l’audace n’en a pas les moyens. Celle qui en a les moyens… passons.
Mais à côté des œuvres-montagnes, il y a aussi chez Powys les œuvres-miniatures, si on peut les qualifier ainsi. Nous voulons parler des contes philosophiques et autres fictions de l’espace de la «seconde enfance» revendiquée de l’auteur.
Comme Shakespeare en fin de vie, Powys en fin de vie a touché à la suprême légèreté de son art. Un art épuré des tragédies comme des idées reçues, tout lest jeté par-dessus bord.
Cette légèreté a passé chez lui par la revisitation des Grecs (après tout, il est mort en traduisant Aristophane), et par Grecs, il faut entendre les dieux, l’Iliade et l’Odyssée, à l’exclusion, répétons-le, des tragédies. A ce multivers enchanté de son enfance d’écolier se sont ajoutées les spéculations cosmiques de son grand âge. C’était dix ans avant Gagarine, mais on y tendait, et que voulez-vous, les planètes faisaient rêver. C’était l’époque du Matin des Magiciens, de Pauwels et Bergier et de tous leurs semblables – dieusait qu’il y en eut – mais pas de SF pour Powys ! « Science » était, chez lui, un mot anathème (qui manque à l’abécédaire de M. Hamelin). La volonté, la contemplation, l’identification avec chaque atome de la matière suffisaient à faire s’élever dans les airs des quartiers entiers de Londres, avec leurs caves et leurs égouts. Les fantômes d’humains et les fantômes d’objets y partaient ensemble en voyage, à la découverte aussi bien de Venise et de Florence que de Mars et de Vénus, de l’Erèbe et du Tartare, et même du Paradis, où saint Pierre, saint Paul et les anges, affolés, cherchaient Dieu sans évidemment le trouver puisque Dieu était mort (la faute à Voltaire et Nietzsche ne l’avait-il pas dit ?), Paradis autour duquel rôdait un Diable SDF, que la disparition de son ennemi avait privé de son foyer, l’Enfer, c’est bien connu, n’ayant jamais existé que dans la tête de Dieu …
Ces petits contes de sa vieillesse sont, nous le craignons, considérés avec un rien de condescendance par les savants exégètes de Powys. Ils ne vont pas jusqu’à oser penser le mot « gâtisme », mais on le sent voleter. Feu François-Xavier Jaujard avait le projet d’en faire une anthologie. Il est mort trop tôt, à tous égards.
Enfin, il reste, entre ces extrêmes, un superbe roman de longueur normale, que personne encore n’a songé à publier en français et qui ferait à notre avis très bel effet dans le catalogue des Perséides.
ATLANTIS

Pourquoi vous en parler ? Parce qu’il offre un bel exemple de la manière dont fonctionnait l’imaginaire de John Cowper Powys.
Certes, on a déjà vu, avec Le Hibou, le Canard et… Miss Rowe ! Miss Rowe !, comment un tableau célèbre pouvait servir de point de départ, de tremplin en quelque sorte, à une histoire mêlant les animés et les inanimés. Le lecteur curieux a peut-être déjà repéré le hibou philosophe embrassé par son assassin et ami, le canard voyeur et le cheval blanc à qui manquent les pattes de devant, là où Powys les a trouvés lors d’un voyage qu’il fit en Espagne en passant par la Belgique, sinon, il ira les chercher, au Musée du Prado, dans Le Jardin des Délices, de Jérôme Bosch :



Alors que pour le poisson à la bouche ouverte, il lui faudra aller scruter La Tentation de Saint-Antoine . Même peintre, même voyage.

L’’histoire de la genèse d’Atlantis est plus curieuse.
Quelqu’un a mentionné le poème « Ulysse » de Tennyson, qui lui aurait été suggéré comme point de départ, mais il n’y a tout simplement aucun rapport entre l’héroïsme de Tennyson et l’espèce de comédie métaphysique de Powys, même s’il est certain qu’il l’a lu.
Nous avons parlé plus haut du Matin des Magiciens et des spéculations de l’époque. Il parut en 1954, chez Denoël, un petit livre de ce genre intitulé L’Atlantide et le règne des géants, dont l’auteur était Denis Saurat. Qui ne l’a lu, alors ? Il était dans l’air du temps. Certes, il fallait beaucoup de bonne volonté pour suivre l’auteur dans ses reconstitutions, preuves délirantes à l’appui, d’un passé fantasmatique (ah, ces deux lunes successives qui nous sont tombées dessus en attendant la troisième) et qui trahissait même une mentalité aussi discutable que répandue (ah, ces sempiternelles élites venues d’ailleurs pour expliquer tout ce que ces minus d’humains ne pouvaient avoir fait eux-mêmes !).
Les deux livres ayant paru la même année, il est impossible de dire si Powys s’est inspiré de Saurat ou plutôt, si les élucubrations de Saurat ont servi de tremplin à l’imagination de Powys. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a, dans sa correspondance, une lettre où il recommande chaudement la lecture de ce livre. A qui ? Notre mémoire flanche… (et avons-nous dit que notre bibliothèque est dans un garage ?).
Une au moins des illustrations qui s’y trouvent offre des ressemblances troublantes avec un de ses propres dessins : aucun familier de Powys ne peut avoir oublié la lettre où il s’est représenté gravissant une colline, son bâton Sacré à la main, dessin tellement semblable à celui-ci :

Quoi qu’il en soit de Tennyson, de Saurat ou de son propre multivers sans limites, Atlantis raconte l’histoire du dernier voyage d’Ulysse, qu’on peut considérer comme une sorte d’Odyssée à l’envers.
Résumons.
Lorsque débute cette histoire, il y a de la révolution dans l’air, sur terre et dans le Cosmos. Les habitants d’Atlantis ont préféré la science aux dieux et, comme on sait, quand les hommes cessent de croire en eux, les dieux disparaissent. En outre, les anciens dieux s’y sont mis pour les déloger du pouvoir. Quoiqu’affaiblis, les Olympiens se sont vengés sur les Atlantes en engloutissant l’orgueilleuse et mécréante mégalopole au fond de l’océan.
Rumeurs de révolution aussi dans la provinciale Ithaque, dont les habitants sont divisés en progressistes et conservateurs. Le trône d’Ulysse vacille, et pour tout dire, le vieil aventurier nourrit le projet de tout abandonner, de laisser ses compatriotes se débrouiller entre eux et de re-hisser la voile sans espoir de retour. Vers l’ouest… Car un désir incoercible le pousse à chercher l’Atlantide engloutie et à descendre voir ce qu’il en reste. Il le fera, c’est un des passages les plus réussis du livre.
En attendant, tout le monde – entendez par là toutes les créatures animées ou inanimées – a son avis sur la chose et l’exprime. On se croirait sur Internet.
Ainsi, l’action est commentée par un drôle de chœur antique fait d’un moucheron et d’une mite, qui vivent une torride histoire d’amour inter-espèces dans une fente du gourdin d’Ulysse, très fier (le gourdin) d’avoir été celui d’Héraclès et d’avoir, lui et lui seul, tué le lion de Némée. Participent aussi aux conciliabules un pilier de pierre de l’entrée du palais et une pousse d’olivier qui a surgi entre les dalles. Sans parler de la dryade Kleta, qui vit dans un très vieil arbre, au fond du jardin, et avec qui Ulysse, les nuits d’insomnie, va volontiers faire la causette, jusqu’à ce que Zeus, mesquin mais disposant encore d’un tout petit tonnerre, la foudroie et son arbre avec elle. Les dieux sont mauvais perdants.
L’équipage d’Ulysse - rien à voir avec celui qui l’a ramené de Troie – sera hétéroclite. En feront partie, outre le gourdin et ses deux insectes, un jeune homme dont Ulysse a fait son fils adoptif, Nausicaa, venue revoir son béguin de jeunesse et prête, cette fois, à l’accompagner où qu’il aille, Zeuks, fils de Pan (vous le voyez, mon petit blasphème ?). qui n’est autre que Rabelais en fermier d’Ithaque, plus une captive troyenne, fille inconsolée d’Hector, du nom d’Arsinoé. Le reste à l’avenant.
Powys, grâces lui en soient rendues, n’a jamais tenté de rendre ses inventions vraisemblables, et il est clair qu’au moment où il a écrit cette histoire, il avait définitivement jeté tout contrôle au vent. A l’opposé exact de M. Saurat, dont les inventions à prétentions réalistes n’ont rien à voir non plus avec la folle du logis (et les astres) de Cyrano.
Aux dernières nouvelles (2011-12), l’Atlantide serait une partie de la Sardaigne, engloutie par un tsunami un demi siècle avant la naissance de Platon. Pour Powys, c’est n’importe où entre Ithaque et l’Amérique. Pour Saurat, c’est chez les Incas, du côté de Tiahuanaco (si, si !).
Revenons-y donc à L’Atlantide et le règne des géants, dont une autre illustration a ou n’a pas donné des idées à John Cowper Powys. Elle nous permettra au moins d’établir le dinstingo entre les deux sortes d’inspiration. Le dessin est celui-ci :

Il représente un ensemble totémique observé chez les Malekula de Nouvelle Guinée (qui, oui, au temps des géants, auraient eu des contacts avec les Indiens des Andes). Il est composé d’un menhir, d’un dolmen et d’une statue de bois. Le totem de pierre aurait été sculpté par les gigantales élites disparues, pour que les âmes de leurs morts puissent venir y habiter. Quant à celui de bois, considérablement décati, il serait l’œuvre des humains ordinaires, persuadés, avec leur cerveau d’homo à peine sapiens que, dans l’incapacité où ils sont de reproduire le totem de pierre, le simulacre en bois peint fera tout aussi bien l’affaire pour attirer à lui les âmes de leurs grands-pères, lesquelles, de là, auront peut-être l’idée d’aller loger dans le vrai : celui en pierre. C’est un peu compliqué, mais qui sait ?
Voici, résumé, le passage d’Atlantis qui peut correspondre à cela :
Arsinoé enfant a été amenée captive de Troie. Esclave, elle sert aux cuisines. Interdiction lui a été faite de quitter son costume national, qui permettrait de la repérer, au cas où l’idée lui viendrait de s’évader. Son étoile jaune, en quelque sorte, et sa burqa sans grille.
Il existe, non loin du palais, une sorte de Gaste Terre frappée par la foudre, où tout est mort et où personne, par crainte superstitieuse, n’ose s’aventurer. Sauf Arsinoé, parce que c’est là et là seulement qu’elle peut jouir d’une bienheureuse solitude, loin du regard de ses geôliers.
N’ayant jamais fait le deuil de son héros de père, elle y a, au fil du temps, sculpté dans un énorme tronc d’arbre mort, avec son petit couteau à légumes, une statue d’Hector assis en majesté. Et c’est grâce aux nombreux plis de sa robe de captive qu’elle a pu sortir du palais, une à une, en catimini, toutes les pièces en or de l’armement d’Achille, ces mêmes armes qui avaient semé la zizanie dans le camp des Grecs, lorsque Ulysse se les était fait attribuer, alors qu’elles auraient dû revenir au grand Ajax, proche parent du mort, et qui croupissaient, depuis, au fond d’une cave (bien la peine !) Et pourquoi l’inconsolable Arsinoé se livre-t-elle à ces dangereux larcins ? Eh, mais, pour en revêtir son père. Tout y est : le casque, le pectoral, les jambières, les lances et le grand bouclier.
Qu’on me croie sur parole : un jour arrive au port un navire, à bord duquel se trouve le grand Ajax, incroyablement vieux. Zeuks le fermier, chargé d’aller l’accueillir, le trouve en si mauvais état qu’il lui faut le transporter à califourchon sur ses épaules. Et comme il est, lui, sans peur, sans reproche et, donc, sans superstition, il prend un raccourci, à travers la fameuse Gaste Terre, où, à la vue de son ennemi mort, tout rutilant de l’or d’Achille, le cœur du grand Ajax a son premier raté. Quoi de plus naturel que de l’asseoir entre les jambes du Troyen ? C’est là qu’il meurt, la joue appuyée sur son héritage.
Quand on en est à ce point, Denis Saurat, le peut-être tremplin, et ses géants civilisateurs sont loin, très loin, à des années-lumière, et Powys, aux Champs-Elysées, fume des asphodèles avec Savinien.
Vous raconter la fin d’Atlantis ? A quoi bon déflorer votre plaisir futur ? Sachez seulement que nos voyageurs atteignent un jour l’île de Manhattan, où ils sont accueillis par de bienveillants indigènes, et que, décidés à n’en pas repartir, ils brûlent leur vaisseau.
*
De l’Atlantide engloutie par la colère des dieux aux lunes « capturées » par notre terre, en passant par la Dame Noire (météorite) de Pessinonte peut-être devenue celle de La Mecque, l’imaginaire humain n’a jamais cessé de jouer à se faire peur avec des catastrophes cosmiques passées ou futures. Pourtant, le président Poutine a bien dit que nous cesserons d’exister dans 4,5 milliards d'années. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler et nous avons encore plein de factures à payer. En dépit de quoi, M. Seiko Nakajo et les savants japonais de NHK ont passé leur temps à simuler l’impact d’un astéroïde sur la terre et nous le font voir en collaboration avec le NFB (National Film Board) du Canada.
Bienvenue aux amateurs de sensations fortes !
*
Une biographie
Parlant de Powys à des lecteurs qui ne le connaissent peut-être pas, nous nous en voudrions de passer sous silence une des biographies les plus impressionnantes qu’il nous ait été donné de lire depuis bien des années.

Morine Krissdottir, membre éminent de la Powys Society, l’a écrite, d’une part pour s’acquitter d’un devoir envers le fils de Marian Powys, Peter Gray, qui venait de se suicider, d’autre part, comme elle l'a elle-même précisé, pour « se le (J.C.P.) sortir du système ».
Le résultat n’a pas plu à tout le monde. C’est que l’image d’Epinal petit à petit forgée par des admirateurs bien intentionnés en sort écornée. Morine Krissdottir, qui n’a pas volé son titre de docteur en psychologie, a eu la très grande honnêteté – et le courage – de se pencher sur l’abîme d’une âme humaine peu commune (quelqu’un a parlé de « terrifiant labyrinthe »). Elle rapporte ce qu’elle y a vu et cru comprendre. Elle a eu raison. Si l’image a changé, la stature est intacte. On pourra difficilement faire mieux.

Morine Krissdottir
The Life of John Cowper Powys
DESCENTS of MEMORY
Overlook Duckworth, 2007
Le 11 octobre 2007, son livre étant sorti peu de temps auparavant, Morine Krissdottir a posté le billet que voici sur le Books Blog du Guardian.
Acquérir un goût pour John Cowper Powys
Posté par Dr. Morine Krissdottir
Jeudi 11 octobre 2007
Ce n’est pas un auteur que n’importe qui peut digérer, mais ceux qui l’aiment n’en sont jamais rassasiés.
Je viens de passer les cinq dernières années de ma vie à écrire la biographie d’un auteur que des tas de critiques détestent. John Cowper Powys est une espèce de « Marmite »1 littéraire.
Si vous adorez la Marmite, comme Iris Murdoch et John Bailey, vous voudrez lire Powys au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Si vous aimez que vos romans et vos auteurs soient sans complications, vous êtes l’oiseau de la pub récente qui, à peine y a-t-il goûté, s’enfuit à tire d’ailes. Soit vous pensez qu’il est un génie, soit qu’il est un charlatan sado-maso, chef du siphonné clan Powys. Le poète Philip Larkin a comparé Powys à un gigantesque volcan poético-mythologique ; son propre ami, Louis Wilkinson, déplorait qu’il pût écrire « des sottises aussi ridicules et fastidieuses ». Un critique a qualifié Les enchantements de Glastonbury de « roman épique d’une force terrible unie à une formidable intensité lyrique », et un autre en a décrit le premier paragraphe, surchargé de métaphysique, comme « Le Beecher’s Brook2 de la fiction anglaise ».
Les jeunes années de Powys furent assez ordinaires. Ses parents, le révérend C.F. Powys et Mary Cowper, son épouse, étaient de petite noblesse, John, l’aîné de 11 enfants reçut l’éducation qui convenait (Sherborne et Cambridge), fit un bon mariage et eut un fils. Il était destiné à mener une vie tout à fait conventionnelle dans le Sussex quand il décida subitement de tenter sa chance aux Etats-Unis, où il se lança dans une carrière de conférencier itinérant.
Son succès fut immédiat. Il attirait des foules énormes, qui écoutaient intensément et applaudissaient avec extase sa manière dramatique de discourir sur des auteurs célèbres. Parallèlement à cela, il s’était mis lui-même à écrire. Et, après quelques romans sans succès, il produisit un best seller, Wolf Solent.
En 1923, il rencontra une jeune Américaine, Phyllis Playter, et, avec l’argent que lui avait rapporté Wolf Solent, il se retira dans une maison du nord de l’état de New York, pour s’y consacrer à l’écriture à plein temps. C’est là qu’il écrivit deux autres romans sur la région de l’Ouest de l’Angleterre, Les enchantements de Glastonbury et Les sables de la mer, ainsi que son Autobiographie, qui est une des confessions les plus originales jamais écrites. A cette époque, son excentricité n’était plus un secret pour personne, ni son adhésion à une pensée magique, ni sa haine de la vie moderne. En 1934, il retourna au Royaume-Uni et, après une année passée dans le Dorset, il alla s’installer au Pays de Galles, où il écrivit ses deux étonnantes chroniques galloises, Owen Glendower et Porius. Il est quasiment impossible de résumer ses histoires tentaculaires, pleines de personnages étranges aux noms invraisemblables, mais, bien après qu’on en ait oublié les détails, ces romans continuent à vous hanter.
Powys a été décrit comme « une des grandes énigmes de la littérature du XXe siècle ». Pour ses détracteurs, il n’est qu’un mystagogue détraqué. Ses admirateurs en revanche, et ils sont nombreux, ont plus de mal à décrire ce qui, chez lui, s’empare de leur imagination. L’un des aspects fascinants de son génie est qu’il attire des lecteurs aux centres d’intérêt extrêmement variés, qui raffolent de ses romans pour des raisons très différentes – ses scènes comiques, ses fantasmes érotiques, ses images enchanteresses, sa finesse psychologique, sa philosophie de la vie.
On a bien du mal à ne pas identifier Powys aux anti-héros de ses romans, et ceux qui n’apprécient pas ce qu’ils perçoivent de sa personnalité sont également rebutés par ses personnages et ses intrigues.
D’une part, sa « conscience malade » exigeait qu’il passe beaucoup de sa vie à fournir un soutien émotionnel, par ses livres, ses conférences et ses lettres, aux jeunes disciples (presque toujours masculins) qui lui ont fait escorte sa vie durant et qui continuent à dévorer avec avidité ses livres de philosophie. D’autre part, pour avoir lu les parties non publiées de son journal et de sa correspondance, je sais à quel point il a pu être destructeur pour son entourage le plus proche, en particulier la compagne de quarante ans de sa vie, Phyllis Playter. En tant que psychologue, j’ai scruté sa vie autant que son œuvre. Pourtant, malgré toutes ces années passées à me glisser à travers les frontières de son esprit, je doute être jamais capable de savoir si Powys fut un puissant magicien ou un enfant perdu, terrifié à l’idée d’entrer quelque part, un clown ou un fou sacré, un écrivain des marges ou un écrivain marginal, mais cela n’a pas vraiment d’importance : je suis accrochée à l'hameçon.
______________
1 Pâte à tartiner anglaise, à base de concentré de viande.
2 La Rivière Beecher est un des principaux obstacles du Grand National, célèbre course de chevaux qui se déroule près de Liverpool. Elle est responsable de nombreuses chutes, dont plusieurs ont été mortelles.
Source :
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2007/oct/11/acquiringatasteforjohncow
traduction de Kahem
pour Les grosses orchades
*
La descendance de Powys
est trop importante pour qu’on n’en parle pas, bien qu’il ne faille y chercher aucune ressemblance directe. Disons pour être plus près de la vérité que John Cowper Powys peut se vanter d’avoir donné des idées au plus grand écrivain américain vivant.
Le plus ?... Ceci est notre opinion personnelle. Cependant, en 2000, le Writers’ Digest (ne pas confondre avec le Readers’ !) l’a classé parmi les cent meilleurs écrivains du XXe siècle, et la critique italienne Fernanda Pivano, a écrit de lui, dans le Corriere della Sera, qu’il était « l’écrivain le plus dangereux du monde ». Le plus dangereux ? Difficile à dire. Si on parle de l’ordre établi depuis dix mille ans – celui du patriarcat sous tous ses régimes et dans toutes ses religions – la Signora Pivano pourrait bien n'avoir pas tort. Le plus subversif en tout cas. Et de la même manière, surtout, que John Cowper Powys et nos propres fondateurs de la République : en passant par un individualisme sans faille, assumé jusqu’à l’héroïsme.
Là aussi, il semble bien que le dénominateur commun soit l’auteur de Pantagruel et de Gargantua. Nous avons beaucoup réfléchi avant d’oser dire que Tom ROBBINS est sans doute le Rabelais américain d’aujourd’hui. Et pourquoi diable l’histoire ne se répéterait-elle pas dans le bien comme elle le fait si obstinément dans le mal ?

Mais commençons par le commencement. Dès son tout premier livre, écrit en 1967 et publié en 1971, Une bien étrange attraction, (l ‘édition française, qui a du nez, l’a découvert quarante ans plus tard), Robbins se révélait disciple de Robert Graves, en même temps qu’il empruntait son grand singe papion à Jarry.
Ce qui est curieux, c’est que les deux grands mytheux (mythophiles ?) de la littérature anglaise, celui d’origine irlandaise et celui d’origine galloise, ne s’aimaient pas. Ou plutôt que l’un (Powys) n’aimait pas l’autre. Pourquoi ? Cela reste pour nous un mystère. Si Graves fut féministe, Powys ne le fut assurément pas. Mais égalitaire, oui, avec tout ce qui existe d’humain, d’animal, de végétal et de minéral, sans compter le reste.
Lorsque, le 8 octobre 1962, Powys fêta son 90e anniversaire, il reçut, du maire de Deià (Majorque) un télégramme libellé « Félicitations, Monsieur ». (Le maire de Deià était un viticulteur qui ne savait que l’espagnol.) Le petit-fils de Leopold von Ranke avait trouvé ce moyen espiègle de désarmer son adversaire.
On trouve tout cela et ce genre d’humour-là, chez Tom Robbins, qui se dit avec raison « cheerfully insubordinate ». La filiation avec Graves, clairement revendiquée, ne s’est jamais démentie. (Mais pourquoi les seuls féministes conséquents sont-ils des hommes ?)
En 1990, dans un livre à haute ambition politique autant que philosophique, Skinny legs and all (« Jambes maigres et tout », inédit en français), il allait s’affirmer aussi de la descendance de Powys en créant une série d’inoubliables personnages inanimés. La réussite fut, du premier coup, à la hauteur du modèle.

Livre à haute ambition politique et néanmoins d’une intense drôlerie, ce qui peut paraître impensable, puisqu’il ne s’agissait de rien moins que de prendre à bras-le-corps le problème palestinien. Victime de la même illusion qu’Israël Shamir (voir sur notre post précédent : « Automne en Crimée »), Robbins rêvait d’un monde enfin adulte où juifs et Palestiniens pourraient cohabiter, en bonne intelligence, sur la terre de leur antique déesse-mère à tous, l’ânesse à phallus Palès. Les vingt-deux ans qui viennent de s’écouler et des tonnes de phosphore blanc ont réduit ses illusions en cendres. Il ne pourrait plus aujourd’hui, écrire le même livre, qui reste un chef d’œuvre cependant. Tout comme les guerres « de religion » françaises ont réduit en cendres l’utopie de Thélème, sans jamais réussir à rendre obsolète un seul des chefs d’œuvres de celui qui l’avait rêvée.
Tom Robbins est un des auteurs les plus lus au monde. Et nulle part, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, le public n’a attendu la sanction de la critique pour se jeter dessus, le lire et le relire.
Avec vingt à quarante ans de retard, dépendant des titres, l’édition française daigne enfin s’intéresser à cet énorme écrivain d’outre-Atlantique, qui a connu la situation biscornue d’être l’invité d’honneur du festival des Etonnants Voyageurs de Saint-Malo alors que le public ne savait rien de lui. Et quand nous disons « édition française », nous parlons de « petits » éditeurs, pas des marchands d’armes.
Ah, oui : les inanimés. Sont ici une boîte de haricots à la tomate, une chaussette sale, une petite cuiller, un bout de bois peint et une conque.
Leur lieu de naissance est une grotte, où certains, qui y dormaient depuis des millénaires, ont été réveillés par les ébats amoureux d’un couple de jeunes mariés. La chaussette appartient au jeune homme, qui s’en va en l’oubliant ; la boîte de haricots, abandonnée elle aussi, aurait dû servir de pique-nique. Le bout de bois peint est un objet rituel païen du culte d’Astarté, un très classique phallus taché de sang emporté par on ne sait quel prêtre fuyant l’envahisseur juif et embarqué avec lui sur un navire phénicien (vous ne le saviez pas que les Phéniciens avaient découvert l’Amérique ?) ; la conque enfin, symbole non moins sexuel de la même déesse, est une relique de la reine Jézabel, massacrée vous savez comment.
Tous ces objets se mettent en route dans le sillage des deux jeunes gens et vont même suivre la moitié masculine du couple jusqu’à Jérusalem : leur hégire sur les flots vaut bien la navigation d’Ulysse vers l’Atlantide engloutie, et deux d’entre eux iront même jusqu’à reprendre leurs antiques fonctions dans le Troisième Temple de Jérusalem, évidemment dédié à Palès-Astarté.
Le bonheur est toujours une idée neuve, hélas, mais il reste à l’ordre du jour.

Les livres de Tom Robbins ne se résument pas. La seule solution, si on veut savoir, est de les lire, dans un désordre chronologique total.
Mickey le Rouge, 10/18, 2005
Villa Incognito, Cherche-Midi, 2005
Comme la grenouille sur son nénuphar, Gallmeister, 2009
Même les cowgirls ont du vague à l’âme, Gallmeister, 2010
Une bien étrange attraction, Gallmeister, 2010
Un parfum de jitterbug, Gallmeister, 2011
Féroces infirmes retour des pays chauds, Gallmeister, 2012
B comme bière, Gallmeister, 2012
Et il ne vous reste plus, chers internautes qu’à bombarder les éditions Gallmeister de mails, de lettres et d’appels téléphoniques : « Jambes maigres et tout, c’est pour QUAND ? ».
*
Mis en ligne le 2 janvier 2013 par Théroigne
14:42 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : atlantide, atlantique, bonheur, catastrophes, cosmos, de dieguez, dostoïevski, edition française, égalité, féminisme, nabe, pays de galles, perseides, philosophie, powys, rabelais, république, robespierre, rousseau, saint-just, villon | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2010
Droits de la Phâme... Journée des femmes... etc.
Catherine m’a dit : Rends-toi utile, c’est la journée des femmes.
- Moi je veux bien, mais sur mon calendrier à fleurs de Femmes d’aujourd’hui, il n’y a pas « Journée des femmes », il y a « Journée des Nations-Unies pour les droits de la femme et la paix internationale ». Ça ne fait déjà qu’un tiers de journée pour nous autres. Et si tu comptes sur les Nations-Unies pour aménager ton Paradis sur terre....
- Fais pas ch.. Pardon
- Écoute, je veux bien m’y coller, mais à mes conditions : : 1) je laisse tomber le Machin, 2) je parle de qui je veux, et, 3) pour la paix, on verra plus tard. Dans l’immédiat, je réclame l’égalité, la liberté et la fraternité. Ça te va ?
- Sororité, au moins...
- Ah, non ! Ça fait jargon... comme non-voyant... mal-entendant... Beurk ! Et d’abord, la Mère des Dieux, elle n’était pas bisexe ?
- Si.
- Ben, alors ? Allons-y Folleville !

Quelques femmes d'hier, d'aujourd'hui, et même une d'avant-hier.
Galerie perso.
On est le 8 mars. (faites un effort).
*
Je ne parlerai pas de la déesse sumérienne de l’écriture Nidaba, qui prouve quoi sinon que ce sont les gonzesses qui l’ont inventée ?
Je ne dirai rien des « débris de l’armée des Amazones » en Ardenne, « qui y ont peut-être fait souche ». Ça, c’est la marotte de Catherine. (« Tu trouves ça normal, toi, Jeanne d’Arc, Théroigne, Saint-Just et Rimbaud nés dans un mouichoir de poche ? ») Pas envie de finir aux Petites Maisons.
Je ne parlerai pas davantage de la Fête des femmes dans l’Antiquité grecque, qui était une fête de la déesse-grain-de-blé Koré et de sa mère Déméter, car cela nous entraînerait moins loin que Sumer mais trop loin quand même. Elle ne tombait d’ailleurs pas le 8 mars, leur fête, mais le 12 du moicis scirophorion (± début juin). Elle consistait principalement à jeter des porcelets vivants dans une cavité terrestre, anfractuosité, caverne ou autre et à les y laisser mourir et pourrir. Quand le temps était venu pour Koré de descendre chez son infernal époux et d’y devenir Perséphone, déesse-truie de la mort (temps des semailles), on récupérait les restes des petits cochons et on les mélangeait aux graines-Koré. C’était un rite de fertilité. Le culte de Déméter et Koré ainsi que la fête de leurs filles terrestres était donc intéressé.
Pour ce qui est de la « fête » ou « journée » qu’on célèbre aujourd’hui, commençons par rendre à Vladimir Ilyich ce qui appartient à Lénine : c’est lui qui a choisi cette date du 8 mars. En 1921. En souvenir des ouvrières de Saint-Petersbourg, qui avaient fait ce jour-là, en 1917, une grande manifestation pacifique – la manie des femme, les manifestations pacifiques ! – pour réclamer du pain, le retour des hommes du front, c’est-à-dire l’arrêt de la guerre, et la république en paquet-cadeau. Comme elles n’avaient pas obtenu ce qu’elles voulaient, elles s’étaient mises en grève et de fil en aiguille... le 8 mars 1917 est le premier jour de la Révolution Russe. Comme la manif des femmes à Versailles, déjà pour du pain, en juillet 1789 ? Tout juste.
Mais ce n’est pas Lénine qui avait eu l’idée de départ, c’était Clara Zetkin.
 Clara Zetkin (1857-1933) s’appelait en réalité Clara Eissner, et elle n’était pas russe, elle était allemande. Marxiste, ça oui, elle l’était, institutrice (déjà fille d’instituteur), journaliste et femme politique.
Clara Zetkin (1857-1933) s’appelait en réalité Clara Eissner, et elle n’était pas russe, elle était allemande. Marxiste, ça oui, elle l’était, institutrice (déjà fille d’instituteur), journaliste et femme politique.
C’est en 1878 qu’elle avait rompu avec sa famille pour se lancer dans la carrière. Chez les socialistes. Mais le chancelier Bismarck avait frappé son parti d’interdiction et elle avait dû prendre le chemin de l’exil – c’est fou ce qu’il y a eu d’exilés politiques en Suisse à la fin du XIXe siècle ; en Belgique aussi d’ailleurs –. Bref, elle y avait rencontré Ossip Zetkin, qui, lui, était russe, et il était devenu son compagnon. Elle ne l’avait pas épousé mais avait pris son nom, et ils avaient eu, ensemble, deux enfants. À la mort de Zetkin, elle avait rencontré le peintre Friedrich Zundel et l’avait épousé, mais sans porter son nom. Zetkin elle était restée.
On peut dire que sa carrière est jalonnée d’un grand nombre d’actions très importantes, pas seulement pour le sort des femmes mais pour le sort de toutes les classes dominées. Ainsi, elle a participé, à Paris, à la fondation de la IIe Internationale ; elle a fondé – toute seule – la revue des femmes socialistes allemandes, Die Gleichheit (L’Égalité), et c’est à Copenhague, le 8 mars 1910 (sept ans avant la manif des Saint-Pétersbourgeoises), qu’elle a proposé la création d’une journée internationale des femmes, qui devait être, d’après elle, une journée de luttes : il s’agissait surtout d’arracher le droit, pour les femmes, de voter comme n’importe qui. (Aujourd’hui, dans un de ses livres, M. José Saramago fait voter blanc 83 % des électeurs d'un pays, et il a, hélas, raison.).
D’une lecture ancienne, je crois avoir retenu que dans cette revue, Die Gleichheit, elle avait posé la question de la liberté sexuelle et de l’égalité entre les hommes et les femmes, à quoi s’était opposé Lénine, qui avait trouvé que pour tout cela, on verrait plus tard, que les choses sérieuses d’abord, etc. Dommage. Du coup, c’est le capitalisme qui s’est emparé du problème et (en 1968) a dicté ses solutions, dans des buts inavouables, dont un des moindres n’était pas le souci mercantile de fabriquer des consommateurs sexuels obligatoires.
Je pourrais vous détailler les nombreuses activités de Clara Zetkin et leurs résultats. Je vais juste rappeler que non seulement elle a fini par arracher le droit de vote (en Allemagne) mais qu’elle a aussi été députée au Reichstag de 1920 à 1933, c. à d. jusqu’à ce que Hitler y mette le feu. Elle y a prononcé son dernier discours, à titre de doyenne de l’Assemblée, en 1932, pour appeler les Allemands à résister au nazisme. Après cette mémorable nuit d’incendie du 27 au 28 février 1933, que croyez-vous qu’il arriva ? Les nazis suspendirent toutes les libertés et mirent les partis progressistes hors la loi. Comme après le 11 septembre ? Évidemment oui, c’est une stratégie vieille comme l’usage de la démocratie contre elle-même. Clara dut reprendre le chemin de l’exil et mourut, quelques semaines seulement plus tard, à Moscou... On a accusé Staline de l’avoir liquidée. De quoi n’a-t-on pas accusé Staline ?
Ceci est un résumé si succinct qu’il en est outrageant. Mais je viens de m’apercevoir que Secours Rouge lui consacre, pour ce 100e anniversaire de son initiative, un dossier biographique illustré. Franchement, je ne pourrais pas faire aussi bien. Allez-y donc voir, vous ne perdrez pas votre temps. C’est là :
http://www.secoursrouge.org/zetkin.php
*
Clara Zetkin avait eu une amie très chère et compagne de luttes : Inès Armand, dite Inessa (Elisabeth, en fait). Née le 8 mai 1874 à Paris, d’un père français, le chanteur d’opéra Théodore Stéphane, et d’une mère anglaise, la comédienne Nathalie Wild.
La vie d’Inessa Armand est un roman et il s’y est passé tant de choses qu’il est impossible de la résumer dans un post de circonstance comme celui-ci.
 Je mentionnerai seulement pour mémoire qu’elle parlait plusieurs langues, que, d’Inès, elle devint Inessa, par son mariage avec Alexandre Armand, fils d’un richissime industriel du textile russe ; qu’elle eut de lui cinq enfants ; qu’elle le quitta un beau jour pour vivre, mais pas longtemps, avec son beau-frère Vladimir ; qu’elle fut tolstoïenne et féministe avant de s’engager plus précisément en politique. On peut dire que c’est la lecture des écrits de Lénine qui détermina tout le reste de sa trajectoire. Elle s’engagea dès lors dans la préparation acharnée de jours meilleurs, passant d’un pays à l’autre, participant à tous les événements désormais historiques qui ont précédé la révolution russe, et, lorsque Vladimir Ilyich rentra en Russie, en 1917, elle fut du voyage. Elle était devenue sa femme de l’ombre, bien qu’elle ait été, à mon avis, infiniment plus que cela. On pourrait presque dire que Lénine n’a quasiment rien fait qu’elle n’ait fait aussi, de son côté. Tout en élevant cinq enfants.
Je mentionnerai seulement pour mémoire qu’elle parlait plusieurs langues, que, d’Inès, elle devint Inessa, par son mariage avec Alexandre Armand, fils d’un richissime industriel du textile russe ; qu’elle eut de lui cinq enfants ; qu’elle le quitta un beau jour pour vivre, mais pas longtemps, avec son beau-frère Vladimir ; qu’elle fut tolstoïenne et féministe avant de s’engager plus précisément en politique. On peut dire que c’est la lecture des écrits de Lénine qui détermina tout le reste de sa trajectoire. Elle s’engagea dès lors dans la préparation acharnée de jours meilleurs, passant d’un pays à l’autre, participant à tous les événements désormais historiques qui ont précédé la révolution russe, et, lorsque Vladimir Ilyich rentra en Russie, en 1917, elle fut du voyage. Elle était devenue sa femme de l’ombre, bien qu’elle ait été, à mon avis, infiniment plus que cela. On pourrait presque dire que Lénine n’a quasiment rien fait qu’elle n’ait fait aussi, de son côté. Tout en élevant cinq enfants.
Inessa Armand et ses enfants, en exil à Bruxelles, 1909.
Pour finir, Inessa Armand a dirigé la section féminine du Comité Central de Parti Communiste russe de 1919 jusqu’à sa mort en septembre 1920, ne cessant jamais de payer de sa personne. C’est d’ailleurs ce qui l’a tuée : partie en mission dans le Caucase alors qu’y régnait une épidémie de choléra, elle y contracta la terrible maladie loin de toute possibilité de soins et mourut dans le train qui ne put la ramener à Moscou assez vite, partageant ainsi le sort de ceux qu’elle était allée galvaniser.
On dit que Lénine ne s’est jamais remis de l’avoir perdue.
Elle est inhumée sur la Place Rouge, pas loin de lui, le long de la muraille du Kremlin.
J’ai dit qu’elle était une héroïne de roman. Trois films ont évoqué son histoire :
- Lénine à Paris, de Serguei Youtkhevitch, où elle était incarnée par Claude Jade
- Le train, de Damiano Damiani, où Dominique Sanda lui a prêté ses traits.
- Minu Leninid, d'Hardi Volmer où c’est Janne Sevchenko qui la fait revivre.
Des livres aussi lui ont été consacrés, dont la belle biographie de Jean Fréville Une grande figure de la Révolution russe : Inessa Armand, Paris, Éditions sociales, 1957, depuis longtemps épuisé.
Plus récemment, Georges Bardawil, a donné Inès Armand, La deuxième fois que j’entendis parler d’elle, chez J.C. Lattès, Paris, 1983.
Sa première biographie en anglais est l’Inessa Armand, Revolutionary and Feminist, de R.C. Elwood, Cambridge University Press, 1992 et 2002.
Quand l’édition française aux mains de marchands d’armes ne sera plus à la ramasse, on rééditera peut-être au moins sa biographie par Fréville... Mais ce serait bien aussi qu’un jeune historien s’y colle, ou même une jeune historienne.
*
Rachel, crois-tu qu’on puisse t’oublier ?

Pour ceux qui n'étaient pas nés :
Rachel Corrie était une étudiante américaine de 23 ans, qui militait dans un mouvement non-violent de solidarité internationale (I.S.M.). Elle a été assassinée dans la bande de Gaza, par un jeune soldat israélien, qui l’a délibérément écrasée en lui passant par deux fois sur le corps avec un bull-dozer, alors qu’elle tentait de faire un rempart de ce corps à la maison d’un médecin palestinien.


Avant Après
Avec le journal et les e-mails de la jeune fille, Katherine Viner et Alan Rickman ont fait une pièce, qu’ils ont intitulée My name is Rachel Corrie. Cette pièce a fait le tour du monde. Elle est encore, en ce moment, jouée un peu partout, mais ne l’a jamais été à New York, où le lobby pro-israélien a réussi à suffisamment terroriser le directeur du New York Theater Workshop pour qu’il la retire de l’affiche avant la première représentation.
L’assassinat de Rachel Corrie avait été filmé par un témoin. En voici la vidéo. Deux jeunes hommes que l’on y voit ont aussi été assassinés intentionnellement, d’une balle bien ajustée dans la tête, par des militaires dont un seul a été poursuivi (euh... un bédouin arabe enrôlé dans Tsahal, mais c’est fortuit).
*

...Originaire de la lointaine Saint-Pétersbourg. elle a accompli un long voyage pour arriver dans ce pays, celui qu'Alexandre le Grand a traversé sur sa licorne, cette terre de vergers légendaires et d'épaisses forêts de mûriers, de grenadiers qui ornent les frises de manuscrits persans écrits voilà plus de mille ans.
Son hôte s'appelle Marcus Caldwell. Anglais de naissance, il a passé la majeure partie de sa vie ici en Afghanistan, après avoir épousé une Afghane. Il a soixante-dix ans, et sa barbe blanche, ses gestes mesurés évoquent ceux d'un prophète, un prophète déchu. Elle n'est là que depuis quelques jours et ne sait rien ou presque de cette main gauche que Marcus a perdue. La coupe de chair qu'il pouvait former avec les paumes de ses mains est brisée en deux. Un jour, tard dans la soirée, elle l'a interrogé à ce propos, avec délicatesse, mais il s'est montré si réticent qu'elle n'a pas insisté. En tout état de cause. il n'est besoin d'aucune explication dans ce pays. Il ne serait guère surprenant qu'un jour les arbres et les vignes d'Afghanistan cessent de pousser, de peur que leurs racines en continuant de croître entrent en contact avec une mine enfouie à proximité.
Elle est tombée malade pratiquement dès son arrivée, il y a quatre jours de cela, succombant à l'épuisement consécutif à son voyage jusqu'à lui, et il a pris soin d'elle depuis, après avoir vécu dans l'isolement le plus complet pendant des mois. D'après les descriptions qu'elle en avait eues, comme elle l'a dit dans son délire lors du premier après-midi, elle s'attendait à rencontrer une sorte d'ascète vêtu d'écorce et de feuilles, et accompagné d'un cerf de la forêt.
Elle lui a dit aussi qu'il y a vingt-cinq ans son frère, entré en Afghanistan avec l'armée soviétique, faisait partie de ceux qui n'en étaient jamais revenus. Elle a visité le pays à deux reprises entre-temps, sans trouver la preuve qu'il était mort ou encore en vie, mais peut-être en ira-t-il autrement cette fois-ci. Si elle est ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle a appris que la fille de Marcus aurait pu connaître le jeune Soviétique.
Il lui a dit que sa fille, Zameen, était morte.
"A-t-elle jamais fait une quelconque allusion'' a-t-elle demandé.
-Elle a été emmenée de cette maison en 1980, à l'âge de dix-sept ans. Je ne l'ai jamais revue.
-Et personne d'autre non plus?
-Elle est morte en 1986, je crois. Elle était alors la mère d'un petit garçon qui a disparu à peu près à l'époque où elle est morte. Elle était amoureuse d'un jeune Américain, et c'est de lui que je tiens ces informations. "
C'est le premier jour qu'a eu lieu cette conversation, au terme de laquelle la jeune femme a glissé dans un long sommeil.
À l'aide des diverses plantes du jardin, il a concocté une pommade pour la base de son cou, couverte d'un énorme hématome, la peau presque noire au-dessus de l'épaule gauche, comme si un peu des ténèbres du monde avait tenté d'entrer en elle à cet endroit. Il a regretté que ce ne soit pas la saison des grenades, car leur jus est un antiseptique puissant. Quand le car est tombé en panne au cours du voyage, a-t-elle raconté, tous les passagers sont descendus et elle s'est endormie sur le bas-côté de la route. Et soudain se sont abattus sur elle trois coups rapides assénés à l'aide d'un démonte-pneu, lui arrachant des cris de douleur et d'incrédulité. Elle était allongée, les pieds en direction de l'ouest, vers la ville sacrée de La Mecque à près de deux mille kilomètres de là, marque d'irrespect totalement involontaire de sa part, dont l'un des passagers avait cru bon de la punir. Elle avait commis une erreur grossière en voyageant enveloppée de voiles à l'image des femmes du pays, dans l'idée que ce serait plus sûr. Si son visage avait été plus exposé, et la couleur de ses cheveux visible, peut-être lui aurait-on pardonné sa faute en sa qualité d'étrangère. En revanche, n'importe qui, même un enfant qui aurait pu être son fils, avait le droit de punir pour l'exemple une Afghane sacrilège.
Nadeem Aslam, La vaine attente
Je salue au passage, à défaut de pouvoir faire grand-chose d’autre sinon exprimer mon mépris et celui de toutes les femmes dignes de ce nom pour ceux qui font vivre en enfer depuis combien ?... un siècle ?... deux ?.... les femmes afghanes, dont une seule, voilée ou pas, vaut plus cher que tous les hommes impliqués mis ensemble, et ceci veut dire surtout nos «représentants», qui n’ont pas honte d’envoyer dans ce malheureux pays des jeunes gens des classes inférieures massacrer et se faire tuer pour satisfaire la volonté de puissance et la rapacité des maîtres qu’ils se sont et nous ont donnés.


Deux femmes attendant l'aube de leur exécution

Peu importe qui a tiré. Tous sont coupables. Et nous aussi de les laisser faire.
*
« Quoi que fassent les femmes, elles doivent le faire deux fois mieux que les hommes pour qu’on les trouve à moitié aussi capables qu’eux. Heureusement, ce n’est pas difficile. » Charlotte Whitton (1896-1975)
*
Quand on a eu la chance de ne pas naître afghane aujourd’hui ou cévenole au XVIe siècle; quand on a eu, comme moi, la chance rare d’avoir un père et des oncles que l’extrême misère avait rendus adultes avant l’âge et qui vous ont parlé d’égaux à égale quand on n’était pas plus haute que leurs genoux ; quand on a eu celle de naître en un endroit du globe et à un moment de l’Histoire où ne sont battues que celles qui le veulent bien, on ne peut qu’être pleinement d’accord avec ce qui suit :
Pas concernée par la lutte des sexes
par Aline de Diéguez
2004-04-05
Cher François,
Merci pour votre message et votre présence attentive. Je vous dois une lettre sur, non pas la lutte des classes, mais la « lutte des sexes », si je puis dire, puisque c'était l'objet de votre dernière grande lettre. En fait, je suis embarrassée, parce que plus j'y pense, plus je m'aperçois que je ne me sens pas concernée. J'ai l'impression d'avoir toujours fait ce que je voulais sans me soucier de mon sexe. Enfant, j'ai appris à réparer mon vélo comme les garçons, et à coudre comme les filles. Cela m'est resté : perceuse, scie électrique ne me font pas peur. etc. Du coup, je suis obligée de vous dire que je me sentais plutôt supérieure aux garçons de ma classe et je n'ai pas honte de dire que cela a continué à l'âge adulte. Je me suis aperçue que le seul obstacle est l'incompétence. C'est pourquoi j'ai toujours été acceptée favorablement dans une conversation sur la maçonnerie avec des artisans, dans une discussion sur le structuralisme au cours d'un colloque ou sur toute activité classée « féminine » que je ne méprise pas du tout. Si les femmes ne s'intéressent ni à la philosophie, ni aux découvertes scientifiques, et ne savent pas se débrouiller avec une installation électrique ou des problèmes d'ordinateur, elles n'ont finalement que la place qu'elles méritent.
Si « les femmes » veulent se faire reconnaître à égalité avec les hommes dans la société et au travail, il leur reste à retrousser leurs manches et à montrer ce qu'elles savent faire.
J'ai l'impression que je ne suis pas un bon exemple de la lutte pour la « libération » des femmes. Ne m'étant jamais sentie emprisonnée, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me libérer de quoi ce soit.
Très amicalement à vous
Aline
Aline de Diéguez
Est l’épouse du philosophe Manuel de Diéguez, et si on ignore tout de sa trajectoire personnelle, par une discrétion qui n’est pas de ce temps « people », on sait en revanche beaucoup de ce qu’elle pense, parce qu’elle le fait savoir sur un blog où non seulement elle écrit mais où elle dessine aussi le monde qui l’entoure, dont l’état ne lui plaît pas.
Victor Hugo a dit quelque part1 : « Tacite, qui attache aux tyrans leur règne au cou ». Il aurait pu le dire aussi d’Aline de Diéguez.
À titre d’exemple, une des choses les plus violentes que j’aie lues de longtemps est cet accrochage au cou de M. Mahmoud Abbas, le 30 octobre dernier, où la violence est d’autant plus meurtrière que la forme est plus policée :
http://pagesperso-orange.fr/aline.dedieguez/mariali/pales...
Chers internautes, vous ne perdrez pas votre temps à explorer le blog entier de cette dame qui sait réparer les vélos et qui sait aussi penser :
http://pagesperso-orange.fr/aline.dedieguez/mariali/somma...
Pour les images toutes seules, regroupées en carnets, c’est là :
http://no-war.over-blog.com/ext/http://anti-fr2-cdsl-air-etc.over-blog.com/ext/http://www.dieguez-philosophe.com/mariali
Mais j’aimerais plus spécialement attirer aujourd’hui votre attention sur ceci :
http://pagesperso-orange.fr/aline.dedieguez/mariali/picrochole/conspirateurs/conspirateur.htm
qui est de 2008, et sur ses développements d’aujourd’hui :
1ère partie
http://no-war.overblog.com/ext/http://pagespersoorange.fr...
2e partie
http://pagesperso-orange.fr/aline.dedieguez/mariali/chaos...
La 3e partie étant à venir.
Quand vous aurez lu - n’y manquez pas – vous vous apercevrez qu’il ne s’agit pas de plusieurs articles, mais d’UN livre d’Histoire, aussi informé qu’il est lucide et rigoureux, toutes qualités qui ne courent pas autant qu’on le croit les couloirs des officines de Clio.
Ce livre, en train de s’écrire sous nos yeux, m’a remis en mémoire une phrase de Leopold von Ranke, père de l’histoire scientifique européenne, à qui on reprochait des points de vues fort peu chrétiens dans son Histoire de l’Empire Ottoman, et qui répondit aux critiques : « Je suis historien avant d’être chrétien. Ce qui m’intéresse, ce sont les faits, la façon dont les choses se sont réellement passées. » Clio – Sainte Trinité : 1-0.
Internautes mes soeurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire, si vous ne voulez pas mourir idiotes.
*
Shministim
Chère Catherine,
Nous vous écrivons de Tucson, Arizona, après une incroyable première semaine de notre tournée aux USA. Jusqu’à présent, nous avons été accueillies très chaleureusement par tous nos hôtes, dans chacune des villes où nous sommes passées, de la région de San Francisco Bay à Honolulu, Hawaii !
Considérant les réactions suscitées par la politique d’Israël, nous nous attendions à devoir affronter une forte opposition à notre présence. Nous sommes heureuses que les désaccords qui se sont fait jour pendant nos discussions aient toujours été exprimés avec courtoisie et respect.
Nous devons dire que l’ouverture d’esprit avec laquelle nos propos ont été accueillis a été rafraîchissante, y compris dans une synagogue juive et sur un campus où règne généralement une grande tension à propos des problèmes que nous venions évoquer.
Nous espérons que ces échanges de vues stimuleront la discussion sur le conflit israélo-palestinien et sur le rôle qu’y jouent les États-Unis. Comme nous l’avons rappelé aux personnes venues nous entendre, « les dollars de vos impôts alimentent notre occupation ! ».
En solidarité,
Netta et Maya.
Maya Wind et Netta Mishly
à Staten Island, 2009
Cette lettre a été écrite, en septembre 2009, par Maya et Netta, à ceux qui avaient soutenu de façon ou d’autre leur initiative.
Explication :
En Israël, le service militaire est obligatoire pour les deux sexes dès l’âge de 18 ans. On appelle Shministim des étudiants du secondaire terminal qui refusent de servir dans l’armée israélienne, parce qu’elle occupe abusivement le territoire palestinien et y commet des crimes que le monde entier condamne2.
D’abord sporadiques et isolées, les lettres de refus de servir sont devenues concertées et collectives. On pense que cent jeunes à peu près – filles et garçons – ont signé celle-ci :
« Nous, signataires de cette lettre, jeunes israéliens d'écoles supérieures, déclarons vouloir nous opposer à la politique d'oppression et d'occupation menée dans les territoires occupés et en Israël. C'est pour cela que nous refusons de servir dans l'armée israélienne.
Ce refus signifie d'abord une protestation contre la politique de séparation, de contrôle, d'oppression et de meurtres menée par l'Etat d'Israël dans les territoires occupés, car nous comprenons que cette politique ne nous mènera jamais à la paix et contredit les valeurs fondamentales qu'une société se disant démocratique doit avoir.
Tous les membres de ce groupe croient en la valeur du travail social. Nous ne refusons pas de servir la société dans laquelle nous vivons, mais nous protestons contre l'occupation et les moyens d'action employés par le système militariste aujourd'hui: négation des droits civils, discrimination sur une base raciale et actions contraires aux lois internationales.
Nous nous opposons aux actions prises au nom de la "défense" de la société israélienne: postes de contrôles, assassinats ciblés, routes-apartheid réservées aux juifs, couvre-feu, etc... qui servent la politique d'occupation et d'exploitation, annexe plus de territoires occupés à l'Etat d'Israel et nie les droits de la population palestienne d'une manière aggressive. Ces actions sont un sparadrap posé sur une plaie saignante, et une solution limitée et temporaire qui aggrave les conflits.
Nous nous opposons au pillage et au vol des territoires et des sources de revenus des Palestiniens en vue de l'expansion des implantations [...] De plus, nous nous opposons à toute transformation des villes et villages palestiniens en ghettos privés des conditions minimales d'existence ou de source de revenus par la concstruction du mur de séparation.
Afin d'établir un dialogue effectif entre les deux sociétés, nous, la société aux fondations bien établies et plus forte, avons la responsabilité d'établir et de renforcer l'autre. C'est seulement avec un partenaire socialement et financièrement mieux établi que nous pourrons travailler à la paix plutôt qu'à des actes de vengeances unilatéraux. Plutôt que de supporter ces citoyens qui espèrent la paix, l'armée prend des sanctions, et pousse de plus en plus de gens vers des actes d'extrême violence et vers l'escalade.
[....]
Là où il y a des humains, il y a quelqu'un pour parler. Par conséquent, nous demandons de créer un dialogue allant au-delà de la lutte de pouvoir, de la vengeance et des actions unilatérales; de désapprouver le mythe du "pas de partenaire crédible" qui nous conduit à une situation perdant/perdant de frustration continue, nous demandons que l'on opte pour des méthodes plus humaines.
Nous ne pouvons pas détruire au nom de la défense, ni emprisonner au nom de la liberté. Par conséquent, nous ne pouvons à la fois agir moralement et servir l'occupation.
Les membres du "Shministim"
La peine qu’encourent ces jeunes objecteurs de conscience est de 21 à 28 jours de prison.
À la fin de leur peine, ils sont de nouveau appelés à faire leur service militaire. S’ils refusent une deuxème fois, comme la plupart le font, ils subissent à nouveau la même peine. Le processus peut être répété à l’infini si le gouvernement et l’armée le veulent.
Cela n’a l’air de rien, trois ou quatre semaines de prison à répétition, avec sorties entre les coups, surtout en comparaison de ce qu’endurent les Palestiniens, mais cette répression « démocratique » les empêche de poursuivre leurs études, de trouver un quelconque travail et de fonder une famille. Elle peut les en empêcher très longtemps.
En 2009, après le choc du massacre de l’opération « Plomb durci », un certain nombre de shministim ont décidé d’aller réveiller les consciences somnolentes dans quelques coins sourds-muets de sainte Communauté Internationale. Par deux ou par trois, tels des représentants en mission de la Première République ou des Sandinistes de 1990, ils ont pris leur bâton de pélerin et s’en sont allés « expliquer » de quoi il est question au juste et rappeler les responsabilités de chacun. Lourde tâche pour de jeunes épaules, car ces missionnaires, dressés depuis la naissance à être une nouvelle « Hitlerjugend » ont dû tout inventer et ne compter que sur leurs propres ressources intérieures, dès lors qu’ils ne sont pas restés sourds à ce que Jean-Jacques Rousseau appelait « notre étincelle de divinité » et James Joyce « agenbite of inwit »3 .
Tandis qu’un groupe de trois (deux filles et un garçon) s’en allait en Afrique du Sud, Netta et Maya, en collaboration avec les Américaines de Codepink, se lançaient dans un vaste tour des USA. Des vidéos de certaines de ces séances d’information et de discussion se trouvent sur Internet. Si vous savez vous y prendre, vous pourrez les y voir. Netta et Maya sont à présent rentrées chez elles, c’est-à-dire probablement dans une prison militaire.
Ce qui, moi, me ravit particulièrement chez ces jeunes gens, garçons et filles, c’est que dans un monde qui semble devenu la concrétisation cauchemardesque des théories d’Hélvétius, ils donnent raison à Rousseau.
Question oiseuse : Pourquoi rien de ce genre ne s’est-il produit en Europe ? L’«Union » n’a pas de collectifs féminins équivalents à Codepink ou quoi ?

Et Carlos Latuff est un grand dessinateur politique brésilien - http://latuff2.deviantart.com/
*
Quand un homme prend part à une révolution, on dit qu’il est un révolutionnaire.
Quand c’est une femme, on dit « bacchante de la Révolution ».

Dernière mais non des moindres,
... en un peu plus développé...
... car elle est d'ici...
... et j'ai un compte à régler.
Anne-Josèphe Terwagne,
dite Théroigne de Méricourt
Née à Marcourt (Ardenne belge) le 3 août 1762, morte à Paris (Salpêtrière) le 8 juin 1817.
Tout le monde croit connaître « la belle Liégeoise », dont les quelques inventions qui prétendent la définir courent le monde et les pseudo-livres d’histoire depuis deux siècles. Tout le monde sait que c’était « la panthère de la Révolution », « une tigresse assoiffée de sang » (avec une préférence pour celui de Marie-Antoinette), qu’elle s’habillait en homme et brandissait des sabres, qu’elle fut publiquement « mise nue et fessée » par des tricoteuses, qu’elle était folle et qu’il fallut l’enfermer. Ainsi s’exprime l’omniscient Ouy-Dire.
Anne Terwagne fait partie de ceux, nés sous une mauvaise étoile, dont le destin semble être de servir de paratonnerre à malheurs et à malfaisances humaines. Tels Job qui, au moins, y était pour quelque chose, puisqu’il croyait en Dieu.
Née d’une famille de laboureurs, c’est-à-dire de fermiers aisés (un peu comme Jeanne d’Arc, voyez...), elle eut le premier et déterminant malheur de perdre sa mère en bas âge. Son père se remaria. La belle-mère était acariâtre et prit l’enfant en grippe.
Commença pour elle, alors, le périple habituel des enfants de la D.D.A.S.S. : quelque temps chez une «marraîne » qui se lassa vite de jouer les éducatrices de substitution et la refila à un couvent de bonnes soeurs. Pour m’être moi-même enfuie à deux ans et demi d’un tel semi-internat, j’imagine sans peine... Elle s’enfuit, revint chez sa marraîne sans baguette ni citrouille, réessaya la maison paternelle qui se ferma comme une huître, et fut en fin de compte « placée » chez des semi-nobles, pour s’occuper de leurs enfants. Elle n’avait pas quinze ans.
La gamine, qui avait une jolie voix et encore beaucoup d’illusions à perdre, rêvait d’être cantatrice. Audacieux, en plein règne des castrats.
Or, vint à passer par là une dame fort sociable « qui avait fait les beaux jours de l’Oeil de Boeuf », entendez une ancienne prostituée, qui passait le temps désormais à tenir salon « entre Londres, Anvers, Bruxelles, Liège et Spa », entendez une espionne. Spa était alors ce qu’est aujourd’hui Dubai, et la «Querelle des Jeux de Spa » qui donna, en 1788, le coup d’envoi à la Révolution Liégeoise, y a été fomentée par des agents britanniques4 .
Si la protectrice de la future Méricourt avait connu son heure de gloire sous Louis XV, elle ne devait pas trop compter sur ses propres charmes pour attirer chez elle ceux à qui elle voulait tirer les vers du nez. Il lui fallait de la chair fraîche. Que se passa-t-il au juste ? Anne fut-elle cédée à sa nouvelle maîtresses par les anciens ? Leur demanda-t-elle la permission de quitter leur service (elle était mineure) ? « On » lui promit en tout cas de lui apprendre la musique et de l’initier au chant. C’était plus qu’il n’en fallait pour l’attirer comme un moucheron dans une toile.
Elle s’en fut donc avec sa nouvelle propriétaire et commença sa carrière de courtisane, pour laquelle il ne semble pas qu’elle ait été surdouée ni surtout très motivée. En revanche, elle n’apprit pas le chant d’opéra en dépit de ses nombreuses réclamations.
C’est à Londres, dans le salon de l’accueillante cosmopolite, dont il était un assidu, qu’elle rencontra un des hommes les plus sinistres de l’Ancien Régime et des deux suivants : Jean-François Perregaux, Suisse, banquier et espion à la solde de l’Angleterre, après l’avoir été à celle de la Société Typographique de Neuchâtel.
Dès lors, son destin était scellé. Les deux Thénardiers allaient y pourvoir à un point qu’elle n’a sans doute elle-même jamais soupçonné.
Avant de poursuivre et en guise de commentaire latéral à l’étude de Madame de Diéguez sur la Fed, je me permets de rappeler que « la banque dite de France » (l’expression est d’Henri Guillemin) fut en réalité une banque privée, dont la France eut le privilège d’engraisser les actionnaires. Elle fut comme on sait créée par Napoléon, qui, n’étant pas ingrat, mit à sa tête celui qui avait sponsorisé son coup du 18 Brumaire an VIII : Perregaux. Lequel était toujours le loyal agent de William Pitt et allait rester celui de ses successeurs. Pour mémoire... Coup d’état : 19 novembre 1799 – Création de la « Banque de France » : 18 janvier 1800.
Revenons en arrière et à notre Théroigne. Dans le salon de sa protectrice, elle fit la connaissance d’un jeune aristocrate anglais, héritier d’une riche famille mais aussi mineur d’âge qu’elle, et ne disposant donc ni de sa fortune ni de son libre arbitre. Il la séduisit, et lui promit le mariage « dès que... ». Cette promesse n’engagea qu’elle, qui en tomba enceinte et accepta de fuir pour le suivre. Il la mit dans ses meubles, lui offrit des bijoux fastueux – les usuriers prêtaient volontiers aux jeunes sots avec « des espérances » - et en attendant sa majorité, se lança dans une vie de débauche, où les moeurs à voile plutôt qu’à vapeur ne manquèrent même pas. Est-ce pour qu’il échappe à l’exemple paternel qu’elle mit son enfant en nourrice en France ou pour toute autre raison ? Je ne sais. Elle finit par s’enfuir du bouge où elle était moins chez elle que les comparses de son futur et fit la connaissance d’un vieux gentilhomme qui lui promit, par écrit, de lui servir toute sa vie une rente. Contre quels services ? Allez savoir, car aussitôt, elle se mit, sans lui, en route pour l’Italie, dans l’idée fixe d’apprendre le chant d’opéra. Elle semble avoir eu un flair incomparable pour attirer à elle les personnalités les plus pourries... ou est-ce qu’elles pullulaient alors tellement qu’il était impossible à quelqu’un de désemparé de les éviter ? Le castrat – célèbre – à qui elle demanda des leçons, non seulement ne les lui donna pas mais se débrouilla pour la tondre.
Entretemps, son enfant, né de santé fragile, était mort chez sa nourrice.
C’est alors qu’il ne fut bruit partout que de la convocation des États-Généraux et qu’à l’instar de Philippe Buonarrotti, elle s’enflamma et s’en fut là où allaient se passer les choses.
De moeurs austères quoi qu’on en ait dit dans les sentines de l’aristocratie, elle tint à Paris table ouverte et nourrit, jusqu’à s’en ruiner, des gens bien plus riches qu’elle. Mais, incapable de se contenter de son salon, comme une Manon Roland ou une Germaine de Staël, c’est en fille du peuple qu’elle se lança dans les affaires publiques. Elle savait lire, écrire et un peu de solfège. Elle jouait joliment du clavecin aussi. Pratiquement autodidacte, elle avait en politique de l’instinct, mais aucune culture qui lui eût permis de s’orienter dans une jungle où beaucoup d’hommes se perdirent. Elle ne sut pas faire le tri, dans ses invités à la rhétorique identique, entre ceux qui parlaient pour essayer de se faire comprendre et ceux qui le faisaient pour, surtout, n’être pas compris. De ces derniers étaient Sièyes, Brissot, Camille Desmoulins, Marie-Joseph Chénier, Anacharsis Cloots, Fabre, Momoro et quelques autres par qui, pour son malheur, elle se laissa hypnotiser. Saint-Just, qui soupa quelquefois chez elle, finit très vite par s’en abstenir, ne voulant pas se commettre avec des hommes dans lesquels il avait reconnu, dès l’abord, des ennemis rédhibitoires.
C’est une des caractéristiques de l’histoire de Théroigne de Méricourt : ses mauvaises relations et l’intégrité qu’au milieu des pires compagnies elle garda toujours.
Gobant les beaux discours dans son logis, elle les traduisit au dehors par des initiatives qui ne tardèrent pas à faire d’elle, pour ces bourgeois ambitieux, une redoutable emmerdeuse, voire un danger public, et ses pique-assiettes ne firent jamais grand-chose pour empêcher les Actes des Apôtres et autres follicules aristocrates de la traîner dans la boue et de la calomnier de toutes les manières possible, de préférence les plus basses.
Échantillon (ce sont les Goncourt qui parlent) :
« Que d’applaudissements ! Mais aussi quels rires dans la presse royaliste ! Quelle proie que « la Muse de la démocratie », que cette « Vénus donnant des leçons de droit public » pour les moqueries et les huées ! Rivarol, Peltier, Champcenets, Suleau, Marchand, ne tarissent pas d’ironies, de soufflets, de gorges-chaudes et d’ordures. Que de gros esprits et de goguenardises salées ! Un pamphlet la loge rue Trousse-vaches. Les Sabats jacobites donnent « Le boudoir de Mademoiselle Théroigne, Intermède civique.- » -– On voit, sur une espèce de toilette, un pot de rouge végétal, un poignard, quelques boucles de cheveux éparses, une paire de pistolets, l'Almanach du père Gérard, une toque, la Déclaration des droits de l'homme, un bonnet de laine rouge, un peigne à chignon, une fiole de vinaigre de la composition du sieur Maille, un fichu fort chiffonné, la Chronique de Paris et le Courrier de Gorsas. On aperçoit dans le fond un lit de sangle décoré d’une paillasse qui sert de lit de repos à la belle patriote et à ses nombreux adorateurs. À côté de la paillasse est une pique énorme, près de laquelle on voit un superbe habit d’amazone de velours d’Utrecht. Le boudoir est orné de plusieurs tableaux agréables, tels que la Prise de la Bastille, la Mort de MM. Foulon et Berthier, la Journée du 6 octobre 1789, l’assassinat juridique de M. de Favras, les meurtres commis à Nîmes, Montauban, etc., la Glacière d’Avignon et autres jolis massacres constitutionnels. Mademoiselle Théroigne est dans le négligé le plus galant ; elle a des pantoufles de maroquin rouge, des bas de laine noire, un jupon de damas bleu, un pierrot de bazin blanc, un fichu tricolore et un bonnet de gaze couleur de feu surmonté d’un pompon vert.» Les Actes des Apôtres régalent leurs lecteurs de Théroigne et Populus ou le Triomphe de la démocratie, drame national en vers civiques. Le Petit Gautier l’appelle « charogne ambulante ».
C’est que Théroigne portait une idée : elle était, dans la Révolution, le parti de la femme. Dans le déchaînement de la Liberté, elle appelait la femme à l’émancipation, à l’usurpation. Elle demandait que le civisme lui fît des devoirs, l’héroïsme des droits. Elle voulait hautement, et la première, faire sortir son sexe du ménage, pour le faire entrer dans la patrie. »
L’histoire détaillée de toutes les propositions qu’elle fit, des concours qu’elle obtint, de ceux qui la soutinrent puis la lâchèrent, reste à faire.
*
Je me contenterai d’évoquer ici une des péripéties les plus mal connues de sa carrière météorique.
En juin 1790, elle quitte Paris par la diligence pour se rendre à Liège :
« Je me plaisais beaucoup à Paris, mais je n’avois plus d’argent pour y rester et j’étois pourtant toujour chargée de tous mes frères que je ne voulois point abandonner. On ne payoit point ma rente de 5000 livres et je ne savois quand on me la payerois, j’avois anticipés sur ma rente de mille écus à peut près pour deux ans et mis tous mes diamans en gages5, je devois déjà beaucoup; je n’avois plus qu’un collier et 25 louis d’un derniere bague, que j’avois engagée pour vivre, moi et ma famille, payer la pension d’un de mes frères que je laissai à Paris pour continuer d’apprendre la peinture auprès de M. d’Avit ...6 ».
Elle rentre dans son village où elle est ravie de retrouver ses amies d’enfance, mais elle ne peut s’empêcher, en cours de route, à Liège, à Saint-Hubert, à Marcourt, de parler révolution, justice, égalité, droits du peuple. Aux Français qu’elle rencontre, elle demande de quel parti ils sont, pas toujours très prudemment. Devant un ancien dragon autrichien de son village, elle déblatère contre les rois et manque passer un mauvais quart d’heure. Le bruit commençe à courir qu’elle est chargée par les révolutionnaires français de soulever le pays. Un de ses frères vient la voir et la conduit au village de la Boverie, près de Liège, où il lui a trouvé un logement pas trop ruineux (sa rente ne vient toujours pas et son banquier – Perregaux - ne semble pas répondre à ses lettres). Mais ses allées et venues au Pays de Liège, dûs à ses soucis d’argent, provoquent la méfiance du Comte de Mercy Argenteau, plénipotentiaire aux Pays-Bas Autrichiens (Bruxelles), qui écrit le 6 février 1791 au chancelier Kaunitz :
« Il nous arrive des prédicateurs... le nommé Cara7, ennemi de toute autorité est dans le pays, je le fais guetter... On m’annonce aussi la nommé (sic) Théroigne de Mericourt qui était à la tête des assassins de la Reine dans les journées des 5 et 6 octobre ; elle doit se trouver dans la province de Luxembourg et entretenir des correspondances avec nos enragés, avec ceux de Paris et de Liège. Un Français, muni de bonnes lettres de recommandation, est venu me demander permission de l’enlever secrètement, elle et ses papiers : j’y ai donné les mains et j’en fais soutenir l’expédition par une escouade de la Maréchaussée. Si la capture se fait, on la conduira à Fribourg pour y attendre ce qui sera décidé à son égard. ».
Les stratèges de la CIA croient peut-être avoir inventé les extraordinary renditions et les black sites...
Dans la nuit du 15 février, deux émigrés, le chevalier Maynard de la Vallette8 et le comte de St. Malou frappent à la porte de l’auberge de la Croix Blanche, à la Boverie. – « Au nom de S.M. l’Empereur, ouvrez » ! Ils s’introduisent dans la chambre de Théroigne, la persuadent de se lever et de s’habiller, car elle est sous le coup d’une arrestation. Ils s’emparent bien entendu de ses livres et de ses papiers, et fouette cocher ! Ils essayent en route de lui faire avouer qu’elle a pris part à un complot contre la Reine, mais ils en sont pour leurs frais.
Kidnappeurs et prisonnière arrivent à Fribourg en Brisgau le 25 février (dix jours de route) et la voilà enfermée à l’auberge du Nègre, pendant que le commandant de la place demande des instructions à Vienne. Ordre lui est donné de la conduire à la forteresse de Kufstein, dans le Tyrol. Elle y arrive le 17 mars. Elle n’y est pas mise au cachot mais dans une chambre fort honnête. Elle est correctement nourrie et on lui laisse les trois livres qu’elle a pu emporter en dépit de ses ravisseurs : Sénèque, Platon et l’Abbé Mably. Elle obtient même la jouissance d’un piano. Ce qui la contrarie le plus dans cette aventure, c’est de n’avoir pu renouveler ses engagements aux Monts de Piété de Paris et de Liège et d’avoir ses bijoux vendus à vil prix. Perregaux étant toujours aux abonnés absents, son ancien maître (celui dont elle élevait les enfants), le baron de Selys Fanson, lui vient en aide : il dégage un collier à Liège et prête diverses sommes à son frère.
C’est seulement le 28 mai que M. de Plank, conseiller aulique, arrive à Kufstein pour l’interroger. Il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que cette jeune femme n’a commis aucun délit, et en conclusion de son enquête, il conseille au gouvernement impérial de la remettre en liberté.
Cela ne fait pas l’affaire du chevalier Maynard de la Valette, qui voit sa prime de prise lui échapper et qui soutient mordicus qu’il a mis la main sur une dangereuse conspiratrice. Il vient à Kufstein, armé d’un dossier de sa confection, qu’il a intitulé « Dires et aveux de demoiselle Théroigne » où il est révélé qu’elle est à la solde des Jacobins et a pour mission de propager les idées révolutionnaires dans les Pays-Bas. Elle y est aussi accusée d’avoir comploté avec Mirabeau, ainsi qu’avec les ducs d’Orléans, de Liancourt et de Broglie, car à quoi bon lésiner. M. de Plank organise une confrontation entre l’accusée et l’accusateur et en retire la certitude que c’est ce dernier qui ment. Elle n’a pu connaître aucun des personnages qu’il invoque.
En août 1791, sous une identité d’emprunt, elle quitte Kufstein en la garde du conseiller, pour être conduite à Vienne, où on la loge chez un bourgeois. Un de ses oncles d’Allemagne, Campinado, qui est banquier, vient la voir et use de son influence pour qu’elle puisse être entendue par le Chancelier Kaunitz., et ensuite, par l’empereur Leopold lui-même. Les deux hommes, après l’avoir interrogée longuement, lui rendent sa liberté, avec une somme d’argent nécessaire à son retour à Liège.
Le 15 décembre 1791, le Journal général annonce ainsi sa libération : « La crapuleuse créature qui se fait appeler Théroigne de Méricourt est maintenant à Bruxelles. Elle s’est présentée chez le respectable ministre de Metternich9. Sa barbare audace n’a pas diminué dans les prisons d’où elle sort ; l’apparition de cette charogne ambulante indigne tous les honnêtes gens de ce pays. Elle loge à l’enseigne de « l’homme sauvage », qui jamais ne fut aussi sanguinaire qu’elle. »
À Paris, une loi d’amnistie a été votée le 15 septembre, qui lui permet de rentrer sans crainte en France et, le 28 janvier, elle est reçue en triomphe aux Jacobins.
Pendant sa détention, il lui avait été demandé de mettre sa défense ou auto-justification par écrit. C’est ce qu’elle a fait. Cette « confession », comme on l’appelle, écrite au crayon sur du papier qui a mal vieilli, se trouve aux Archives de Vienne. En 1892, M. Strohl-Ravelsberg l’a publiée, en tout ou en partie, sous le titre Les confessions de Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise confessions, dont le baron Camille Buffin a plus tard prélevé des extraits pour les publier dans ses Récits d’hier et d’aujourd’hui. C’est là que j’ai lu le peu que je connais de cette plaidoirie, qui m’a donné la très forte envie de publier (ou republier) la totalité du document. Il y a quelques années, une âme généreuse, de passage à Vienne, m’a fait parvenir l’intégralité de ce document sur micro-film. Les machines à lire les micro-films ne courant pas les rues de mon trou provincial et le nerf de la guerre manquant, ce texte intégral attend toujours d’être décrypté. Mea culpa.
_____________
Paris 1792 – 1793 – 1794...
Les choses s’envenimaient, entre les Jacobins et ses amis. Juin 1793 vit la chute des girondins et de ce Brissot, qui l’avait tant influencée. Elle prit la précaution - sur quels conseils ? - de se faire admettre dans une clinique psychiatrique. Cela se fit beaucoup alors dans les milieux contre- anti- ou hérético-révolutionnaires, où l’on jugea expédient de se soustraire aux possibilités d’une guillotine en se faisant admettre dans la villa bien protégée de quelque aliéniste de renom. Il suffisait d’en avoir les moyens : les certificats de complaisance coûtaient cher mais valaient bien leur pesant d’assignats. Théroigne fut donc «internée».
Au bout d’un temps, soit qu’elle crût la voie libre, soit qu’elle n’y tînt plus, elle sortit. Et ne mit pas longtemps à se faire arrêter. Il n’y fallait pas grand-chose, les temps étaient troublés et le cabinet de Saint-James avait graissé les pattes qu’il fallait pour que fût extraite des prisons (Danton étant ministre de la Justice) toute une pègre de droit commun, qui ne chôma pas à dénoncer à tours de bras n’importe qui dans tous les sens, le but étant de « déstabiliser » la République, selon l’euphémisme actuel. Non, ce qui se passe en Iran n’est pas nouveau non plus.
Théroigne, donc, fut arrêtée et – c’est une hypothèse personnelle – prit en prison la mesure de ses erreurs de jugement. De se retrouver gardée peut-être par des gens de sa classe, au milieu d’autres dont elle s’était crue l’égale ? Qui le sait... C’est de là qu’elle écrivit la fameuse lettre à Saint-Just, que tout le monde, depuis deux siècles, s’obstine à décréter « lettre de folle ». Or, cette lettre n’est pas plus insane que n’importe quel appel à l’aide envoyé par quelqu’un ne disposant pas de sa liberté et craignant ceux qui l’entourent – une première lettre étant restée sans réponse - à quelqu’un d’autre censé comprendre, à mots couverts, s’il y est fait allusion à des choses que seuls les deux correspondants peuvent connaître. Les archives et la littérature sont pleines de telles lettres, envoyées de tous temps et en tous lieux, par des prisonniers, des résistants, voire des pensionnaires, à d’hypothétiques sauveurs. Mais il est tellement plus facile d’appeler divagation ce que l’on ne comprend pas, et la race des moutons de Dindenault n’est pas éteinte.
Il est d’ailleurs facile d’en juger, car la voici. Il n’y a pas dans cette lettre un mot qui permette de conclure à la folie (l’orthographe a sans doute été corrigée par M. Laport) :
« Citoyen Saint-Just, je suis toujours en arrestation. J’ai perdu un temps précieux. Je vous ai écrit pour vous prier de m’envoyer deux cents livres et de venir me voir ; je n’ai reçu aucune réponse. Je ne sais pas beaucoup de gré aux patriotes de me laisser ici, dénuée de tout. Il me paraît qu’il ne devrait pas leur être indifférent que je sois sans rien faire. Je vous ai envoyé une lettre où je dis que c’est moi qui ai dit que j’ai eu des amis jusque dans le palais de l’empereur, que j’ai été injuste à l’égard du citoyen Bosque, mais que j’en suis fâchée. On m’a dit que j’avais oublié de signer cette lettre, c’est défaut d’attention. Je serais bien charmée de vous voir un instant. Si vous ne pouvez venir où je suis, si votre temps ne le permet point, ne pourrais-je point me faire accompagner jusque chez vous ? J’ai mille choses à vous dire. Il faut établir l’union. Il faut que je puisse développer tous mes projets, continuer d’écrire ce que j’écrivais. J’ai de grandes choses à dire. Je puis vous assurer que j’ai fait des progrès. Je n’ai ni papier, ni lumière, ni rien ; mais quand même il faut que je sois libre pour pouvoir écrire ; il m’est impossible de rien faire ici. Mon séjour m’y a instruite, mais si j’y restais plus longtemps, si je restais plus longtemps sans rien faire, sans rien publier, j’avilirais les patriotes et la couronne civique. Vous savez qu’il a été question de vous et de moi, et que les signes d’union demandent des effets. Il faut beaucoup de bons écrits qui donnent une bonne impulsion. Vous connaissez mes principes. Je suis fâchée de n’avoir jamais pu vous parler avant mon arrestation. Je me suis présentée chez vous. On me dit que vous étiez déménagé. Il faut espérer que les patriotes ne me laisseront pas victimes de l’intrigue. Je puis encore tout réparer si vous me secondez. Mais il faut que je sois où je serai respectée, car on ne néglige aucun moyen de m’avilir. Je vous ai déjà parlé de mon projet. En attendant que cela soit arrangé, que j’aie trouvé une maison où je serai à l’abri de l’intrigue, où je serai dignement entourée de la vertu, je demande qu’on me remette chez moi. Je vous serais mille fois obligée de me prêter deux cents livres.
« Adieu. !
Théroigne ».
Lettre enfiévrée sans doute. Projets irrationnels peut-être, utopiques en tout cas, mais elle en avait fait déjà, qui nous paraîtraient entachés de naïf idéalisme aujourd’hui, et qui furent pourtant, pour certains, signés « Marie-Joseph Chénier, Gilbert Romme, Théroigne, David, Hion, etc. »
Quant à avoir les nerfs à vif, elle ne fut pas la seule, et de loin. Ce même Saint-Just à qui elle écrit n’a-t-il pas, moins de huit jours après avoir décrété que « l’avenir est aux flegmatiques », dans une altercation avec Carnot, piétiné et jeté au feu son chapeau ?
Ce qui touche ici au ricanement sardonique des dieux de la tragédie, c’est que Saint-Just ne reçut jamais cette lettre, puisque, au moment où elle lui était envoyée, il avait les mains attachées et attendait l’aube de son exécution.
Anne Terwagne survécut à Thermidor, mais ceux de ses anciens amis qui n’étaient pas morts avaient d’autres chats à fouetter : ils touchaient enfin au pouvoir, et ce pouvoir n’aurait que faire d’égalité, de vertu ou de justice. Il lui restait des bijoux en gage et le lancinant problème de la fameuse « rente Persan » qui n’arrivait plus depuis si longtemps, jamais envoyée ou détournée.
Laurent-François Dethier, avocat et géologue, père spirituel de la Révolution Franchimontoise - qui fut une expérience radicale très peu connue - et député du département de l’Ourthe sous le gouvernement français, a écrit d’elle : « ...elle fut enfermée comme folle sous le gouvernement consulaire dans une maison de force où elle est morte ».
« Comme folle » ? et « Sous le gouvernement consulaire » ? Dethier n’a jamais parlé pour ne rien dire et pesait ses mots. Rien, aucune pièce indiscutable ne prouvant qu’elle était folle au moment de son internement, on pourrait penser qu’elle gênait Bonaparte, lequel n’a jamais fait le moindre sentiment quand il s’est agi de se débarrasser d’une ou de très nombreuses personnes.
Mais le baron Buffin (dont j’ignore les sources) raconte, au début du XXe siècle, une autre histoire :
« D’après un décret du Comité révolutionnaire de la Section Le Peletier, elle fut arrêtée le 27 juin 1794 et enfermée dans la maison sise rue Laloy, 278. » C’est juste un mois avant sa lettre à Saint-Just. Sur quelles bases le décret ? Ou sur quelle dénonciation ?
« Le 30 juin suivant, (soit trois jours plus tard) Joseph Terwagne (qui dépendait d’elle pour sa subsistance) demanda au tribunal du 1er arrondissement de Paris la réunion d’un conseil de famille pour donner son avis sur la nominationn d’un curateur à Anne-Josèphe sa soeur, incapable de gérer ses biens (c’est moi qui souligne) par suite de son état de démence. »
Quelle suite fut réservée à cette demande ? Qui fut le curateur s’il y en eut un ? Que signifie cette démarche ?
- tentative de sauver sa soeur de l’échafaud en la faisant passer pour folle ?
- tentative de mettre ses biens à l’abri de la confiscation, pour le cas où elle serait condamnée ?
- manoeuvre conjointe à celle de l’arrestation ?
Demande-t-on souvent l’internement de quelqu’un qui vient de se faire arrêter ?
Nous ne savons, dans cette affaire, qui est qui et qui fait quoi. Seuls Anne et Joseph sont dans la lumière. Qui se tient dans la coulisse ?
« Le 20 septembre (trois semaines après sa dernière lettre et la mort des robespierristes) l’officier de santé de la section Le Peletier constate l’aliénation de Théroigne. (Qui l’officier ? Compétent ? Pas compétent ? Intègre ? Corruptible ? De quelle faction ?) Elle est placée dans une maison de santé du Faubourg Marceau, (Privée ? Cette question !) puis transférée successivement en 1797 à l’Hôtel-Dieu, en 1799, à la Salpêtrière, enfin le 11 janvier 1800 aux Petites Maisons, où elle resta jusqu’à son retour à la Salpêtrière le 7 décembre 1807. »
Si cette chronologie était la bonne, alors, Anne aurait été arrêtée un mois avant Thermidor pour des motifs inconnus, et ne serait sortie de sa prison que pour être internée. Définitivement.
Dans ce cas, toutes les descriptions de son état – le tapage, l’auto-enfermement dans une mansarde, le refus de voir quiconque, le scandale public, les plaintes des voisins et l’intervention de la maréchaussée forçant pratiquement un malheureux frère, dépassé, à demander qu’on la mette en lieu sûr – ne seraient qu’affabulation et rien d’autre. Le fait est qu’aucun historien que je connaisse n’a jamais produit le moindre petit procès-verbal de police, qui eût sanctionné des faits, une bonne fois pour toutes.
Il y a des benêts qui croient que Staline a inventé l’enfermement psychiatrique des opposants. Il y en a d’autres qui préfèrent ignorer qu’il existe des motivations pas nécessairement politiques aux internements abusifs, la cupidité étant le plus courant. Il y en a même qui croient qu’il n’y a pas d’internements abusifs du tout. Et il y en a qui ignorent qu’il y a, en Belgique, au début du XXIe siècle, bien plus de fous en prison, évidemment sans soins, que de prisonniers à l’asile. Les moeurs politiques vont et viennent.
De l’état réel d’Anne, du 30 juin 1794 à sa mort, nous n’avons que les descriptions qu’en a laissé « le grand aliéniste Esquirol ». On sait ce qu’était alors un grand aliéniste. On sait surtout qu’il avait, sur ses «délirants» autant de pouvoir que Dieu et je ne sache pas que personne ait jamais mis en cause les traitements – quels qu’ils fussent – appliqués (infligés ?) à ceux qu’il faut bien appeler leurs prisonniers par « les grands aliénistes ». Celui-là était monarchiste10. Il a tenu à sa merci, pendant près de deux décennies, « la charogne ambulante » qui avait voulu boire le sang de la Reine.
Ce ne sont pas des conclusions que j’énonce, ce sont des données du problème. Un problème jamais posé et par conséquent jamais résolu.
Tout ce dont nous pouvons êtres sûrs, c’est qu’une femme de 32 ans fut internée sans son consentement (car « incapable de gérer ses biens par suite de son état de démence »), état constaté par un seul officier de santé de la section Le Peletier, d’où avait émané, quelques jours plus tôt, l’ordre de l’arrêter; nous sommes sûrs qu’elle le fut sur demande écrite d’un de ses demi-frères, qui ne savait ni lire ni écrire ni signer (il signa d’une croix), et que la demande fut rédigée par son propre banquier, lequel avait avancé au demi-frère de quoi s’établir blanchisseur.et pouvait, s’il voulait, lui en réclamer restitution immédiate. Le banquier s’appelait Perregaux. Il allait, cinq ans plus tard, avec la bénédiction de ses employeurs britanniques, financer un regime change, dont le bénéficiaire le remercierait, après un délai décent de deux mois, en le nommant gouverneur d’une banque pseudo nationale, grâce à laquelle les Français auraient le droit de lui rembourser, avec usure, sa mise de fonds.
Le problème particulier d’Anne Terwagne ne peut être posé qu’en n’oubliant pas que l’internée possédait un certain nombre de bijoux de prix encore en gage dans divers Monts de Piété, lorsqu’elle est sortie de la nébuleuse de sa « rente Persan » évanescente pour entrer dans la nuit. Que ces bijoux aient constitué une fortune d’un certain poids au moment où elle en fut dépouillée est attesté par les nombreuses et de plus en plus anxieuses lettres qu’elle écrivit à l’homme qu’elle avait chargé de la défense de ses intérêts, y exprimant sa crainte que ses diamants fussent vendus à vil prix si elle ne les dégageait à temps, alors qu’était si grand le besoin qu’elle en avait pour soutenir l’existence » de ses demi-frères.
Deux exemples à trois ans d’intervalle :
Gênes, 9 mars 1789
Monsieur,
« Je vous suis très reconnoissente des peines que vous vous êtes donné, pour me faire payer de Mr de Persan.
«Je joint mon sertifiqua de vie bien en forme, afin qu’il ne puisse plus trouver de détour, est que vous puissiez, en qua du moindre retar à me payer les six moins échus et ceux qui vont échoire le mois d’avril prochain, que vous soiez en droit, dis-je, d’en agir avec riguer pour le forser à s’acquiter avec moi toutes de suite.
« Je vous suis fort obligée, monsieur de la bonté que vous avez de me permete de tirer sur vous, en attendant que je sois payée, je vous prie donc d’envoyer une traite de cent loys à votre correspondant à Genes avec ordre de payer M. Dourazzo, et de me donner le reste pour mon voyage jusquj’à Rome, et en meme temps il seroit à propos que vous eussiez la bonté de m’envoyer une lettre pour votre correspondant à Rome par qui vous me ferez tenir là mon argent quand je serai payée.
« A l’égard de mes diaments, je les enverrai chez vous, quand je serai à Rome, et vous les garderai jusqu’à ce que mes talents me permete de retourner en Angleterre.
« Si vous voulez avoir la bonté de m’envoyer des lettres de recommandation pour Rome et pour Naples, ou je conte aller quand j’aurai resté à Rome quelque temps, je vous aurai infiniment d’obligation, j’écrirai également à Mr Hammerslys de m’en envoyer. Il m’a déjà recommandé à sont correspondant à Genes ; je lui dois beaucoup à cause de toutes les marques d’estime qu’il m’a donnée ; j’ai eu l’honneur de diner hier avec votre ami le consul anglois qui, à votre considération, m’a toujours fait beaucoup de politesse depuis que je suis à Genes.
« Je vous demande pardon de tant vous annuyer. J’ai cependant encore autrre chose à vous demander. J’ai imaginé que vous pouriez me rendre ce servisse. Cela me seroit d’autant plus agréable que je n’aurai pas besoins de recourir au servisse de mes prétendus amis.
« Je suis venue en Italie pour chanter et étudier : j’ai conduis avec moi mes trois frères, l’un étudie la peinture et les deux autres le commerce. Comme je suis obligée de toujours voyager, je voudrois établir l’aîné à Liège, où nous avons des parans qui sont dans le commerce. J’aurai besoin de trois mille livres ou trois mille livres et demis pour acheter une plase de controleur à mon frère aîné, afin que le revenu de cette petite plase fournise à ces besoin pandant qu’il étudiera dans un contoire.
« Cependant je fait reflexion que si je mourois vous perderiez votre argent, je voudrois rendre service à mon frère et je suis assez embarasée, si vous vouliez seulement les avanser pour un ant, vous les retienderiez chaque six mois la moitiez avec les ainteret et vous seriez entièrement remboursé à conter du mois prochain dans un ant. Si vous vouliez faire cela pour moi avec les ainteret et je vous assure que je vous serois fort obligée, j'an aurai priez Mr Hammerslys, mais comme mes revenu sont en Frence j'ai crus qu'il étoit plus simple de vous en faire la proposition. Je vous prie de me faire réponse à cette egard par le même couryer. Par que je ne prendrai aucune résolution sant savoir vos sentiment.
« Votre servante
« Anne Josephe THEROIGNE
« je vous prie d'adresser votre réponse au consul anglois votre correspondant à Genes. »
5 janvier 1792
Monsieur,
« A présent que je suis libre, je suis sûre que je puis aller où je veux : si je suis contente de la justice de l’empereur, je dois aussi dire que, pendant tout le temps de mon injuste détention, on m’a traitée avec douceur.
« Quant à vos aristocrates , ils ont employé les moyens les plus ba, les intrigues les plus infâmes pour tacher de me faire perdre la liberté pour toujours. Je vous assure que, s’il n’avait tenu qu’à eux, je serais encore dans la forteresse de Kufstein. Des chevaliers français tel est le caractère.
« Je vous serais obligée, Monsieur, de m’envoyer de l’argent, trente louis que vous échangerez à Paris. Si vous n’avez que des assignats, j’y perdrai moins qu’ici. Je vous prie en grâce de m’envoyer ce que je vous demande par le même courrier, car je n’ai plus un liard pour payer mon logement, ni ma pension. Vous adresserez votre réponse poste restante Bruxelles.
« En attendant, je suis avec estime, Monsieur, votre servante.
Théroigne ».
Quel homme de finance n’aurait pu tourner autour de son petit doigt avec la plus grande facilité un jeune paysan illettré qui n’avait jamais été capable d’assurer sa propre subsistance et qu’affolait la perspective de perdre sa planche de salut ?
Quoi, un banquier faisant interner une de ses clientes, victime de ses détournements ? Ces choses-là n’arrivent pas, voyons !
Je ne dis pas qu’elles se sont passées ainsi. Je dis que personne ne s’est jamais soucié de connaître la vérité à la manière de von Ranke, sur la fin d’une femme qui, à tous égards, méritait autre chose. De ses contemporains et de la postérité.
Une consoeur postmoderne du Dr.Esquirol a écrit tout un livre sur « le cas » Théroigne de Méricourt. Louable intérêt. Elle a juste omis de s’assurer au préalable que sa patiente souffrait bien d’une quelconque pathologie au moment de son internement. Ah, oui, la fameuse fessée... Une des fables les plus prisées veut que Théroigne ait été un jour, dans la rue, troussée et battue de verges par des tricoteuses, puis sauvée in extrémis (de quoi ?) par Marat. Le choc aurait été trop fort pour elle, d’où sa folie, etc. etc.
Ah, oui, la fameuse fessée... Une des fables les plus prisées veut que Théroigne ait été un jour, dans la rue, troussée et battue de verges par des tricoteuses, puis sauvée in extrémis (de quoi ?) par Marat. Le choc aurait été trop fort pour elle, d’où sa folie, etc. etc.
Elle y aurait mis le temps : Marat était mort depuis un an. Arrêtons de prendre les désirs de ces Messieurs pour des lanternes. Les femmes du peuple n’ont jamais fessé publiquement personne. Ce sont les Muscadins qui l’ont fait.
Rappelons qu’en Thermidor An II, la Terreur Blanche faisait rage depuis de nombreuses semaines ; qu’en province, des bandes armées s’attaquaient aux républicains et qu’à Paris, les Muscadins, au costume extravagant hautement symbolique, dont la pièce maîtresse était le gourdin, s’attaquaient courageusement et en bandes eux aussi, aux épouses des représentants jacobins qui avaient eu l’imprudence de sortir de chez elles, pour les trousser et les fesser en effet.
 En d’autres termes, ils tenaient la rue, un peu à la manière de leurs descendants de celle d’Assas à Paris au début des années 1960 et à la fin des années 1980. Même cheptel, mêmes méthodes. « Musc & gourdins... Muscadins ! », dit-on joliment chez CanalMythos11.
En d’autres termes, ils tenaient la rue, un peu à la manière de leurs descendants de celle d’Assas à Paris au début des années 1960 et à la fin des années 1980. Même cheptel, mêmes méthodes. « Musc & gourdins... Muscadins ! », dit-on joliment chez CanalMythos11.
Si Théroigne a été fessée dans la rue, ce dont je doute, car elle sortait rarement seule, c’est par quelques courageux contre-révolutionnaires. Elle n’aurait fait que partager ainsi le sort de maintes femmes respectables, et elle en avait vu d’autres. Les monarchistes au gourdin leste et à la conscience élstique, elle connaissait, merci, elle sortait même d’en prendre. Il n’y avait pas là de quoi devenir folle, sinon de rage. En aucun cas de mélancolie. Ah, la mélancolie, si à la mode alors chez les aliénistes... Reste la question que personne n’a osée : Kidonkéfou ?
Quant à ce qu’ont dit d'elle Messieurs les hommes, de Suleau à ses ravisseurs et de Lamartine à Ghelderode, c’est à couper le souffle : un seul et même fantasme ! Résignons-nous-y Mesdames, l’imaginaire des mâles en matière de nous est désespérément privé d’originalité. Je ne vais pas ici enfiler ces perles, ce serait fastidieux. Aussi bien Baudelaire les a-t-il toutes résumées en quatre vers :
Avez-vous vu Théroigne, amante du Carnage,
Excitant à l'assaut un peuple sans souliers,
La joue et l'oeil en feu jouant son personnage,
Et montant, sabre au poing, les royaux escaliers ?
Au moins ne la traite-t-il pas de panthère, de bacchante, de ménade buveuse de sang, et ne salive-t-il pas sur sa semi-nudité dans l’action. Curieusement, un des hommes les plus incontinents en matière de fantasmes a eu pour elle des paroles justes, et cet homme-là c’est Michelet :
« Tragique histoire, horriblement défigurée par Beaulieu et tous les royalistes. Je prie les Liégeois de réhabiliter leur héroïne. »
Autre exception, le baron Camille Buffin (noblesse belge, on fait avec ce qu’on a) résumait ainsi, au début du XXe siècle, son sentiment :
« En étudiant l’histoire de Théroigne, on doit reconnaître que cette femme montra en toute circonstance une remarquable énergie et l’on ne peut se défendre d’avoir pour elle une certaine sympathie. Jetée dans la vie à 17 ans, sans appui, sans instruction, sans argent, livrée par sa beauté à toutes les tentations, exposée à toutes les séductions, elle parvint non seulement à devenir un orateur politique, mais à acquérir une influence populaire incontestable.
« Au milieu des événements dramatiques de la Révolution Française, elle groupa autour d’elle des hommes éminents, tels que J.M. Chénier, le peintre David, Danton, Pétion, Desmoulins, Siéyes, etc., et finit par prendre une part importante aux délibérations des assemblées. Il est pénible de penser que pendant les 24 années qu’elle passa dans un asile d’aliénés, réduite à l’alimentation des indigents, vêtue uniquement d’une chemise, aucun de ses anciens amis ne se souvint d’elle et ne lui accorda un secours, aucun des frères, qu’elle avait nourris si longtemps, ne lui fit une visite. Ingratitude cruelle ! Son nom s’était effondré sous les injures et les quolibets. Représentée tour à tour comme hideuse ou stupide, ivre, dévêtue, obscène, empoisonnant le sang français, personne n’osait plus la connaître. Et cependant Théroigne était innocente de la plupart des accusations portées contre elle par les adversaires de la Révolution, comme par exemple l’accusation du dessinateur Gabriel, d’avoir fait guillotiner un artiste qui avait peint d’elle un portrait peu ressemblant.
« Sa vie privée ne fut certes pas exempte de fautes, mais elles sont imputables en partie à l’abandon de sa famille pour laquelle elle se montra toujours bonne et généreuse. Quant à son rôle politique, il est difficile à apprécier. Fut-elle comme on l’assure, l’agent inconscient d’hommes intrigants qui, à diverses reprises, utilisèrent son influence réelle sur le peuple ? Ce qui semble certain, c’est qu’elle était sincère dans ses convictions républicaines, sans ambition, ni intérêts, elle croyait en soutenant les révolutionnaires, défendre les droits des pauvres et des opprimés et si elle poussa l’amour de la patrie jusqu’au crime, quelle est sa part de responsabilité ?»
 Il se trompe sur un point, le baron Buffin : Théroigne reçut bien, au cabanon, au moins deux visites. Celle de Sièyes, venu la regarder comme une bête en cage, à qui elle dit son fait de façon telle qu’il s’enfuit, décomposé. Celle ensuite de l’artiste qui a dessiné d’elle ce dernier portrait. Qui était ? Ce Gabriel, qui l’avait calomnieusement accusée d’avoir fait guillotiner l’auteur d’un « portrait peu ressemblant.».
Il se trompe sur un point, le baron Buffin : Théroigne reçut bien, au cabanon, au moins deux visites. Celle de Sièyes, venu la regarder comme une bête en cage, à qui elle dit son fait de façon telle qu’il s’enfuit, décomposé. Celle ensuite de l’artiste qui a dessiné d’elle ce dernier portrait. Qui était ? Ce Gabriel, qui l’avait calomnieusement accusée d’avoir fait guillotiner l’auteur d’un « portrait peu ressemblant.».
Fut-elle, comme Buffin rapporte qu’on l’assura, « l’agent inconscient d’hommes intrigants qui, à diverses reprises, utilisèrent son influence réelle sur le peuple » ? Il est difficile d’en douter. On a beau se dire que lorsqu’elle appelait les femmes à s’armer et à s’entraîner aux Champ de Mars, elle était sincèrement persuadée des dangers qu’elle annonçait, qu’elle les pressentait, les voyait, tels qu’en effet ils finirent par déferler. Mais la France n’était pas encore en guerre, alors, et les jacobins robespierristes s’y opposaient avec l’énergie du désespoir, conscients que leur pays – en aussi complète déréliction que les États-Unis aujourd’hui – n’était pas en état de l’affronter.
C’étaient ses amis, Brissot en tête, qui la voulaient, sans expressément le dire, bien sûr, se contentant de crier au loup, à l’invasion imminente, comme l’ont fait de tout temps les va-t-en guerre (Napoléon pendant toute sa carrière, Hitler hier, les USA cinquante fois et Israël aujourd’hui). Quand la banqueroute est là et que l’empire auquel on prétend est sur le point de s’effondrer, le recours à la guerre, pour ceux qui sont au pouvoir, est la toute dernière carte qui reste à jouer. À condition bien entendu de passer d’avance par pertes et profits une partie non négligeable de la population en âge de porter les armes et de condamner de gaîté de coeur la majorité du reste à la plus extrême misère. C’est ce que se préparaient à faire les Girondins, se voyant déjà, par la grâce de ce miraculeux conflit, en train de piller l’Europe jusqu’à en rétablir les finances publiques françaises. Leurs finances privées ne se portaient pas trop mal, merci. Ces armateurs, ces colons, ces planteurs, ces négriers n’étaient pas sectaires : que les colonies fussent très loin à l’Ouest ou très près à l’Est importait peu, et quoi de plus excitant que de conquérir et dépouiller l’Europe en brandissant les idéaux de la Révolution ! (Eh, non, cela non plus n’est pas nouveau.) « Démocratie »... « Liberté » (pour soi, sinon pour les autres)... Pour l’égalité et la fraternité, il n’y avait pas le feu.. Quand le peuple sortirait de sa croisade messianique, il ne serait heureusement plus en état d’embêter le monde avec ces billevesées. Il serait trop heureux en fait qu’on le laisse rentrer dans ses tanières pour y lécher ses plaies. En attendant, cette petite excitée était bien utile pour fabriquer le consentement dont on avait besoin.
Les robespierristes, en dépit d’efforts héroïques, n’allaient pas pouvoir épargner à leur pays cette épreuve. Tout au plus réussiraient-ils à le débarrasser des Girondins d’abord, de Danton ensuite, mais pas avant que ce dernier eût réussi à dégarnir Paris de ses éléments les plus radicaux, grâce à l’idée géniale de la levée en masse. Combien furent-ils, alors, à tomber dans le même panneau que l’innocente?
La guerre une fois déclarée par la France girondine, il revint aux jacobins de la faire, de la faire défensivement et de la gagner. C’était donc eux qu’il faudrait ensuite éliminer pour que, de défensive, elle pût devenir de conquête, chose que mènerait à bien un ambitieux petit caporal. Le délicat Sièyes, qui depuis si longtemps cherchait un sabre, l’avait enfin trouvé.
Devant l’ampleur du désastre qu’elle avait à la fois redouté et contribué à faire advenir, Théroigne se mit à recommander la modération. Trop tard. Mais c’est grâce à elle et à d’autres abusés comme elle que des générations d’historiens à lunettes en bois ont pu faire passer Danton et les Girondins pour les modérés qu’ils ne furent jamais.
Ceux qui survécurent à la lutte à mort entre camp de la guerre et camp de la révolution la trouvèrent assurément plus gênante qu’utile, dès qu’ils n’en eurent plus besoin. Se rendit-elle jamais compte ? Difficile à dire. Sa sincérité ne fait aucun doute. Et quel qu’ait été son discours, sa fraternité fut également indiscutable. Pour le reste...
Incidemment : l’élimination des révolutionnaires opposés à la guerre avait commencé de la blanche main de Charlotte Corday. S’est-on jamais avisé que ces deux femmes, qui ont joué et perdu leur vie pour des causes si opposées, ont été instrumentalisées par les mêmes hommes ? Toutes deux ont payé le plus haut prix qui fût leurs convictions respectives. Au moins la Liégeoise ne s’est-elle pas mis de sang sur les mains pour les yeux de merlan frit d’un bellâtre à la Barbaroux.

À celle qui a peut-être été la première victime de Thermidor, je n’ai rien à offrir en guise de monument expiatoire, mais je puis au moins lui rendre, une dernière fois, la parole :
D I S C O U R S
PRONONCÉ à la Société Fraternelle des Minimes,
le 25 mars 1792,
l’an quatrieme de la liberté,
Par Mlle THÉROIGNE,
En présentant un Drapeau aux Citoyennes
du Faubourg S. Antoine.
~~~~
CITOYENNES, quoique nous ayons remportées des victoires, qu’un Tyran soit mort, qu’un Ministre prévaricateur soit accusé de haute trahison, & que l’Assemblée Nationale montre une énergie qui ranime l’espérance des Amis de la Patrie, nous sommes cependant toujours en danger. Sans entrer à cet égard dans des détails qui vous sont connus, je vous répéterai seulement ce que je crois ne pouvoir être trop rappelé à votre souvenir, afin de vous inviter à réfléchir sérieusement sur notre situation ; à ne pas perdre de vue que les torches de la guerre civile sont prêtes à s’allumer ; que l’étendart de la contre-révolution est arboré dans plusieurs parties de l’Empire ; qu’il est visible que par-tout, mais particulièrement dans Paris, des scélérats soudoyés ont un plan de division intestine qu’ils suivent avec la plus grande activité, afin de préparer des partis qui seront toujours funestes à la liberté, si votre vigilance ne déjoue pas les trames criminelles ourdies par nos ennemis.
Citoyennes, n’oublions pas que nous nous devons toutes entieres à la Patrie ; qu’il est de notre devoir le plus sacré de resserrer entre nous les liens de l’union, de la confraternité ; & de répandre les principes d’une énergie calme, afin de nous préparer avec autant de sagesse que de courage à repousser les attaques de nos ennemis.
Citoyennes, nous pouvons, par un généreux dévouement, rompre le fil de ces intrigues. Armons-nous ; nous en avons le droit par la nature & même par la loi ; montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieures ni en vertus, ni en courage ; montrons à l’Europe que les Françoises connoissent leurs droits, & sont à la hauteur des lumieres du dix-huitieme siecle ; en méprisant les préjugés, qui par cela seul qu’ils sont préjugés, sont absurdes ; souvent immoraux, en ce qu’ils nous font un crime des vertus.
Les tentatives que le pouvoir exécutif pourra faire par la suite pour regagner la confiance publique, ne seront que des piéges dont nous devons nous défier : tant que nos moeurs ne seront pas d’accord avec nos lois, il ne perdra pas l’espérance de profiter de nos vices pour nous remettre dans les fers. Il est tout simple, & vous devez même vous y attendre, on va mettre en avant les aboyeurs, les folliculaires soudoyés, pour essayer de nous retenir, en employant les armes du ridicule, de la calomnie, & tous les moyens bas que mettent ordinairement en usage les hommes vils pour étouffer les élans du patriotisme dans les ames foibles. Mais, françoises, actuellement que les progrès des lumieres vous invitent à réfléchir, comparez ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l’ordre social. Pour connoître nos droits et nos devoirs, il faut prendre pour arbitre la raison, & guidées par elle, nous distinguerons le juste de l’injuste. Quel seroit donc la considération qui pourroit nous retenir, nous empêcher de faire le bien lorsqu’il est évident que nous le pouvons & que nous le devons ? Nous nous armerons, parce qu’il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers, & que nous serions injustes à notre égard & responsables à la Patrie, si la pusillanimité que nous avons contractée dans l’esclavage avoit encore assez d’empire pour nous empêcher de doubler nos forces. Sous tous les rapports, vous ne pouvez douter que l’exemple de votre dévouement ne réveille dans l’ame des hommes les vertus publiques, les passions dévorantes de l’amour de la gloire & de la Patrie. Nous maintiendrons ainsi la liberté par l’émulation et la perfection sociale résultante de cet heureux concours.
Françoises, je vous le répete encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées ; brisons nos fers ; il est temps enfin que les Femmes sortent de leur honteuse nullité ; où l’ignorance, l’orgueil, & l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps ; replaçons-nous au temps où nos Meres, les Gauloises & les fieres Germaines, délibéroient dans les Assemblées publiques, combattoient à côté de leurs Époux pour repousser les ennemis de la Liberté. Françoises, le même sang coule toujours dans nos veines ; ce que nous avons fait à Beauvais, à Versailles, les 5 & 6 octobre, & dans plusieurs autres circonstances importantes & décisives, prouve que nous ne sommes pas étrangeres aux sentimens magnanimes. Reprenons donc notre énergie, car si nous voulons conserver notre Liberté, il faut que nous nous préparions à faire les choses les plus sublimes. Dans le moment actuel, à cause de la corruption des moeurs, elles nous paroîtront extraordinaires, peut-être même impossibles ; mais bientôt par l’effet des progrès de l’esprit public & des lumieres, elles ne seront plus pour nous que simples & faciles.
Citoyennes, pourquoi n’entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes. Prétendent-ils eux seuls avoir des droits à la gloire ; non, non... Et nous aussi nous voulons mériter une couronne civique, & briguer l’honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chere qu’à eux ; puisque les effets du despotisme s’appesantissoient encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs.
Oui... généreuses Citoyennes, vous toutes qui m’entendez, armons-nous, allons nous exercer deux ou trois fois par semaine aux Champs-Elisées, ou au Champ de la Fédération, ouvrons une liste d’Amazones Françoises ; & que toutes celles qui aiment véritablement leur Patrie, viennent s’y inscrire ; nous nous réunirons ensuite pour nous concerter sur les moyens d’organiser un Bataillon à l’instar de celui des éleves de la Patrie, des Vieillards ou du Bataillon sacré de Thèbes. En finissant, qu’il me soit permis d’offrir un Etendart tricolore aux Citoyennes du faubourg Saint-Antoine.
~~~~
D I S C O U R S
Imprimé par ordre de la Société Fraternelle de
patriotes, de l’un & l’autre sexe, de tous
age & de tout état, séante aux Jacobins,
rue Saint-Honoré.
_________________________
A P A R I S
______
1 7 9 2.
Un mois et cinq jours plus tard, la France déclarait la guerre à l’Autriche.
Un an presque jour pour jour plus tard, c’est la défaite, pour ne pas dire la déroute : le général girondin Dumouriez, après avoir été battu à Neerwinden et à Louvain, s’entretient avec le prince de Saxe-Cobourg Gotha, son vainqueur, comme si de rien n’était. L’assemblée lui envoie quatre représentants pour le destituer et l’arrêter . C’est lui qui les arrête et les livre aux Autrichiens. Il se prépare à marcher sur Paris, pour y mettre au pas l’Assemblée et s’emparer de la dictature. Les soldats du rang, les fameux volontaires enrôlés grâce à Danton, refusent de le suivre et crient à la trahison. Il ne lui reste plus qu’à passer à l’ennemi avec tout son état-major.
Depuis des mois, Marat l’accusait lui aussi de trahison. Ses amis politiques – le gouvernement de la France, à ce moment-là, c’est eux – décrètent Marat d’arrestation. Appelé à la barre de l’Assemblée pour y répondre des forfaits dont on l’accuse, Marat se défend seul et sort en triomphateur de l’épreuve : le peuple qui l’attend dehors le porte en triomphe. Robespierre réclame la mise en accusation des ministres girondins pour complicité avec Dumouriez, et l’obtient.
Est-ce juste avant, est-ce pendant ou juste après ces journées cruciales – insurrectionnelles – des 31 mai et 2 juin 1793 qu’elle fit placarder l’appel qui suit ? Elle y mentionne son retour d’Allemagne « il y a à peu près dix-huit mois ». Ces dates coïncident.
Essayait-elle de sauver ses amis ou simplement d’empêcher, comme elle le dit, la guerre civile ?
C’est sous la pression de l’émeute populaire que, le 2 juin, vingt-neuf députés girondins et deux ministres sont décrétés d’arrestation (leur procès aura lieu en octobre). Placés en résidence surveillée à leur domicile, plusieurs s’enfuient et s’en vont soutenir les insurrections fédéralistes de Normandie, de Bretagne, du Sud-Ouest et du Midi, c’est-à-dire y fomenter cette guerre civile qu’elle semble redouter plus que tout. Il est donc possible que ce soit là le premier désaveu qu’elle exprime à leur égard. Ils rencontrent, dans leur cavale, Charlotte Corday, qu’ils se mettent à catéchiser. Marat n’a plus un mois à vivre.
« AUX 48 SECTIONS,
« Citoyens,
« Écoutez, je ne veux point vous faire de phrases, je veux vous dire la vérité pure et simple.
« Où en sommes-nous ? Toutes les passions que l’on a eues à Paris l’art de mettre aux prises nous entraînent, nous sommes presque au bord du précipice.
« Citoyens, arrêtons-nous et réfléchissons, il est temps. À mon retour d’Allemagne, il y a à peu près dix-huit mois, je vous ai dit que l’Empereur avoit ici une quantité prodigieuse d’agens pour nous diviser, afin de préparer de loin la guerre civile, et que le projet étoit de la faire éclater au moment que ses satellites seroient prêts à faire un effort général pour envahir notre territoire. Nous y voilà ; ils sont au point de dénouement, nous sommes prêts à donner dans le piège. Déjà des rixes précurseurs de la guerre civile ont eu lieu dans quelques sections : soyons donc attentifs et examinons avec calme quels sont les provocateurs, afin de connoître nos ennemis.
« Malheur à vous, citoyens, si vous permettez que de semblables scènes se renouvellent. Si on peut se donner des coups de poings, se dire des injures indignes de citoyens, bientôt on osera davantage...
« Citoyens, arrêtons-nous et réfléchissons ou nous sommes perdus. Le moment est arrivé où l’intérêt général de tous veut que nous nous réunissions, que nous fassions le sacrifice de nos haines et de nos passions pour le salut public. Si la voix de la patrie, la douce espérance de la fraternité n’ébranlent point nos âmes, consultons nos intérêts particuliers. Tous réunis nous ne sommes pas trop fort pour repousser nos nombreux ennemis du dehors et ceux qui ont déjà levé l’étendard de la rebellion. Cependant je vous préviens que nos ennemis ne distinguent point les partis et que si nous sommes vaincus nous serons tous confondus au jour de la vengeance. Je puis dire qu’il n’y a pas un seul patriote qui se soit manifesté dans la révolution, sur le compte duquel on ne m’ait interrogée. Tous les habitants de Paris sont indistinctement proscrits, et j’ai ouï dire mille fois par ceux qui me vouloient faire déposer contre les patriotes, qu’il falloit exterminer la moitié des François pour soumettre l’autre...
« Les plus petites choses conduisent quelquefois aux plus grandes. Des femmes romaines ont désarmé Coriolan et sauvé leur patrie.
« Rappelez-vous citoyens qu’avant le dix août, aucun de vous n’a brisé le fil de soye qui séparoie la terrasse des Feuillans du jardin des Thuileries. La moindre chose arrête quelquefois le torrent des passions avec plus de succès que tout ce qu’on peut leur opposer.
« En conséquence je propose qu’il soit nommé dans chaque section, six citoyennes les plus vertueuses et les plus graves par leur âge, pour concilier et réunir les citoyens, leur rappeler les dangers de la patrie ; elles porteront une grande écharpe où il sera écrit AMITIÉ ET FRATERNITÉ. Chaque fois qu’il y aura assemblée générale de section, elles s’y rassembleront pour rappeler à l’ordre tout citoyen qui s’en écarteroit, qui ne respecteroit point la liberté des opinions, chose si précieuse pour former un bon esprit public ; ceux qui ne sont qu’égarés, mais qui cenpendant ont de bonnes intentions, aiment leur patrie, feront silence. Mais si ceux qui sont de mauvaise foi et apostés tout exprès par les aristocrates, par les ennemis de la démocratie et les agens des rois, pour interrompre, dire des injures et donner des coups de poings, ne respectent pas plus la voix de ces citoyennes que celle du président, ce seroit un moyen de les connoître. Alors on en prendroit note pour faire des recherches sur leur compte. Ces citoyennes pourroient être changées tous les six mois ; celles qui montreroient le plus de vertu, de fermeté, de patriotisme dans le glorieux ministère de réunir les citoyens et de faire respecter la liberté des opinions pourroient être réélues pendant l’espace d’une année. Leur récompense seroit d’avoir une place marquée dans nos fêtes nationales et de surveiller les maisons d’éducation consacrées à notre sexe.
« Voilà, citoyens, un projet que je soumets à votre examen.
« Théroigne. »
Quelle femme de Baghdad ne pourrait tenir aujourd’hui ce discours ?
Charlotte Corday et Théroigne de Méricourt ne furent pas les seules à être utilisées sans états d’âme par les mêmes ambitieux sans scrupules. Il en est d’autres qui l’ont été tout autant, même si elles l’ont payé moins cher. Je veux parler des deux soeurs Fernig, Marie-Félicité (1770-1841) et Marie-Théophile (1775-1819). Natives de Mortagne, dans le Nord, filles d’un capitaine et soeurs d’un futur général, ces deux jeunes femmes exceptionnellement douées pour le métier des armes ont d’abord combattu sous les ordres du lieutenant-général Beurnonville, futur ministre de la guerre, pour être assez vite – à l’âge respectif de 17 et de 22 ans – élevées au rang d’aides de camp du général Dumouriez . Lorsque celui-ci, forcé de jeter le masque et de passer à l’ennemi avec seulement son état-major pour le suivre (exemple rare de toute une armée refusant d’obéir à son chef), Marie-Théophile et Marie-Félicité furent de la chevauchée. Sachant ce qu’elles faisaient ? J’en doute. Des récits biographiques disent qu’à peine arrivées à Bruxelles, elles comprirent qu’elles venaient d’émigrer et n’eurent plus qu’une seule idée : repasser les lignes, s’expliquer et se faire réintégrer dans les rangs républicains.
Elles finirent par mener à bien leur évasion, mais non à convaincre totalement de leur bonne foi. Elles ne furent pas punies de leur défection temporaire, mais ne furent pas réintégrées non plus : leur carrière militaire était finie. Toutes deux sont plus tard retournées vivre à Bruxelles, sous occupation française il est vrai, mais en qualité de civiles (Marie-Félicité mariée, Marie-Théophile célibataire). C’est là qu’elles sont mortes, la cadette sous l’occupation hollandaise, l’aînée sous la monarchie belge.
(Les soeurs Fernig, portrait à l'huile. Musée de Valenciennes)

Stèle érigée par le village de Marcourt à sa plus célèbre citoyenne.
*
« On reconnaît la grandeur et le caractère d’une nation à la manière dont elle traite ses animaux». Gandhi
«On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal… On a du cœur ou on n'en a pas». Lamartine
«La chasse est le moyen le plus sûr pour supprimer les sentiments des hommes envers les créatures qui les entourent ». Voltaire
«Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis ». G.B. Shaw
«De l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas». Tolstoï
«Les problèmes posés par les préjugés raciaux reflètent à l’échelle humaine un problème beaucoup plus vaste et dont la solution est encore plus urgente : celui des rapports de l’homme avec les autres espèces vivantes… Le respect que nous souhaitons obtenir de l’homme envers ses semblables n’est qu’un cas particulier du respect qu’il faudrait ressentir pour toutes les formes de vie… ». Levi-Strauss
Etc. etc. etc.

.....«Que d’applaudissements ! Mais aussi quels rires ! Quelle proie que la “Muse de la Démocratie”, que cette “Vénus donnant des leçons de droit public” pour les moqueries et les huées ! » auraient pu redire les Goncourt, s’il eussent connu Brigitte Bardot.
Ne dénonçons pas les Rivarol, les Peltier, les Champcenetz, les Suleau et les Marchand d’aujourd’hui, qui ne tarissent pas « d’ironies, de soufflets, de gorges chaudes et d’ordures » à son sujet.
Il est vrai qu’elle y a prêté le flanc en adoptant, depuis son dernier mariage, le discours de ceux qui l’entourent. Elle n’est pas la première, nous venons de le voir, à subir l’influence d’hommes peu recommandables. Ni la dernière. Et, certes, elle a répété, sur ceux qui sont, que cela plaise ou non, l’avenir de la France, d’assez consternantes sottises. Elle a pris, comme tant d’autres, la couleur de son environnement..
Qu’elle ait, à un moment de sa vie où une très jolie femme devient fragile, fait l’objet d’une OPA malintentionnée serait très cruel à lui dire, et au fond, ce n’est peut-être même pas vrai. On ne devrait jamais vieillir. On ne devrait jamais se mettre à boire pour ne pas voir que le temps vous outrage, alors qu’on ne lui a rien fait. Que celui qui ne s’est jamais trompé lui jette la première pierre. Après tout, le grand Vallès lui-même a bien écrit un livre sur l’argent, pour essayer de se persuader que les capitalistes avaient raison...
Pourtant, « Muse de la Démocratie », elle l’a bel et bien été quand ce mot signifiait encore quelque chose. Et cette Vénus a vraiment donné des leçons de droit public ! Ou n’y a-t-il que moi qui se souvienne de cette mi-décembre de 1961, où, seule, elle a osé répondre par un non catégorique au chantage de l’OAS? Croit-on peut-être que ce n’était rien et qu’il n’y fallait pas de courage ? « Si vous ne voulez pas être plastiquée »... (Sartre venait de l’être)... « Payez secrètement »... Combien de ses vertueux censeurs d’aujourd’hui ont-ils payé alors « secrètement » pour être laissés en paix, et tant pis pour les Algériens et tant pis pour le contingent ? A-t-on oublié ses mots d’alors à L’Express : « ...les inspirateurs de ce genre de lettres seront rapidement mis hors d’état de nuire s’ils se heurtent partout à un refus net et public de la part des gens qu’ils cherchent à terroriser par leurs menaces et leurs attentats (paroles réactivées, et de quelle manière, par les femmes algériennes des années 1990) En tout cas, moi, je ne marche pas, parce que je n’ai pas envie de vivre dans un pays nazi. » A-t-on oublié le billet d’André Wurmser en première page de L’Humanité, lorsqu’un de ses films fut sifflé dans un cinéma d’Alger, et sa photo, pendant plusieurs jours en page politique du même quotidien, sans compter les autres ? Lui en a-t-on prêté des motifs, alors qu’elle n’était tout simplement pas intimidable ! Déjà célèbre de toutes les manières, y compris par la liberté de ses moeurs, elle l’a été à ce moment-là d’une manière toute nouvelle et pas « people » pour un sou, qui a forcé le respect jusque hors de France. (Je rappelle en passant que c’est un autre acteur, Peter Ustinov, qui a cassé le pouvoir d’intimidation du McCarthysme, en répondant par de spirituelles insolences au questionnaire qu’on lui fit remplir à son entrée aux États-Unis.) On peut penser ce qu’on veut des dérives de la Bardot d’aujourd’hui, et je n’en pense pas de bien, mais comment oublier, en même temps, qu’aux instants du vrai danger – pas du chantage à l’insécurité ! – elle n’a ni émigré à Hollywood ni planqué son magot en Suisse, mais est restée au contraire à travailler en France, et à y payer ses impôts ?
Par ailleurs, il est un point sur lequel personne, jamais, n’aura pu l’influencer, c’est sa défense, bec et ongles, des innocents entre tous, dont le martyre perpétuel passe nos capacités d’imagination et d’encaissement. Nous voulons bien laisser faire, mais nous ne pourrions pas savoir sans tomber dans les pommes.
Là, non seulement elle n’a subi aucune influence, bonne ou mauvaise, mais c’est elle qui a pesé – qui pèse encore – sur son siècle. Je n’ai, pour ma part, vu un tel déni d’anthropocentrisme que chez deux autres personnes, que je vénère pour cela et que j’admire pour beaucoup d’autres raisons : Paul Léautaud et John Cowper Powys. Pourquoi sont-ils si rares, ceux qui comprennent que, si les animaux n’ont que deux miroirs à leur cerveau quand nous en avons plusieurs, cela nous donne des responsabilités supplémentaires, pas des droits ?
Je me souviens comme si c’était hier – pas vous ? – de sa toute première manifestation dans ce sens. C’est en 1962, à la télévision, qu’elle est apparue dans l’émission d’Éliane Victor « Les femmes aussi », pour flanquer la torture des animaux de boucherie dans l’assiette de millions de patates de divan. Elle n’a plus jamais arrêté depuis. Combien de présidents de la République est-elle allée voir pour tenter de les persuader de légiférer un peu, un tout petit peu, contre la barbarie à pleins tubes ? Cinq ? Six ? Tiens, fume ! Et voilà qu’au moment où elle s’y attendait peut-être le moins, il y en a un, enfin, qui l’a entendue, et qui vient d’interdire la chasse aux bébés phoques sur le territoire de son pays, qui se trouve être le plus vaste du monde – non, bien sûr, ce n’est pas en France – et à qui elle a écrit : «Monsieur le Premier Ministre, qui restez mon Président de coeur, merci ».
Et si on lui donnait un petit coup de main ?
« Monsieur le Premier Ministre et Président de coeur de Brigitte Bardot, encore un effort ! Maintenant que vous leur avez sauvé la vie, empêchez qu’on en fasse des orphelins. Rendez ce plus grand de tous les services à vos compatriotes : aidez-les à grandir. Qui sait... peut-être alors feront-ils tache d’huile... D’avance, toutes les femmes dignes de ce nom vous remrcient. Et comment va Mashenka-Milashka ?
« Salutations déférentes. »
*
Il paraît que Jean Ferrat (on n'est plus tout à fait le 8 mars) avait appelé son âne « Justice sociale ».
Dans ce cas, c’était une ânesse, pas un âne.
Les Antraiguois s’en occupent-ils, maintenant que son humain n’est plus ?

Magne-toi, Justice sociale si tu veux des carottes !
*
J’aurais voulu parler de tant d’autres...

Mauvaise graine, collage d’André Stas.
J’aurais voulu parler de la veuve de Marat, Simonne Evrard, épousée « sur l’autel de la Nature », et de la soeur de Marat, Albertine. Car c’est avec ces deux femmes, réfugiées après la défaite dans un petit bourg suisse et « vivant ensemble d’une rente minuscule sur l’État et du travail de leurs mains », que Philippe Buonarrotti a entrepris de mettre sur pied une quantité de sociétés secrètes qui, sous le Consulat, sous l’Empire et sous la Restauration, ont détourné la franc-maçonnerie à des fins politiques, dans le but de républicaniser l’Europe. Si indignes qu’elles en soient devenues, toutes les gauches européennes sont sorties de leurs mains. Sans lui, et sans elles, ni Marx, ni Bakounine, ni Élisé Reclus, ni Lénine n‘auraient trouvé le moindre auditeur..
J’aurais voulu parler de ma très chère May Picqueray, de Louise, la Canaque d’honneur, de Séverine, qui tant impressionna Léautaud, de la mère d’Haroun Tazieff, qui fut la première chimiste en jupons de Russie, docteur en sciences politiques et athée, qui épousa un Tatar musulman, le perdit à la guerre, devint membre du Komintern et sauva, pendant la guerre suivante, des petits enfants juifs et ceux de Maurice Thorez pêle-mêle (alors, Frédéric, cette biographie, ça vient ?).
J’aurais voulu parler de Silvia Cattori, de Mona Chollet, de Paula Jacques et de toutes celles qui, comme elles, pensent que le talent ne suffit pas, s’il n’y a pas une conscience pour aller avec. Et, tiens, à propos, j’aurais bien aimé parler des cailles coyphées, des belles thélémites, des fillettes de par icy et même des Gargamelles de mon très cher aussi maître François, ce sera pour une autre fois, et puis il le fait si bien lui-même. Misogyne ? Vous ne savez pas lire !
J'aurais voulu parler des Anglo-Saxonnes, presque toutes des femmes de lettres, qui, au moment où Zetkin et Armand posaient politiquement le problème de l'égalité des sexes et de la libération des moeurs, ont choisi de le faire de façon expérimentale, au prix d'un tribut souvent très lourd : les Virginia Woolf, les Violette Trefusis, plus tard les Virginia Townsend Warner et les Mary Renault, mais aussi les femmes de la mouvance de D.H. Lawrence et celles du clan Powys - celles du noyau et celles de la couronne, les Marian et Gertrude Powys, les Frances Gregg, Phillys Playter, Alyse Gregory et Gamel Wolsey, sans oublier Hilda Doolittle et Isadora Duncan. Combien d'autres encore...
J’aurais voulu parler de Marie N’Diaye, qui pense en même temps qu’elle écrit. Ça existe encore, ça, un écrivain qui pense, à part M. Michon ? Madame, surtout, ne lâchez pas la langue française ! C’est un Stradivarius des langues, mais elle a terriblement besoin de votre sang neuf, de vos mots neufs, de vos tournures neuves et de votre façon de penser, sinon elle mourra, car ceux qui en ont hérité lui préfèrent le pidgin qu’ils prennent pour de l’anglais. Ne leur laissez pas nous faire ce coup-là !
J’aurais voulu parler de Pascale Vandegeerde, qui a tiré quinze ans de prison dans l’indifférence générale pour sauver les Belges du déshonneur, qui est allée jusqu’au bord de la folie mais sans broncher sur ses principes, et qui maintenant fait des jardins comme si personne ne lui devait rien.
Que dire de Joëlle Aubron ? Peut-être que, pendant que j’écris ceci, elle fume des asphodèles avec Rachel Corrie.
Quant à celles qui sont au pouvoir... « Une femme au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou économique, est un homme » (José Saramago). Une femme châtrée en tout cas.
J’ai dit que je ne parlerais pas de paix, mais je veux bien parler de guerre à la guerre...
C’est quand qu’on rejoue Lysistrata, version mondiale ?
Voilà. Désolée d’avoir empiété sur l’année de l’homme.
Marie Mouillé
________________________________
Notes
1. Dans William Shakespeare.
2. On les appelle aussi refusniks, n’en déplaise aux joyeux drilles du Jeu des Dictionnaires.
3. « agenbite of inwit !... Ils ont beau me dire que c’est tout simplement «conscience» en vieil anglais. Conscience ! Il me semble entendre quelque Déméter à tête de jument hennir son dédain mystique pour le derner mot des Mystères d’Éleusis ! » John Cowper Powys, James Joyce’s Ulysses – An appreciation.
4. On appelait d’ailleurs cette station thermale « le Café de l’Europe ». Entendez : son tripot. On y jouait des sommes colossales. Artois et Provence y perdirent, certains soirs, de quoi nourrir tous les pauvres de France pendant plus d’un an. Une de leurs distractions, à la sortie du « Wauxhall », était de jeter dans la Hoëgne des piécettes de cuivre aux gamins, à condition qu’ils allassent les y chercher avec les dents.
5. En moins d’un an, elle avait emprunté 8000 livres.
6. Louis David, qui, pendant la Révolution, dirigea les Beaux-Arts.
7. Jean-Louis Carra, journaliste et conventionnel, qui sera guillotiné avec les Girondins en 1793.
8. « Le chevalier, un homme de 34 ans environ, avait le talent d’indisposer tout le monde contre lui... Il était indiscret, insolent, fanfaron et savait mentir avec le plus grand sang-froid... il tournait de jour en jour au chevalier d’industrie. » (M. Strohl Ravelsberg)
9. Elle voulait demander des comptes à Mercy-Argenteau, ignorant qu’il avait entretemps été remplacé par Metternich.
10. Pour Dora Weiner, Esquirol est plus qu’un élève de Pinel, il est aussi un rival qui sort vainqueur de ce qu’elle appelle « la joute du vocabulaire ». Ils sont opposés aussi par des traditions politiques différentes : alors que Pinel reste associé à l’utopie de la Révolution, Esquirol est monarchiste. Avec les changements politiques post-révolutionnaires en France, Pinel est progressivement relégué, alors qu’Esquirol devient le centre de l’organisation nationale du monde asilaire avec la Restauration. À partir de 1817, Esquirol est au zénith en ce qui concerne la folie et son vocabulaire supplante de plus en plus celui de Pinel. Esquirol ne s’embarrasse pas de finesses hippocratiques démodées et l’heure n’est plus à la vocation universaliste de guérir la manie en tant que problème de l’humanité, mais d’administrer une folie qui est devenue un problème national. (Diego Alcorta, Dissertation sur la manie... aiguë ?)
11. http://canalmythos.blogspot.com/ ...
http://canalmythos.blogspot.com/2007/02/de-lorigine-de-lexpression-jeunesse.html
_____________
LIVRES
Sur ou de Clara Zetkin :
Clara Zetkin, Selected Writings, 1991 (en anglais)
Dorothea Reetz, Clara Zetkin as a Socialist Speaker, 1987. (en anglais)
Sur Inès Armand :
Jean Fréville, Une grande figure de la Révolution russe : Inessa Armand, Paris, Éditions sociales, 1957.
Georges Bardawil, Inès Armand : La deuxième fois que j’entends parler d’elle, Paris, J.C. Lattès, 1983.
R.C. Elwood, Inessa Armand, Revolutionary and Feminist, Cambridge University Press, 1992 et 2002.
Sur Rachel Corrie :
Je m'appelle Rachel Corrie, Texte d'après les écrits de Rachel Corrie adaptés par Alan Rickman et Katharine Viner, traduits en français par Séverine Magois. (Représentations dans divers théâtres de France, de Suisse et de Belgique. Aucune publication en français !)
Sur les femmes et l’Afghanistan :
Nadeem Aslam, La vaine attente, Paris, Seuil, 2009 (roman traduit de l’anglais, auteur pakistanais en exil).
Nous espérons pouvoir revenir plus tard sur l’extraordinaire floraison de talents littéraires qu’offrent, en ce moment, l’Inde, l’Afghanistan et le Pakistan.
Victor Hugo sur Tacite (à propos d’Aline de Diéguez) :
C’est dans William Shakespeare, in Oeuvres complètes de Victor Hugo, Paris, Hetzel – Quantin, 1864. En ligne : http://fr.wikisource.org/wiki/William_Shakespeare_%28Victor_Hugo%29
Les curieux y liront, sur William Pitt, une page d’anthologie (chapitre « L’Histoire réelle », pp. 315-316 de l'édition sus-citée.).
Sur les Shministim :
Des sites et des vidéos (taper "shministim" dans Google).
Celui-ci est en anglais : http://december18th.org/
John Cowper Powys, James Joyce’s Ulysses – An Appreciation, Londres, The Village Press, 1975.
Sur Théroigne de Méricourt :
Edmond et Jules de Goncourt, Portraits intimes du dix-huitième siècle, Paris, Flammarion & Fasquelle, 1857 (Les citations de Théroigne à l'orthographe non retouchée : d'après la collection des Goncourt.)
Strohl-Ravelsberg, Les Confessions de Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise. - Extrait du procès-verbal inédit de son arrestation au pays de Liège, qui fut dressé à Koufstein (Tyrol), en 1791 (208 p. fol.). (Ouvrage édité en 1892 à Paris, d'après une autobiographie écrite au crayon par Théroigne et reposant aux Archives de Vienne.)
Baron Camille Buffin, Récits d’hier et d’aujourd’hui, Renaix, Leherte-Courtin & Fils, s.d. (1900 -1920).
Georges Laport, La vie trépidante de Théroigne de Méricourt, Mézières-Charleville, Les Cahiers Ardennais, 1931.
Notice biographique officielle de la Principauté de Liège en ligne :
http://perso.infonie.be/liege06/12douze10.htm
Théroigne de Méricourt, La lettre-mélancolie, Paris, Verdier, 2006, Texte édité par Jackie Pigeaud, transcription de Jean-Pierre Ghersenzon. (Voir ici le compte-rendu qu’en fait Maïté Bouyssy, pour Les Annales historiques de la Révolution Française : http://ahrf.revues.org/6643 )
Bibliographie non exhaustive.
Sur Perregaux, espion suisse :
Robert Darnton, L'aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800, un best-seller au siècle des Lumières, Paris, Perrin, 1982
Sur Perregaux, espion anglais et banquier de la France :
Albert Mathiez, « Le Banquier Perrégaux », Annales révolutionnaires, XI, mars 1920, p.242-252.
Albert Mathiez, « Encore le banquier Perrégaux », Annales révolutionnaires, XII, avril 1920, p. 237-243.
Henri Guillemin, Napoléon tel quel, Paris, Trévise, 1969 – Réédition Utovie, 2005.
Olivier Blanc, La Corruption sous la Terreur, Paris, Robert Laffont, 1992.
Olivier Blanc, Les Espions de la Révolution et de l’Empire, Paris, Perrin, 1995.
De Brigitte Bardot :
Noonoah, le petit phoque blanc, Éditions Grasset jeunesse, 1978.
Initiales B.B., Éditions Grasset. Mémoires (Tome 1 - de 1934 à 1973), 1996.
Le Carré de Pluton, Éditions Grasset. Mémoires (Tome 2 - de 1973 à 1998), 1999.
Un cri dans le silence, Éditions du Rocher, 2003
Pourquoi ?, Éditions du Rocher. A l'occasion du 20ème anniversaire de sa Fondation, Brigitte Bardot retrace tout son combat pour la protection animale - plus de 300 photos, 2006.
Sur Brigitte Bardot :
Prière de se reporter à Wikipédia.
Sur Vladimir Poutine, les phoques et les tigresses :
http://www.russiablog.org/2009/03/putin-bans-seal-hunt-ca...
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20080901.OBS965...
(Aux dernières nouvelles, la tigresse va bien, a eu un petit, a été perdue pour cause de collier désactivé, a été retrouvée, a un nouveau collier, a recommencé à circuler sur l’écran du Premier ministre.)
http://www.videos.nouvelobs.com/video/iLyROoafYHHy.html
(La petite tigresse de deux mois a maintenant plus d'un an et se trouve dans la réserve naturelle de Krasnogorsk.)
De José Saramago :
Interview accordée à Aliette Armel pour Le Magazine littéraire (Mars 2010 - N°495)
Le cahier, chroniques parues sur Internet entre septembre 2008 et mars 2009, préface d'Umberto Eco, traduit du portugais par Marie Hautbergue, Paris, Le Cherche Midi, 2010.
Le voyage de l'éléphant, traduit du portugais par Geneviève Leibrich, Paris, Seuil, 2010
17:02 Écrit par Theroigne dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lysistrata, brigitte bardot, jean ferrat, vladimir poutine, oas, lenine, john cowper powys, demeter, saint-just, jose saramago, marat, james joyce, clara zetkine | ![]() Facebook |
Facebook |