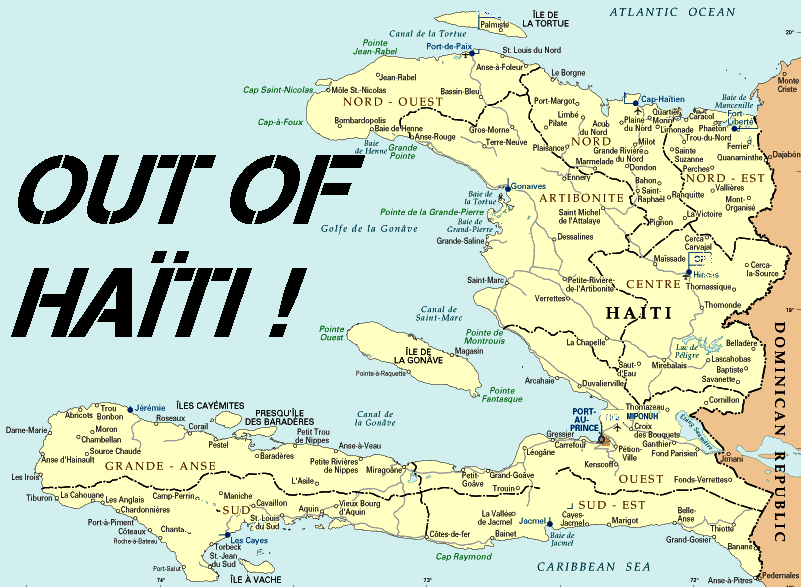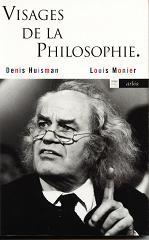02/01/2013
A propos d'un livre consacré à John Cowper Powys

A propos de la publication d'un livre consacré à
John Cowper POWYS
par
Les Perséides
Nous dédions ce petit post sans prétention à Monsieur Manuel de Dieguez, philosophe entre les philosophes, infiniment nécessaire à notre temps de Tohu et Bohu, qui eût excité le plus vif intérêt chez l'ermite de Blaenau Ffestiniog, comme lui jusqu'au bout indéfectible champion des humiliés et des offensés. Quelle chance nous aurons eue d'être les contemporains de ces chênes qu'on n'abat pas !
2 octobre ! C'est le 2 octobre que ce livre a été présenté dans une librairie de la Rive Gauche en présence de ses deux auteurs. Et nous voici le 2 janvier, à venir enfin vous en parler ! Non, l'intendance ne suit pas toujours, quoi qu'en ait dit mongénéral. Cela étant, et même si les bons livres, comme le bon vin, peuvent s'accomoder sans mal de quelques années de cave, mieux vaut en parler avant que l'absence de bruit les ait envoyés au pilon. Retard, donc. Circonstances indépendantes de notre volonté. Notre faute quand même !
Adonc, ce livre, écrit en français, consacré à l'auteur anglais John Cowper Powys, et plus spécifiquement à sa philosophie, venait de sortir aux éditions Les Perséides. Et comme on ne parle jamais trop des « petits » éditeurs en train de sauver l'honneur de l'édition en France, un mot d'abord sur ces dernières, situées au coeur du village de Bécherel, qui est à la Bretagne ce que Redu est à l'Ardenne et Hay-on-Wye au Pays de Galles : un village du livre.
[ http://www.becherel-autour-du-livre.com/categorie-1079014...
http://il-bouge-le-livre.blog.lemonde.fr/2009/04/16/beche...
http://www.redu-villagedulivre.be/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hay-on-Wye ]
En plein accord avec la philosophie du lieu, Les Perséides sont à la fois une maison d'édition et une librairie, qu'animent Thomas van Ruymbeke et Solen Cueff.
5 rue du Faubourg Bertault 35190 Bécherel
Tél. 02 99 66 68 79 - 06 70 44 74 83
Ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures sauf le mardi après-midi.
e-mail : lesperseides@free.fr
Nous ne croyons même pas nous avancer trop en ajoutant qu'on peut aussi y prendre le thé, mais il vous est loisible, chers internautes, de leur rendre, sans attendre le printemps, une petite visité électronique :
http://lesperseides.fr/la-librairie-les-perseides-2/
Pour être brefs, Les Perséides est une maison d’édition de littérature et d'histoire fondée à Rennes en 2004, qui décline sa production en plusieurs collections : La Lune Attique, qui alterne les fictions inédites d'auteurs contemporains, des textes à dominante surréaliste à redécouvrir et des œuvres traduites issues du patrimoine de la littérature mondiale. La collection Aux Sources de l'histoire, qui décrypte les mythes de l'histoire de France à travers des textes clés. Enfin, Le Monde Atlantique, qui s'adresse aux chercheurs et étudiants en histoire atlantique, et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des révolutions ou à celle de l'esclavage et du colonialisme.
Il semble aussi que la maison ait à coeur de mettre, quand elle le peut, le pied à l'étrier aux écrivains de la région, ce qui est tout à son honneur.
Le livre :

Pierrick Hamelin
Goulven Le Brech
John Cowper POWYS`
Une philosophie de la vie
Bécherel, Les Perséides, 2012
21 x 14 cm, 128 pages, 15 €
Les auteurs :
Goulven Le Brech est archiviste et il vit à Gentilly. Spécialiste du philosophe Jules Lequier auquel il a consacré une biographie (La Part Commune, 2007), il est aussi l’auteur d’un récit de pérégrinations en Nouvelle-Calédonie, (Sur le Caillou, Petit Pavé, 2010).
Pierrick Hamelin vit et enseigne en Loire-Atlantique, près de Nantes. Aux Editions Les Perséides, il a déjà publié Point de fuite (2005), Une dernière fois la mer (2007), Promenades philosophiques (2009) et Manège (2010).
Quant à John Cowper Powys, qu'en dire sinon qu'il est d'autant plus cher à notre coeur que nous l'avons, dans une autre vie, traduit et publié nous-mêmes.
*
Nous ne dirons rien de la première partie, « L'expérience de la vie », traitée par Goulven Le Brech, parce que notre ami Edouard Lecèdre nous a envoyé, là-dessus, un compte-rendu si enthousiaste, que nous ne voyons pas ce que nous aurions pu vous en conter de plus intéressant.
Nous avons donc (votre servante a) l'agréable tâche de dire tout le bien qu'il faut penser du travail de M. Pierrick Hamelin, qui a choisi, lui, d'aborder l'espèce d'Himalaya dont il avait à rendre compte en moins de quarante pages sous la forme d'un « Abécédaire ».
Ce parti pris peut paraître étrange à ceux qui ne connaissent pas du tout Powys, mais les powysiens, eux, y reconnaîtront au passage des plages, des pics, des promontoires dont ils sont familiers et admettront que ces « bornes d'histoire littéraire» sont aussi pertinentes qu'elles pouvaient l'être pour présenter l'auteur à ceux qui n'en savent peut-être rien encore. Il fallait bien commencer par quelque part et dieusait que l'entreprise n'était pas facile. Impossible de celer qu'en rédigeant ces lignes, il nous est venu à l'esprit, de façon irrésistible, des mots ou des expressions qui eussent pu être ajoutés au choix fait par M. Hamelin. Ils viendront peut-être, qui sait, étoffer une réédition future. En attendant, que les lecteurs ne boudent pas leur plaisir, celui de la découverte pour les uns, de la reconnaissance parfois amusée pour les autres.
Bibliographie :
Un bémol cependant : l'ouvrage est suivi d'une bibliographie qui serait parfaite si elle était complète, d'autant qu'elle est suivie d'une recension détaillée des moindres articles consacrés à John Cowper Powys par divers sites et revues de langue française. A l'évidence, les auteurs ont consulté, de bonne foi, une source qui pratique l'apartheid. Ce sont des choses qui arrivent.
Bouchons donc les trous et ajoutons aux oeuvres de JCP traduites en français. :
Jugement suspendu sur Oscar Wilde, (avec L'âme de l'homme sous le socialisme d'Oscar Wilde), Verviers, La Thalamège, 1986, (traductions de Suspended judgements : Oscar Wilde et de The Soul of Man under Socialism par Catherine Lieutenant)
Spectres réels, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de Real Wraiths, par Catherine Lieutenant.
Le Hibou, le canard et Miss Rowe ! Miss Rowe !, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de The Owl, the Duck, and Miss Rowe ! Miss Rowe ! par Catherine Lieutenant, la réédition de 2007 par l'Atelier de l'agneau (Saint-Quentin-de-Caplong) reproduisant et modifiant sans autorisation, l'édition originale.
Manque aussi (ostracisme aussi ?) dans la liste des articles consacrés à Powys, un texte de Marc-Edouard Nabe, qui a pourtant paru en son temps dans la Powys Review. Faute de pouvoir le retrouver, signalons, parce qu’elle le mérite, sa préface à l’édition française de Dostoïevski, chez Bartillat :

http://www.alainzannini.com/index.php?option=com_content&...
*
UNE VIE PHILOSOPHIQUE
Edouard Lecèdre
Qui en France aujourd’hui connaît suffisamment bien John Cowper Powys (1872-1963) pour se tenir à l’affût des soubresauts de l’actualité éditoriale le concernant et réagir promptement au moindre écrit dont il serait le sujet ? Car, à ce jour, l’iceberg que représente cet immense auteur garde encore profondément immergée une part importante de son œuvre, qu’il s’agisse par exemple de Atlantis, ou de Porius, deux monuments encore non traduits, ou de rééditions d’ouvrages devenus introuvables (on pense à Une philosophie de la solitude, à La vision complexe…), de ses poèmes, ou encore d’essais sur son œuvre, (il vaudrait mieux ici parler de facettes de son œuvre tellement sa production est vaste et variée).
Apparemment, si l’on en croit les deux auteurs et le petit groupe de spécialistes qui étaient présents à la présentation du livre le 2 octobre dernier à la librairie « L’écume des pages » située près de l’église Saint Germain-des-Prés à Paris, les connaisseurs et les amateurs de l’homme et de l’œuvre seraient plus nombreux qu’on ne le croit, malgré le silence tonitruant dont John Cowper Powys fait l’objet dans la sphère littéraire française. Ils seraient assez nombreux pour permettre à la France de se distinguer parmi les premiers pays où ses livres sont traduits et diffusés….et donc lus. Que penser alors de l’embrasement des esprits des milieux autorisés, comme on dit, si des articles, voire des dossiers Powys étaient publiés dans les suppléments livres des quotidiens nationaux ou dans les magazines spécialisés en littérature, à la place des recensions obligées sur la pitoyable création littéraire française contemporaine !
C’est pourquoi il faut saluer l’événement que constitue la sortie du livre John Cowper Powys – Une philosophie de la vie et remercier les auteurs d’avoir effectué ce salutaire travail de sensibilisation à l’œuvre si dense de Powys, écrit sous forme d’une présentation générale, se voulant simple, rédigée dans le but d’une appropriation aisée et rapide de l’univers powysien par le lecteur néophyte. Une sorte de propédeutique donc, pour comprendre, sinon appréhender l’œuvre complet de cet auteur important. Et pour cela, le livre se compose de deux parties très différentes. Il revient à Goulven Le Brech le mérite d’avoir très bien développé au long des soixante-douze pages de son essai, ce qu’il y a derrière le sous-titre même de l’ouvrage « Une philosophie de la vie » en nous présentant de façon claire et appétissante, les principes de vie qui dirigèrent Powys dans sa vie et dans ses écrits.
Pierrick Hamelin, quant à lui, a choisi d’établir un abécédaire, forcément restreint tant l’œuvre est immense, où il a retenu les thèmes, les termes et parfois les thèses, qui lui ont semblé être assez représentatifs de l’univers powysien pour figurer dans une sorte de guide pratique avant voyage et de boussole si on est perdu dans les romans ou les essais.

La première partie, rédigée de façon scrupuleuse est une réussite (on sent immédiatement que Le Brech a à la fois découvert l’auteur - qui l’a intrigué - et a apprécié sa vision des choses). Une sensation de confort s’installe dès les premières pages, due autant à la clarté du propos qu’à la conjugaison harmonieuse de l’inévitable axe narratif de la chronologie, avec la mise en valeur thématisée des grandes données conceptuelles et philosophiques de l’œuvre powysienne. Le lecteur a l’impression d’être guidé pour pénétrer dans un monde singulier, parfois complexe, voire difficile, de la même façon qu’il serait mis en confiance sur un sentier de randonnée pédestre inédit, grâce à la carte d’état major qu’on lui aurait remise en main. Comme toute randonnée, celle-ci comporte également des étapes. Le Brech a choisi, pour nous expliquer à la fois la philosophie de John Cowper Powys et sa genèse, du moins son évolution, de faire halte sur certains ouvrages, et pas des moindres. Qu’on en juge : La vision complexe, Wolf Solent, Les sables de la mer (Weymouth Sands), Le Hibou, le Canard et - Miss Rowe ! Miss Rowe !, Une philosophie de la solitude, L’Art du bonheur, Apologie des sens, Le sens de la culture.
On ressort de cette lecture très galvanisé. Découvrir, ou, pour les connaisseurs, apprécier de cette nouvelle façon, une partie significative de l’univers powysien, fait prendre conscience de la grande modernité de cet auteur et de la pertinence de ses textes pour comprendre ce XXIème siècle si confus, si incertain, sans dessein de civilisation. Une fois le livre refermé, on est lesté de plusieurs gros concepts que Goulven Le Brech a réussi à faire suffisamment apparaître pour donner envie d’aller plus loin. Il appartiendra ensuite à chacun de les étudier de plus près. Pour cela il a fait le choix particulier de prendre comme matrice de départ le premier essai que Powys écrivit à l’âge de quarante-huit ans, La vision complexe, sur lequel il consacre l’important premier chapitre qui agit à son tour comme matrice du livre. La vision complexe étant hélas introuvable aujourd’hui, on ne peut que remercier l’auteur d’avoir fait une très bonne synthèse de ses quatorze chapitres, jusqu’à détailler les plus importants. Pour lui en effet, les idées force qui structurent la pensée de Powys prennent naissance dans ce premier essai. On peut les regrouper en quatre ensembles qui sont intimement liés et donc se recoupent.
Le premier concerne le principe de volonté comme principe premier pour atteindre le bonheur malgré toutes les vicissitudes de la vie. Pour Powys en effet, l’harmonie avec soi-même s’obtient par un combat permanent contre l’adversité, représenté notamment par la façon dont s’organise la société moderne. Afin de lutter contre [l’état dépressif], l’individu a la capacité de se rapporter aux objets qui l’environnent non seulement par la raison et la sensation, mais aussi par l’éventail des ouvertures de la conscience au monde qu’offrent la volonté, le sens esthétique, l’imagination, la mémoire, la sensation, l’instinct, l’intuition et l’émotion. Mais, est-il précisé fort heureusement, la philosophie de la vision complexe n’a rien à voir avec la jouissance et n’est pas une nouvelle forme d’hédonisme. Pour Powys, le but de la vie dans sa haute signification philosophique n’est pas la recherche de la jouissance, mais l’art de ne pas s’attarder sur les moments de déplaisir (on pourra lire dans L’art d’oublier le déplaisir, comment Powys développe cette idée). La note en bas de la page 57 est à ce titre éloquente, tirée d’un passage de Une philosophie de la solitude : « …à chaque crise, quand nous sommes harassés, surmenés, poursuivis, persécutés, totalement confondus, misérablement humiliés, nous avons besoin d’une image mentale significative à laquelle nous puissions sans délais recourir, image qui soit en même temps un acte et une idée, une peinture mentale et une incitation à l’effort psychologique, image qui représente déjà en soi-même un effort psychologique. ».
Le deuxième ensemble conceptuel porte sur le fait de convoquer la culture pour combattre l’adversité (les ennuis quotidiens, la médiocrité de la vie moderne). Ce concept est très important. Dans notre société appelée post-moderne, où toutes les valeurs se valent, où il faut être consensuel en toutes choses pour ne pas choquer et où les mots ont perdu leur véritable sens, le mot culture est l’un des plus galvaudés. Le Brech présente très efficacement la pensée de Powys dans ce domaine en exprimant clairement les choses pour éviter les confusions. Powys insiste sur le fait que la culture, comprise comme le développement de soi, n’a rien à voir avec l’érudition. Effectivement ! Et plus loin il ajoute : [Powys] distingue par conséquent l’attitude de l’homme cultivé avec l’attitude de l’homme éduqué. Ce dernier, même doté d’une grande érudition, s’il ne conçoit pas le développement de sa culture comme un moyen de densifier son rapport personnel à la vie et se sert uniquement de ses connaissances pour briller en société, n’a rien de commun avec l’homme cultivé. L’intelligentsia germanopratine appréciera !!! Plus loin encore : La culture […/…] est, selon Powys, une attitude personnelle adoptée face aux vicissitudes de la vie, qu’il convient d’élargir et d’approfondir tout au long de son existence. […/…]. Face aux aléas de l’existence, face aux diktats de la science et de la religion, face aux nécessités économiques de son pays, la culture est le socle inaliénable à partir duquel chaque individu se construit. De la culture, on passe bien sûr à la littérature comme principe actif dans la vie quotidienne et non pas comme un stock froid de connaissances livresques. Conscient des maux de la société […/…], des horreurs perpétrées un peu partout sur la surface de la Terre […/…], son attitude se nourrit de l’ironie désabusée qu’il trouve dans les œuvres des […/…] grands écrivains et poètes. Son optimisme forcené n’est pas sans ignorer par exemple les tourments de l’homme du souterrain de Dostoïevski ou les errements de Jim dans Lord Jim de Conrad. On ne peut éviter de penser ici aux travaux de Frédérique Leichter Flack qu’elle a présentés dans son livre Le laboratoire des cas de conscience. Le Brech nous donne un très bel exemple d’application de ce principe powysien à travers un long extrait d’un de ses essais écrit en 1929 : Le sens de la culture (pages 49 à 51) qu’on laisse aux lecteurs le soin de savourer.
Le troisième concept a trait à l’érection de l’imagination créatrice comme antidote à la mort sociale et intellectuelle. Même s’il recoupe les thèmes précédents, ce principe philosophique, développé dans La vision complexe, est un fil rouge qui traverse tous les récits de Powys, notamment ses grands romans (Givre et sang, Wolf Solent, Les sables de la mer…). C’est une attitude mentale de refuge de la conscience grâce au pouvoir sans borne de l’imagination. Cette conscience est comparée à un instrument précieux qu’il faut maintenir vivant. Philosopher consiste à maintenir pur l’éclat de ce cristal […/…] et le polir sans cesse. Empruntant aux philosophes William James (1842-1910) et surtout Henri Bergson (1859-1941) et en convergence par ailleurs avec le courant de l’individualisme-anarchisme John Cowper Powys affirme l’irréductible liberté créatrice [qui se trouve] au cœur de l’homme. Il partage avec les penseurs de ce courant la conviction que les hommes peuvent être libres et égaux, non par le biais de l’action d’organisations collectives, mais par leur propre effort individuel. Pour développer ce point, Le Brech s’appuie sur un ouvrage de David Goodway : Anarchist seeds beneath the snow – left-libertarian thought and british writers from William Morris to Colin Ward, où est établie une filiation entre Powys et des auteurs comme Oscar Wilde, Herbert Read, Aldous Huxley ou George Orwell.
Mais, s’agissant à la fois de ce dernier auteur, et dans la mesure où Le Brech indique dans sa préface la pertinence de l’œuvre de Powys encore aujourd’hui, on aurait pu citer comme référence contemporaine, à la fois sur la philosophie anarchiste et sur l’infinie puissance créatrice du cerveau humain, un auteur aussi essentiel que Noam Chomsky, dont les travaux en linguistique et les conceptions philosophiques anarchistes sont en rapport avec le sujet.
Plus loin, sur la force de l’imagination créatrice, Le Brech n’oublie pas d’indiquer que Powys insiste en particulier sur le sens esthétique qu’il place au-dessus […/…] car orienté vers les racine mêmes de la vie. […/…]. Néanmoins, il ne s’agit pas pour l’artiste, l’écrivain ou le poète d’exercer son talent uniquement en direction de hautes idées esthétiques et morales, car ce qui est révélé par le sens esthétique est aussi une lutte, un conflit, une guerre, une contradiction, situés au cœur des choses. Le sens esthétique ne révèle pas seulement la beauté et le bien, il révèle aussi le grotesque, l’étrange, le scandaleux, l’indécent et le diabolique. Ceci nous renvoie aux travaux du philosophe Jacques Rancière et notamment à un de ses derniers ouvrages Aisthesis : Scènes du régime esthétique de l'art dans lequel il dresse une sorte de contre-histoire de la modernité artistique en s’interrogeant sur la notion d’événement culturel et en montrant que le sens artistique se transforme en accueillant des images et des objets opposés à l’idée du beau.
Le dernier concept, la philosophie ichtyosaure ou le concept de la Cause Première est exposé dans un chapitre particulier. C’est sans doute le principe le plus original développé et pratiqué par John Cowper Powys au long de sa vie. Exprimé la première fois dans La vision complexe, il y développe le fait que chaque être vivant, chaque élément naturel possède une personnalité, une conscience propre ou âme-monade unique […/…]. Sur le plan cosmogonique, Powys explique que ces âmes-monades existaient déjà il y a des millions d’années. […/…]. La conscience de soi, élément primordial de l’âme-monade de l’homme était présente dans un état rudimentaire dans des temps immémoriaux, quand il n’existait ni plantes, ni animaux, ni terre, ni mer, mais une nébuleuse. Même si ce n’est pas cité ici, on pense à l’univers de H. P. Lovecraft qui part du même postulat mais en le développant dans le fantastique monstrueux.
Il s’agit donc d’adopter la position vertueuse consistant à pratiquer une conscience immanente et poétique du monde, étendue aux domaines du végétal et du minéral ; jusqu’à être l’égal du plus petit insecte, du moindre caillou ou de la plus fragile plante. Revenu au Pays de Galles, il suggère à son lecteur de s’imaginer dans la peau d’un chétif insecte, tel un banal et inoffensif ver de terre. En se plaçant de ce point de vue, le lecteur situera son illusion vitale au degré le plus bas qu’il soit et ne sera plus choqué et meurtri par les outrances qui lui sont infligées au quotidien. Plus loin : « …ce mode de vie […/…] consiste à affirmer, dans le secret de son for intérieur, son égoïsme contemplatif à l’encontre de l’égoïsme vulgaire faisant de la quête du plaisir grossier, actif, grégaire qui représente l’essentiel de la vie des esclaves de notre temps, asservis qu’ils sont à la Machine… ». Plus loin encore : «…l’égoïsme ichtyosaurien, indolent et rêveur, s’opposant à l’égoïsme terre à terre et atrabilaire de l’homme moyen, n’est pas synonyme de repli sur soi ou d’amour propre. Il est au contraire un facteur d’ouverture vers autrui car pour celui ou celle qui se place du point de vue éternel et immuable des éléments, les différences et les barrières créées par la société n’ont plus lieu d’être… ».
Le Brech souligne à juste titre ici l’ombre de Jean-Jacques Rousseau et des stoïciens et précise que pour Powys, cette attitude relevait quasiment d’une sorte de nouvelle religion païenne dont il se serait fait le prophète pour montrer l’extase d’être simplement en vie sur la terre. On est évidemment loin des thèses et des pratiques pullulantes de la psychanalyse d’aujourd’hui, devenue la nouvelle religion des temps modernes ; psychanalyse que Powys, à la fin de sa vie, avait en aversion et qu’il jugeait antiphilosophique. Considérant l’inconscient comme l’enfer des prédicateurs d’autrefois, il suggère d’ailleurs à son lecteur d’être son propre psychiatre.
John Cowper Powys - Une philosophie de la vie est un livre qui a été écrit pour mettre en appétit le lecteur, l’invitant à entrer dans l’œuvre protéïforme de Powys. S’agissant d’une « introduction à », on aurait toutefois aimé que Goulven Le Brech propose, aux lecteurs, en aparté, une autre voie d’accès, celle qui est généralement recommandée par les fervents powysiens, à savoir commencer par « Autobiographie » qui est de l’avis quasi unanime, le point de départ au voyage. Puis alterner, sur le plan chronologique, romans et essais car ils sont intimement liés, en se réservant les derniers romans (La fosse aux Chiens, Atlantis, Owen Glendower, Morwyn, Porius) pour la fin, car leur complexité est due au fait qu’ils réunissent tous les thèmes powysiens à la fois, n’hésitant pas à mêler personnages historiques, fictionnels et mythologiques, tout en les émaillant de ses principes philosophiques.
Une question, philosophique, restera sans réponse. Comment Powys arrivait-il à concilier ces deux valeurs antagoniques qu’il érigeait comme principes : d’une part l’articulation de l’état ichtyosaure, où règne la primauté des sens de la façon la plus primitive possible, sans intervention de la Raison donc ; et d’autre part, la convocation du fonds culturel et littéraire pour chasser les déplaisirs, qui relève, lui, d’une position totalement opposée puisqu’il repose sur un niveau supérieur et élaboré de l’individu.
Goulven Le Brech termine son essai par un très bel extrait de Powys, qui mérite d’être cité in extenso : « …supposons que je sois cloué sur mon lit dans une de ces petites maisons toutes semblables, noircies par la fumée, quelque part entre Birmingham et Wolverhampton, et que j’aie seulement de pâles souvenirs de jeunesse, randonnées de vacances dans le région avec étapes à l’auberge ou chez d’aimables logeuses. Je ne suis pas sûr que certaines des grandes vérités des Anciens sur lesquelles repose ma philosophie ne me permettraient pas, après tout, de m’en sortir. Peut être, quand je verrais des gouttes de pluie sur ma vitre, ou la fumée de la maison d’en face, ou une branche de frêne portant encore exactement onze feuilles, telle ou telle pensée célèbre d’Héraclite, de Pythagore, de Rabelais, de Goethe ou de Walt Whitman me tirerait d’affaire, transformant en un triomphe le combat qu’en cymrique obstiné je mène pour me contraindre à jouir de la vie. »
On ne peut éviter, en lisant ces lignes de penser à un autre témoignage tout autant émouvant ; celui de Tony Judt, écrivain, historien anglais, penseur à contre-courant des mythes intellectuels européens, né de parents juifs, et devenu progressivement antisioniste, voire pro-palestinien, mort il y a deux ans. Dans ses mémoires parues sous le titre Le chalet de la mémoire il y décrit librement, alors qu’il est atteint de la maladie de Charcot, sa quadriplégie (perte de la voix, des membres, perte des sensations, puis immobilité totale) et la façon dont il arrive à vivre malgré tout avec bonheur : « …plus de sensations, mais pas de douleur. On est donc libre de contempler à loisir la catastrophique progression de sa propre dégradation. Ma solution a été de dérouler ma vie, mes pensées, mon imagination, mes souvenirs, exacts ou déformés, et ainsi de suite jusqu’à tomber par hasard sur des événements, des personnes ou des récits dont je puisse me servir pour distraire mon esprit du corps dans lequel il est engoncé. Je me réjouis de pouvoir utiliser les mots. Ils sont tout ce que nous avons. »
John Cowper Powys aurait certainement apprécié.
*
Et la philosophie de Powys pour les nuls ?

Nous entendons par là ceux qui, l’ayant lu dans tous les sens possibles, ne savent pas quel rapport il peut y avoir entre leur inclassable auteur et les « vrais » philosophes, les patentés, ceux qui ont laissé un nom « de philosophe » dans l’histoire.
Pas un vrai philosophe, Powys ? Euh... Si, comme le démontrent fort bien MM. Le Brech et Lecèdre. Mais pas un philosophe doté d’un système déterminé bien à lui. Pas un Descartes, un Spinoza, pas un Hume, pas un Nietzsche (même si Nietzsche l’a fasciné).
C’est qu’à nos yeux d’autodidactes, Powys paraît plutôt avoir été un pragmatique, voire un empirique de la philosophie ; quelqu’un en tout cas qui tenait pour certain qu’aucun système philosophique n’a jamais aidé personne à vivre. D’où, semble-t-il, la forme prise par ses ouvrages philosophiques, ambitieux ou modestes, qui se présentent surtout, pour certains, comme de petits vade-mecum, des manuels pratiques destinés avant tout à aider les humains dans leurs efforts quotidiens d’adaptation aux aléas de la vie.
Il y a eu aussi des raisons pratiques à cela : un certain nombre de ces écrits lui ont été commandés par des éditeurs américains, à l’intention d’un public U.S. très friand de ces choses.
[ Lorsqu’il sillonnait « tous les Etats Unis sauf deux », y donnant plus de dix mille conférences devant toutes les sortes de publics imaginables, il avait pour compagnon d’écurie, si on ose ainsi parler, son ami-ennemi de toute une vie, le trop méconnu écrivain édouardien Louis Wilkinson (« Louis Marlowe »), lequel, le voyant un jour en action, ne put s’empêcher de s’écrier « et, en plus, il les aime ! » ]
Cette rencontre de Powys avec le public américain des années 10, 20 et 30, avec ses aspirations et ses particularités – qualités pour les uns, travers pour les autres – est à ne jamais oublier quand on pense à John Cowper Powys philosophe de la vie et adversaire des systèmes philosophiques. De cette période et de ces nécessités (oui, certains des manuels de philosophie de Powys furent des potboilers), sont sortis The War and Culture, The Complex Vision, Psychoanalysis and morality, The Secret of Self-Development, The Art of Forgetting the Unpleasant, A philosophy of Solitude, The Art of Happiness, The Art of Growing Old et In Spite of, sinon l’Apologie des sens. Par ailleurs, Le Brech et après lui Lecèdre le font bien comprendre, Obstinate Cymric ou Ma philosophie à ce jour telle que me l’inspire ma vie au Pays de Galles a été au contraire l’expression d’une véritable nécessité interne. Il ne faut pas oublier non plus que, simultanément, Powys n’a pas cessé d’approfondir sa connaissance de Lao Tseu et surtout de Tchouang-Tseu, que lui avait fait découvrir sa compagne américaine, Phyllis Playter.
Et, bien sûr, il y a eu Rousseau !
Votre servante ne se pardonnera jamais d’avoir essayé de convertir l’historien Henri Guillemin à Powys en lui donnant à lire l’essai sur Jean-Jacques, extrait de Suspended Judgements. Pas du tout convaincu, le flamboyant catholique, par ce qui n’était en effet pas « son » Rousseau, mais un autoportrait éhonté du flamboyant gallois. Et pourtant, il y a du vrai Rousseau quand même dans ces quelques pages. On a l’impression, en les lisant, d’avoir sous les yeux un hologramme, où tantôt le visage de l’un tantôt celui de l’autre apparaissent. Bref, on n’a pas fini de sonder Rousseau, on n’a pas fini de sonder Powys, et on n’a pas fini de méditer sur leurs troublantes et profondes ressemblances.
Ce qui affleure en définitive, de la montagne d’écrits (essais, romans, analyses dithyrambiques, poèmes, correspondance, journal) c’est une espèce de recherche du bonheur. Ou, pour mieux dire, une définition de ce que pourrait être le bonheur, mais aussi et surtout de ce qu’il n’est pas, des voies d’accès possibles, de celles qui sont légitimes et de celles qui ne le sont pas, souvent par le biais des mille cas de conscience qui se posent à des personnages de roman, dont chacun est l’auteur lui-même.
Peut-on l’appeler une philosophie ?
Risquons-nous-y.
Il nous paraît évident qu’il n’existait pas, pour Powys, de bonheur imaginable en dehors de la contemplation. On a rarement exécré autant que lui les gens actifs. Ce que nous appelons contemplation allait, dans son cas, jusqu’à une communion totale, une fusion avec tout et n’importe quoi, puisqu'on sait qu'il convoquait à volonté l'extase à partir d'un peu de lichen sur un vieux mur. Ses moments de bonheur le plus intense – et qu’il a réussi à communiquer dans ses œuvres – donnent une impression de dilatation empathique vers tout, de « perméabilisation » à tout ce qui est matière (ou éther) en quoi se fondre ou se perdre, une forme de communion avec tout ce qui existe, atome par atome, ion par ion et ainsi jusqu’au plus infime. Il ne s’est pas pour rien inventé le mot « multivers », univers ne lui suffisant pas. Car ce drôle d’homme que d’aucuns prennent pour un mystique fut peut-être le plus grand matérialiste de tous les temps. Matérialiste au point de diviniser la matière, de l’appeler Déméter, de la prier lorsqu’il assistait à la messe dite par son fils, prêtre catholique, et de s’en confier à l’officiant, s’attirant un désolé « Papa, tu blasphèmes», qu’il balayait d’un « Mais non, mon petit, c’est toi, n’importe, l’essentiel est que tu sois heureux ».
Et voilà, on y revient. Au bonheur.
Lequel ne va pas, nous l’avons dit, sans questions corollaires , dont la principale était : « Comment jouir d’un bonheur légitime, c’est-à-dire de manière inoffensive ? » Ceci n’étant pas une clause de style, car Powys a souffert toute sa vie et jusqu’à un âge très avancé, de pulsions sadiques. Le soulagement qu’il a exprimé lorsque, enfin, sa libido a lâché prise, en témoigne, et témoigne en passant de l’origine sexuelle du sadisme, si jamais quelqu’un en doutait.
Petite digression historique à propos de philosophie
Une des notions qui se retrouve de manière presque obsessionnelle chez Powys est que la plupart des malheurs des hommes leur viennent d’une fausse conception du bonheur. Le vrai bonheur, idée toujours neuve en Europe, bien plus qu’on ne le croit ! Il nous semble que cette quête du bonheur et cette interrogation sur sa nature rendent Powys très proche de ceux qui ont posé pour la première fois la question non pas philosophiquement mais politiquement.
Difficile pourtant d’imaginer hommes plus dissemblables que ce pur produit de l’ère victorienne, descendant d’une longue théorie de prêtres poètes (John Donne et Francis Cowper entre autres) et les jeunes juristes fondateurs de la première vraie démocratie. Cependant, quoi qu’il ait nourri à leur égard les préventions de qui a lu Burke plutôt que Stanhope, il y a une parenté philosophique réelle entre John Cowper Powys et cette poignée de jacobins qui a rêvé de poser les bases du bonheur du monde.
Après tout, pourquoi l’ami d’Emma Goldman n’eût-il pas pu être aussi celui d'un Marat aussi maltraité qu'elle ? Et, bien sûr, lien essentiel entre eux et lui, il y a Rousseau, même si le Rousseau de Powys est celui des Rêveries et le leur celui du Contrat social.
Ce qu’il y a de sûr et d’important, c’est que le chemin qu’ils ont pris passe par le même chas d’aiguille : celui de l’individualisme (voilà qui surprendra ceux qui ont fait de Maximilien Robespierre l’ancêtre du collectivisme, en le prenant pour Babeuf). Cette voie de l’individualisme non égoïste est la voie la plus longue et la plus difficile qui soit. C’est la seule aussi qui ne soit pas sans issue.
Certes, les explorateurs partis, en 1793 à la découverte de cette dimension encore inconnue, ont dû verser le sang, ne fût-ce qu’à la guerre. A Powys aussi, il est arrivé de faire du mal, à ceux surtout qui lui étaient les plus proches. La biographie que lui a consacrée le Dr. Morine Krissdottir ne permet pas d’en douter. Cela n’infirme rien. Nous sommes des créatures faillibles, incomplètes, inachevées, et les révolutions ne se font pas in vitro.
Par ailleurs, nous avons la conviction profonde, absolue, que le lien originel, organique, la racine commune à l’excentrique Gallois et aux renverseurs de trônes, ce n’est pas tant Rousseau que Rabelais, grand-père de notre République et notre premier prophète du bonheur.
Powys lui a voué un culte. En le prenant pour un quaker, certes, mais en le comprenant aussi, sur certains points très intimes, infiniment mieux que les plus autorisés seizièmistes.
Des choses que Powys n’a pas sues mais qui furent.
Quand l'occasion s'en présentera, il faudra que nous vous racontions plus à loisir comment François Villon s’est trouvé un jour à décider du sort futur de la France, en prenant, devant un petit couteau taché de sang, une décision de juriste aux conséquences incalculables. Rabelais et ses contemporains (Dolet, entre autres) ont profondément admiré Villon. Pas seulement pour ses vers sublimes, soyons-en sûrs.
La transgression de Villon et celle des régicides furent du même ordre. Et la question du bonheur avait été, dès la première, posée.
Après, il n’y avait plus qu’à laisser glisser. Rabelais n’avait plus qu’à imaginer la manière idéale de gouverner (par la persuasion) ; son verbe n’avait plus qu’à se faire chair, et Saint-Just n’avait plus qu’à attirer notre attention sur l’idée neuve du bonheur. En Europe. Car il est vrai que Lao Tseu et Tchouang Tseu ne sont pas rien.
Des choses que Powys et lui seul a sues
Rabelais a passé et passe encore, dans cette révolution qui n’est pas finie, pour un misogyne. Rien n’est plus faux. Il fut, en revanche, indéniablement matriphobe, ce qui est bien plus radical encore qu’il n’y paraît, s’agissant d’en finir avec le pouvoir infantilisant du patriarcat. Or, ce n’est pas Abel Lefranc, ni Manuel de Dieguez, ni Jean Paris, ni Mikhaïl Bakhtine qui ont mis le doigt sur la blessure jamais refermée qui fut à l’origine de sa détestation des mères, étendue de la sienne à celles de ses enfants, c’est Powys – le grand imaginatif – s’identifiant au gamin de six ans et demi habillé, tondu et trahi par celle qui lui avait donné le jour, c’est-à-dire envoyé par elle à la mort civile, sous couleur d’aller « voir le geai parleur de l’oncle Frapin ».
Et puisqu’on en est là, comment ne pas se rappeler le jeune Saint-Just trahi lui aussi par sa mère, sans s’étonner de ce que les deux fils aient traité leurs génitrices respectives de « simpiternelles » (avec un i, dans les deux cas) et se soient semblablement soignés comme ils pouvaient : par le rire.
Rabelais n’a jamais pardonné. Saint-Just, au moment d’aller « chercher la mort » à Fleurus et d'y conduire trois fois la charge sans une égratignure, a fait un crochet par Blérancourt pour s’y réconcilier avec la terrible Marie Anne. Selon toute apparence être trahi à la fin de l’adolescence ou à «même pas sept ans» n’est pas tout à fait la même chose.
Fin de la parenthèse « Philosophie du bonheur et histoire de France. »

*
Que reste-t-il à découvrir de Powys pour les francophones ?
Malgré le très grand nombre d’œuvres déjà publiées en français, il en reste. A commencer par son mastodonte de chef d’œuvre, Porius – 1589 pages de manuscrit – qu’aucun éditeur n’a pris le risque, au moment où il fut écrit, de publier intégralement. Après qu’il eût, la mort dans l’âme, réduit son roman de plus d’un tiers et que MacDonald eût accepté de le publier, en 1951, comprimé en 600 pages, il restait à l’auteur 15 £ à la banque.
Nous l’avons lu, pour notre part dans l’édition spartiate, à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux, de l’intrépide Jeffrey Kwintner.
![6. powys_porius_1 - thumb[2].jpg](1845508733.jpg)
John Cowper Powys
PORIUS
Londres, The Village Press, 1974.
Il a fallu des années à d’érudits powysiens des deux côtés de l’Atlantique, pour restaurer autant que faire se pouvait le texte d’origine. Cela se passa en deux temps. La première version (la plus longue) fut celle de Wilbur T. Albrecht (1994, Colgate University Press).

Porius: A Romance of the Dark Ages
Powys, John Cowper; Albrecht, Wilbur T. (Editor & Foreword)
Elle fut suivie, en 2007, de la version estimée définitive :

John Cowper Powys
PORIUS - A novel
Edited by Judith Bond et Morine Krissdottir
Overlook – Duckworth & C° Ltd.
Réimpression en 2011
Ambitieux projet que celui de peindre ce « blank century » (le Ve A.D.) d’un Pays de Galles abandonné par les impériaux romains (oui, comme demain le seront l’Afghanistan, l’Irak et la Palestine), où Artur, dux bellorum, impatient de prendre leur suite, piaffe, sa féodalité sous le bras., dans les coulisses. Un Pays de Galles avec son matriarcat en fin de règne (« nos grands-mères, les reines de Marrakech », c’est là), et ses strates de populations diverses : autochtones sans nom, dits « gens de la forêt », Gaëls, Gallo-Romains, envahisseurs vikings et, déjà, missionnaires chrétiens. Avec, même, ses derniers géants, mais aussi (multivers oblige) ses règnes cohabitants : humains, animaux, végétaux et minéraux.
Qui peut oublier cette langue de petit chien sur le museau d’une jument morte, surprise d’y rencontrer un insecte « de la famille des scarabées » qu’elle dérange ? Qui peut oublier la première apparition de Merlin, où Powys, par le verbe, égale le Goya du Colosse ?
Où est passée l’édition française capable de publier un tel livre ? Celle qui en aurait l’audace n’en a pas les moyens. Celle qui en a les moyens… passons.
Mais à côté des œuvres-montagnes, il y a aussi chez Powys les œuvres-miniatures, si on peut les qualifier ainsi. Nous voulons parler des contes philosophiques et autres fictions de l’espace de la «seconde enfance» revendiquée de l’auteur.
Comme Shakespeare en fin de vie, Powys en fin de vie a touché à la suprême légèreté de son art. Un art épuré des tragédies comme des idées reçues, tout lest jeté par-dessus bord.
Cette légèreté a passé chez lui par la revisitation des Grecs (après tout, il est mort en traduisant Aristophane), et par Grecs, il faut entendre les dieux, l’Iliade et l’Odyssée, à l’exclusion, répétons-le, des tragédies. A ce multivers enchanté de son enfance d’écolier se sont ajoutées les spéculations cosmiques de son grand âge. C’était dix ans avant Gagarine, mais on y tendait, et que voulez-vous, les planètes faisaient rêver. C’était l’époque du Matin des Magiciens, de Pauwels et Bergier et de tous leurs semblables – dieusait qu’il y en eut – mais pas de SF pour Powys ! « Science » était, chez lui, un mot anathème (qui manque à l’abécédaire de M. Hamelin). La volonté, la contemplation, l’identification avec chaque atome de la matière suffisaient à faire s’élever dans les airs des quartiers entiers de Londres, avec leurs caves et leurs égouts. Les fantômes d’humains et les fantômes d’objets y partaient ensemble en voyage, à la découverte aussi bien de Venise et de Florence que de Mars et de Vénus, de l’Erèbe et du Tartare, et même du Paradis, où saint Pierre, saint Paul et les anges, affolés, cherchaient Dieu sans évidemment le trouver puisque Dieu était mort (la faute à Voltaire et Nietzsche ne l’avait-il pas dit ?), Paradis autour duquel rôdait un Diable SDF, que la disparition de son ennemi avait privé de son foyer, l’Enfer, c’est bien connu, n’ayant jamais existé que dans la tête de Dieu …
Ces petits contes de sa vieillesse sont, nous le craignons, considérés avec un rien de condescendance par les savants exégètes de Powys. Ils ne vont pas jusqu’à oser penser le mot « gâtisme », mais on le sent voleter. Feu François-Xavier Jaujard avait le projet d’en faire une anthologie. Il est mort trop tôt, à tous égards.
Enfin, il reste, entre ces extrêmes, un superbe roman de longueur normale, que personne encore n’a songé à publier en français et qui ferait à notre avis très bel effet dans le catalogue des Perséides.
ATLANTIS

Pourquoi vous en parler ? Parce qu’il offre un bel exemple de la manière dont fonctionnait l’imaginaire de John Cowper Powys.
Certes, on a déjà vu, avec Le Hibou, le Canard et… Miss Rowe ! Miss Rowe !, comment un tableau célèbre pouvait servir de point de départ, de tremplin en quelque sorte, à une histoire mêlant les animés et les inanimés. Le lecteur curieux a peut-être déjà repéré le hibou philosophe embrassé par son assassin et ami, le canard voyeur et le cheval blanc à qui manquent les pattes de devant, là où Powys les a trouvés lors d’un voyage qu’il fit en Espagne en passant par la Belgique, sinon, il ira les chercher, au Musée du Prado, dans Le Jardin des Délices, de Jérôme Bosch :



Alors que pour le poisson à la bouche ouverte, il lui faudra aller scruter La Tentation de Saint-Antoine . Même peintre, même voyage.

L’’histoire de la genèse d’Atlantis est plus curieuse.
Quelqu’un a mentionné le poème « Ulysse » de Tennyson, qui lui aurait été suggéré comme point de départ, mais il n’y a tout simplement aucun rapport entre l’héroïsme de Tennyson et l’espèce de comédie métaphysique de Powys, même s’il est certain qu’il l’a lu.
Nous avons parlé plus haut du Matin des Magiciens et des spéculations de l’époque. Il parut en 1954, chez Denoël, un petit livre de ce genre intitulé L’Atlantide et le règne des géants, dont l’auteur était Denis Saurat. Qui ne l’a lu, alors ? Il était dans l’air du temps. Certes, il fallait beaucoup de bonne volonté pour suivre l’auteur dans ses reconstitutions, preuves délirantes à l’appui, d’un passé fantasmatique (ah, ces deux lunes successives qui nous sont tombées dessus en attendant la troisième) et qui trahissait même une mentalité aussi discutable que répandue (ah, ces sempiternelles élites venues d’ailleurs pour expliquer tout ce que ces minus d’humains ne pouvaient avoir fait eux-mêmes !).
Les deux livres ayant paru la même année, il est impossible de dire si Powys s’est inspiré de Saurat ou plutôt, si les élucubrations de Saurat ont servi de tremplin à l’imagination de Powys. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a, dans sa correspondance, une lettre où il recommande chaudement la lecture de ce livre. A qui ? Notre mémoire flanche… (et avons-nous dit que notre bibliothèque est dans un garage ?).
Une au moins des illustrations qui s’y trouvent offre des ressemblances troublantes avec un de ses propres dessins : aucun familier de Powys ne peut avoir oublié la lettre où il s’est représenté gravissant une colline, son bâton Sacré à la main, dessin tellement semblable à celui-ci :

Quoi qu’il en soit de Tennyson, de Saurat ou de son propre multivers sans limites, Atlantis raconte l’histoire du dernier voyage d’Ulysse, qu’on peut considérer comme une sorte d’Odyssée à l’envers.
Résumons.
Lorsque débute cette histoire, il y a de la révolution dans l’air, sur terre et dans le Cosmos. Les habitants d’Atlantis ont préféré la science aux dieux et, comme on sait, quand les hommes cessent de croire en eux, les dieux disparaissent. En outre, les anciens dieux s’y sont mis pour les déloger du pouvoir. Quoiqu’affaiblis, les Olympiens se sont vengés sur les Atlantes en engloutissant l’orgueilleuse et mécréante mégalopole au fond de l’océan.
Rumeurs de révolution aussi dans la provinciale Ithaque, dont les habitants sont divisés en progressistes et conservateurs. Le trône d’Ulysse vacille, et pour tout dire, le vieil aventurier nourrit le projet de tout abandonner, de laisser ses compatriotes se débrouiller entre eux et de re-hisser la voile sans espoir de retour. Vers l’ouest… Car un désir incoercible le pousse à chercher l’Atlantide engloutie et à descendre voir ce qu’il en reste. Il le fera, c’est un des passages les plus réussis du livre.
En attendant, tout le monde – entendez par là toutes les créatures animées ou inanimées – a son avis sur la chose et l’exprime. On se croirait sur Internet.
Ainsi, l’action est commentée par un drôle de chœur antique fait d’un moucheron et d’une mite, qui vivent une torride histoire d’amour inter-espèces dans une fente du gourdin d’Ulysse, très fier (le gourdin) d’avoir été celui d’Héraclès et d’avoir, lui et lui seul, tué le lion de Némée. Participent aussi aux conciliabules un pilier de pierre de l’entrée du palais et une pousse d’olivier qui a surgi entre les dalles. Sans parler de la dryade Kleta, qui vit dans un très vieil arbre, au fond du jardin, et avec qui Ulysse, les nuits d’insomnie, va volontiers faire la causette, jusqu’à ce que Zeus, mesquin mais disposant encore d’un tout petit tonnerre, la foudroie et son arbre avec elle. Les dieux sont mauvais perdants.
L’équipage d’Ulysse - rien à voir avec celui qui l’a ramené de Troie – sera hétéroclite. En feront partie, outre le gourdin et ses deux insectes, un jeune homme dont Ulysse a fait son fils adoptif, Nausicaa, venue revoir son béguin de jeunesse et prête, cette fois, à l’accompagner où qu’il aille, Zeuks, fils de Pan (vous le voyez, mon petit blasphème ?). qui n’est autre que Rabelais en fermier d’Ithaque, plus une captive troyenne, fille inconsolée d’Hector, du nom d’Arsinoé. Le reste à l’avenant.
Powys, grâces lui en soient rendues, n’a jamais tenté de rendre ses inventions vraisemblables, et il est clair qu’au moment où il a écrit cette histoire, il avait définitivement jeté tout contrôle au vent. A l’opposé exact de M. Saurat, dont les inventions à prétentions réalistes n’ont rien à voir non plus avec la folle du logis (et les astres) de Cyrano.
Aux dernières nouvelles (2011-12), l’Atlantide serait une partie de la Sardaigne, engloutie par un tsunami un demi siècle avant la naissance de Platon. Pour Powys, c’est n’importe où entre Ithaque et l’Amérique. Pour Saurat, c’est chez les Incas, du côté de Tiahuanaco (si, si !).
Revenons-y donc à L’Atlantide et le règne des géants, dont une autre illustration a ou n’a pas donné des idées à John Cowper Powys. Elle nous permettra au moins d’établir le dinstingo entre les deux sortes d’inspiration. Le dessin est celui-ci :

Il représente un ensemble totémique observé chez les Malekula de Nouvelle Guinée (qui, oui, au temps des géants, auraient eu des contacts avec les Indiens des Andes). Il est composé d’un menhir, d’un dolmen et d’une statue de bois. Le totem de pierre aurait été sculpté par les gigantales élites disparues, pour que les âmes de leurs morts puissent venir y habiter. Quant à celui de bois, considérablement décati, il serait l’œuvre des humains ordinaires, persuadés, avec leur cerveau d’homo à peine sapiens que, dans l’incapacité où ils sont de reproduire le totem de pierre, le simulacre en bois peint fera tout aussi bien l’affaire pour attirer à lui les âmes de leurs grands-pères, lesquelles, de là, auront peut-être l’idée d’aller loger dans le vrai : celui en pierre. C’est un peu compliqué, mais qui sait ?
Voici, résumé, le passage d’Atlantis qui peut correspondre à cela :
Arsinoé enfant a été amenée captive de Troie. Esclave, elle sert aux cuisines. Interdiction lui a été faite de quitter son costume national, qui permettrait de la repérer, au cas où l’idée lui viendrait de s’évader. Son étoile jaune, en quelque sorte, et sa burqa sans grille.
Il existe, non loin du palais, une sorte de Gaste Terre frappée par la foudre, où tout est mort et où personne, par crainte superstitieuse, n’ose s’aventurer. Sauf Arsinoé, parce que c’est là et là seulement qu’elle peut jouir d’une bienheureuse solitude, loin du regard de ses geôliers.
N’ayant jamais fait le deuil de son héros de père, elle y a, au fil du temps, sculpté dans un énorme tronc d’arbre mort, avec son petit couteau à légumes, une statue d’Hector assis en majesté. Et c’est grâce aux nombreux plis de sa robe de captive qu’elle a pu sortir du palais, une à une, en catimini, toutes les pièces en or de l’armement d’Achille, ces mêmes armes qui avaient semé la zizanie dans le camp des Grecs, lorsque Ulysse se les était fait attribuer, alors qu’elles auraient dû revenir au grand Ajax, proche parent du mort, et qui croupissaient, depuis, au fond d’une cave (bien la peine !) Et pourquoi l’inconsolable Arsinoé se livre-t-elle à ces dangereux larcins ? Eh, mais, pour en revêtir son père. Tout y est : le casque, le pectoral, les jambières, les lances et le grand bouclier.
Qu’on me croie sur parole : un jour arrive au port un navire, à bord duquel se trouve le grand Ajax, incroyablement vieux. Zeuks le fermier, chargé d’aller l’accueillir, le trouve en si mauvais état qu’il lui faut le transporter à califourchon sur ses épaules. Et comme il est, lui, sans peur, sans reproche et, donc, sans superstition, il prend un raccourci, à travers la fameuse Gaste Terre, où, à la vue de son ennemi mort, tout rutilant de l’or d’Achille, le cœur du grand Ajax a son premier raté. Quoi de plus naturel que de l’asseoir entre les jambes du Troyen ? C’est là qu’il meurt, la joue appuyée sur son héritage.
Quand on en est à ce point, Denis Saurat, le peut-être tremplin, et ses géants civilisateurs sont loin, très loin, à des années-lumière, et Powys, aux Champs-Elysées, fume des asphodèles avec Savinien.
Vous raconter la fin d’Atlantis ? A quoi bon déflorer votre plaisir futur ? Sachez seulement que nos voyageurs atteignent un jour l’île de Manhattan, où ils sont accueillis par de bienveillants indigènes, et que, décidés à n’en pas repartir, ils brûlent leur vaisseau.
*
De l’Atlantide engloutie par la colère des dieux aux lunes « capturées » par notre terre, en passant par la Dame Noire (météorite) de Pessinonte peut-être devenue celle de La Mecque, l’imaginaire humain n’a jamais cessé de jouer à se faire peur avec des catastrophes cosmiques passées ou futures. Pourtant, le président Poutine a bien dit que nous cesserons d’exister dans 4,5 milliards d'années. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler et nous avons encore plein de factures à payer. En dépit de quoi, M. Seiko Nakajo et les savants japonais de NHK ont passé leur temps à simuler l’impact d’un astéroïde sur la terre et nous le font voir en collaboration avec le NFB (National Film Board) du Canada.
Bienvenue aux amateurs de sensations fortes !
*
Une biographie
Parlant de Powys à des lecteurs qui ne le connaissent peut-être pas, nous nous en voudrions de passer sous silence une des biographies les plus impressionnantes qu’il nous ait été donné de lire depuis bien des années.

Morine Krissdottir, membre éminent de la Powys Society, l’a écrite, d’une part pour s’acquitter d’un devoir envers le fils de Marian Powys, Peter Gray, qui venait de se suicider, d’autre part, comme elle l'a elle-même précisé, pour « se le (J.C.P.) sortir du système ».
Le résultat n’a pas plu à tout le monde. C’est que l’image d’Epinal petit à petit forgée par des admirateurs bien intentionnés en sort écornée. Morine Krissdottir, qui n’a pas volé son titre de docteur en psychologie, a eu la très grande honnêteté – et le courage – de se pencher sur l’abîme d’une âme humaine peu commune (quelqu’un a parlé de « terrifiant labyrinthe »). Elle rapporte ce qu’elle y a vu et cru comprendre. Elle a eu raison. Si l’image a changé, la stature est intacte. On pourra difficilement faire mieux.

Morine Krissdottir
The Life of John Cowper Powys
DESCENTS of MEMORY
Overlook Duckworth, 2007
Le 11 octobre 2007, son livre étant sorti peu de temps auparavant, Morine Krissdottir a posté le billet que voici sur le Books Blog du Guardian.
Acquérir un goût pour John Cowper Powys
Posté par Dr. Morine Krissdottir
Jeudi 11 octobre 2007
Ce n’est pas un auteur que n’importe qui peut digérer, mais ceux qui l’aiment n’en sont jamais rassasiés.
Je viens de passer les cinq dernières années de ma vie à écrire la biographie d’un auteur que des tas de critiques détestent. John Cowper Powys est une espèce de « Marmite »1 littéraire.
Si vous adorez la Marmite, comme Iris Murdoch et John Bailey, vous voudrez lire Powys au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Si vous aimez que vos romans et vos auteurs soient sans complications, vous êtes l’oiseau de la pub récente qui, à peine y a-t-il goûté, s’enfuit à tire d’ailes. Soit vous pensez qu’il est un génie, soit qu’il est un charlatan sado-maso, chef du siphonné clan Powys. Le poète Philip Larkin a comparé Powys à un gigantesque volcan poético-mythologique ; son propre ami, Louis Wilkinson, déplorait qu’il pût écrire « des sottises aussi ridicules et fastidieuses ». Un critique a qualifié Les enchantements de Glastonbury de « roman épique d’une force terrible unie à une formidable intensité lyrique », et un autre en a décrit le premier paragraphe, surchargé de métaphysique, comme « Le Beecher’s Brook2 de la fiction anglaise ».
Les jeunes années de Powys furent assez ordinaires. Ses parents, le révérend C.F. Powys et Mary Cowper, son épouse, étaient de petite noblesse, John, l’aîné de 11 enfants reçut l’éducation qui convenait (Sherborne et Cambridge), fit un bon mariage et eut un fils. Il était destiné à mener une vie tout à fait conventionnelle dans le Sussex quand il décida subitement de tenter sa chance aux Etats-Unis, où il se lança dans une carrière de conférencier itinérant.
Son succès fut immédiat. Il attirait des foules énormes, qui écoutaient intensément et applaudissaient avec extase sa manière dramatique de discourir sur des auteurs célèbres. Parallèlement à cela, il s’était mis lui-même à écrire. Et, après quelques romans sans succès, il produisit un best seller, Wolf Solent.
En 1923, il rencontra une jeune Américaine, Phyllis Playter, et, avec l’argent que lui avait rapporté Wolf Solent, il se retira dans une maison du nord de l’état de New York, pour s’y consacrer à l’écriture à plein temps. C’est là qu’il écrivit deux autres romans sur la région de l’Ouest de l’Angleterre, Les enchantements de Glastonbury et Les sables de la mer, ainsi que son Autobiographie, qui est une des confessions les plus originales jamais écrites. A cette époque, son excentricité n’était plus un secret pour personne, ni son adhésion à une pensée magique, ni sa haine de la vie moderne. En 1934, il retourna au Royaume-Uni et, après une année passée dans le Dorset, il alla s’installer au Pays de Galles, où il écrivit ses deux étonnantes chroniques galloises, Owen Glendower et Porius. Il est quasiment impossible de résumer ses histoires tentaculaires, pleines de personnages étranges aux noms invraisemblables, mais, bien après qu’on en ait oublié les détails, ces romans continuent à vous hanter.
Powys a été décrit comme « une des grandes énigmes de la littérature du XXe siècle ». Pour ses détracteurs, il n’est qu’un mystagogue détraqué. Ses admirateurs en revanche, et ils sont nombreux, ont plus de mal à décrire ce qui, chez lui, s’empare de leur imagination. L’un des aspects fascinants de son génie est qu’il attire des lecteurs aux centres d’intérêt extrêmement variés, qui raffolent de ses romans pour des raisons très différentes – ses scènes comiques, ses fantasmes érotiques, ses images enchanteresses, sa finesse psychologique, sa philosophie de la vie.
On a bien du mal à ne pas identifier Powys aux anti-héros de ses romans, et ceux qui n’apprécient pas ce qu’ils perçoivent de sa personnalité sont également rebutés par ses personnages et ses intrigues.
D’une part, sa « conscience malade » exigeait qu’il passe beaucoup de sa vie à fournir un soutien émotionnel, par ses livres, ses conférences et ses lettres, aux jeunes disciples (presque toujours masculins) qui lui ont fait escorte sa vie durant et qui continuent à dévorer avec avidité ses livres de philosophie. D’autre part, pour avoir lu les parties non publiées de son journal et de sa correspondance, je sais à quel point il a pu être destructeur pour son entourage le plus proche, en particulier la compagne de quarante ans de sa vie, Phyllis Playter. En tant que psychologue, j’ai scruté sa vie autant que son œuvre. Pourtant, malgré toutes ces années passées à me glisser à travers les frontières de son esprit, je doute être jamais capable de savoir si Powys fut un puissant magicien ou un enfant perdu, terrifié à l’idée d’entrer quelque part, un clown ou un fou sacré, un écrivain des marges ou un écrivain marginal, mais cela n’a pas vraiment d’importance : je suis accrochée à l'hameçon.
______________
1 Pâte à tartiner anglaise, à base de concentré de viande.
2 La Rivière Beecher est un des principaux obstacles du Grand National, célèbre course de chevaux qui se déroule près de Liverpool. Elle est responsable de nombreuses chutes, dont plusieurs ont été mortelles.
Source :
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2007/oct/11/acquiringatasteforjohncow
traduction de Kahem
pour Les grosses orchades
*
La descendance de Powys
est trop importante pour qu’on n’en parle pas, bien qu’il ne faille y chercher aucune ressemblance directe. Disons pour être plus près de la vérité que John Cowper Powys peut se vanter d’avoir donné des idées au plus grand écrivain américain vivant.
Le plus ?... Ceci est notre opinion personnelle. Cependant, en 2000, le Writers’ Digest (ne pas confondre avec le Readers’ !) l’a classé parmi les cent meilleurs écrivains du XXe siècle, et la critique italienne Fernanda Pivano, a écrit de lui, dans le Corriere della Sera, qu’il était « l’écrivain le plus dangereux du monde ». Le plus dangereux ? Difficile à dire. Si on parle de l’ordre établi depuis dix mille ans – celui du patriarcat sous tous ses régimes et dans toutes ses religions – la Signora Pivano pourrait bien n'avoir pas tort. Le plus subversif en tout cas. Et de la même manière, surtout, que John Cowper Powys et nos propres fondateurs de la République : en passant par un individualisme sans faille, assumé jusqu’à l’héroïsme.
Là aussi, il semble bien que le dénominateur commun soit l’auteur de Pantagruel et de Gargantua. Nous avons beaucoup réfléchi avant d’oser dire que Tom ROBBINS est sans doute le Rabelais américain d’aujourd’hui. Et pourquoi diable l’histoire ne se répéterait-elle pas dans le bien comme elle le fait si obstinément dans le mal ?

Mais commençons par le commencement. Dès son tout premier livre, écrit en 1967 et publié en 1971, Une bien étrange attraction, (l ‘édition française, qui a du nez, l’a découvert quarante ans plus tard), Robbins se révélait disciple de Robert Graves, en même temps qu’il empruntait son grand singe papion à Jarry.
Ce qui est curieux, c’est que les deux grands mytheux (mythophiles ?) de la littérature anglaise, celui d’origine irlandaise et celui d’origine galloise, ne s’aimaient pas. Ou plutôt que l’un (Powys) n’aimait pas l’autre. Pourquoi ? Cela reste pour nous un mystère. Si Graves fut féministe, Powys ne le fut assurément pas. Mais égalitaire, oui, avec tout ce qui existe d’humain, d’animal, de végétal et de minéral, sans compter le reste.
Lorsque, le 8 octobre 1962, Powys fêta son 90e anniversaire, il reçut, du maire de Deià (Majorque) un télégramme libellé « Félicitations, Monsieur ». (Le maire de Deià était un viticulteur qui ne savait que l’espagnol.) Le petit-fils de Leopold von Ranke avait trouvé ce moyen espiègle de désarmer son adversaire.
On trouve tout cela et ce genre d’humour-là, chez Tom Robbins, qui se dit avec raison « cheerfully insubordinate ». La filiation avec Graves, clairement revendiquée, ne s’est jamais démentie. (Mais pourquoi les seuls féministes conséquents sont-ils des hommes ?)
En 1990, dans un livre à haute ambition politique autant que philosophique, Skinny legs and all (« Jambes maigres et tout », inédit en français), il allait s’affirmer aussi de la descendance de Powys en créant une série d’inoubliables personnages inanimés. La réussite fut, du premier coup, à la hauteur du modèle.

Livre à haute ambition politique et néanmoins d’une intense drôlerie, ce qui peut paraître impensable, puisqu’il ne s’agissait de rien moins que de prendre à bras-le-corps le problème palestinien. Victime de la même illusion qu’Israël Shamir (voir sur notre post précédent : « Automne en Crimée »), Robbins rêvait d’un monde enfin adulte où juifs et Palestiniens pourraient cohabiter, en bonne intelligence, sur la terre de leur antique déesse-mère à tous, l’ânesse à phallus Palès. Les vingt-deux ans qui viennent de s’écouler et des tonnes de phosphore blanc ont réduit ses illusions en cendres. Il ne pourrait plus aujourd’hui, écrire le même livre, qui reste un chef d’œuvre cependant. Tout comme les guerres « de religion » françaises ont réduit en cendres l’utopie de Thélème, sans jamais réussir à rendre obsolète un seul des chefs d’œuvres de celui qui l’avait rêvée.
Tom Robbins est un des auteurs les plus lus au monde. Et nulle part, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, le public n’a attendu la sanction de la critique pour se jeter dessus, le lire et le relire.
Avec vingt à quarante ans de retard, dépendant des titres, l’édition française daigne enfin s’intéresser à cet énorme écrivain d’outre-Atlantique, qui a connu la situation biscornue d’être l’invité d’honneur du festival des Etonnants Voyageurs de Saint-Malo alors que le public ne savait rien de lui. Et quand nous disons « édition française », nous parlons de « petits » éditeurs, pas des marchands d’armes.
Ah, oui : les inanimés. Sont ici une boîte de haricots à la tomate, une chaussette sale, une petite cuiller, un bout de bois peint et une conque.
Leur lieu de naissance est une grotte, où certains, qui y dormaient depuis des millénaires, ont été réveillés par les ébats amoureux d’un couple de jeunes mariés. La chaussette appartient au jeune homme, qui s’en va en l’oubliant ; la boîte de haricots, abandonnée elle aussi, aurait dû servir de pique-nique. Le bout de bois peint est un objet rituel païen du culte d’Astarté, un très classique phallus taché de sang emporté par on ne sait quel prêtre fuyant l’envahisseur juif et embarqué avec lui sur un navire phénicien (vous ne le saviez pas que les Phéniciens avaient découvert l’Amérique ?) ; la conque enfin, symbole non moins sexuel de la même déesse, est une relique de la reine Jézabel, massacrée vous savez comment.
Tous ces objets se mettent en route dans le sillage des deux jeunes gens et vont même suivre la moitié masculine du couple jusqu’à Jérusalem : leur hégire sur les flots vaut bien la navigation d’Ulysse vers l’Atlantide engloutie, et deux d’entre eux iront même jusqu’à reprendre leurs antiques fonctions dans le Troisième Temple de Jérusalem, évidemment dédié à Palès-Astarté.
Le bonheur est toujours une idée neuve, hélas, mais il reste à l’ordre du jour.

Les livres de Tom Robbins ne se résument pas. La seule solution, si on veut savoir, est de les lire, dans un désordre chronologique total.
Mickey le Rouge, 10/18, 2005
Villa Incognito, Cherche-Midi, 2005
Comme la grenouille sur son nénuphar, Gallmeister, 2009
Même les cowgirls ont du vague à l’âme, Gallmeister, 2010
Une bien étrange attraction, Gallmeister, 2010
Un parfum de jitterbug, Gallmeister, 2011
Féroces infirmes retour des pays chauds, Gallmeister, 2012
B comme bière, Gallmeister, 2012
Et il ne vous reste plus, chers internautes qu’à bombarder les éditions Gallmeister de mails, de lettres et d’appels téléphoniques : « Jambes maigres et tout, c’est pour QUAND ? ».
*
Mis en ligne le 2 janvier 2013 par Théroigne
14:42 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : atlantide, atlantique, bonheur, catastrophes, cosmos, de dieguez, dostoïevski, edition française, égalité, féminisme, nabe, pays de galles, perseides, philosophie, powys, rabelais, république, robespierre, rousseau, saint-just, villon | ![]() Facebook |
Facebook |
08/02/2010
2009 Année du triomphe de la démence et de la brutalité

2009
Année du triomphe de la démence
et de la brutalité
« Les cinglés nous ont enfermés dans l’asile,
et ils sont partis avec la clé... »
Un internaute américain, sur I.C.H.
Elle aura, j’en ai peur, de la descendance. Laissons la brutalité pour l’instant, contentons-nous de la démence.
Pour nous, Liégeois, 2009 était avant tout, avant même de commencer, l’année du deux-centième anniversaire de la mort d’un de nos plus braves, sinon célèbres, compatriotes : le général Jardon, quoiqu’il ait hélas son nom sur l’Arc de Triomphe, n’est guère connu en dehors de son endroit natal. Lequel vient cependant de négliger, c’est-à-dire d’oublier carrément, cet anniversaire. Pignouferie bien dans l’air du temps.
Réparons un peu : Henri Jardon (Verviers 1768 – San Justo 1809) fut un des héros de la Première République. Engagé à dix-neuf ans dans le régiment de volontaires levé par Jean-Joseph Fyon, colonel autoproclamé autant que futur général babouviste, pour défendre la Principauté de l’invasion étrangère, Jardon, avec les autres patriotes (c’est ainsi qu’on disait alors « révolutionnaires ») dut s’exiler à Paris, où il s’incorpora tout naturellement à l’Armée du Nord. Il fut de toutes les batailles de la République. Toujours en première ligne et payant de sa personne, il était « le général des voltigeurs ». Général, oui, car, depuis qu’il avait combattu les Autrichiens seulement armé d’un bâton, il ne lui avait pas fallu sept ans pour accéder à ce grade. Ce fut un des plus jeunes généraux qu’eut jamais l’armée française. Les historiens militaires l’ont plus tard appelé « l’homme à la baraka » : pas une seule blessure en vingt ans.
Au nombre de ses hauts faits dans cet art si particulier de la guerre, on compte qu’il fut le premier à hisser du canon au sommet du Grand Saint-Bernard, exploit généralement attribué à Napoléon Bonaparte, et que sa manière d’administrer ce qu’il faut bien appeler des places conquises lui valut la reconnaissance apparemment sincère des occupés, chose assez rare pour être mentionnée.
Henri Jardon, pourtant, devait mal finir. Après avoir voulu aller poignarder l’Usurpateur, au lendemain du 18 Brumaire, velléité qui lui avait valu d’être mis en congé de l’Armée, il se laissa plus tard circonvenir au point de rempiler, quand Bonaparte devenu Napoléon usa une fois de plus d’un appât qui lui avait déjà beaucoup servi : l’annonce d’une descente imminente sur l’Angleterre.
Aucun des contemporains n’a ignoré le rôle joué par ce pays dans la mise à mort de la Révolution, donc de la République. Pour aller en découdre avec la perfide Albion, même les morts se seraient relevés. Jardon se retrouva ainsi, à la fin de 1808, au Camp de Boulogne, où il reçut l’ordre de marcher... sur l’Espagne. La désertion en temps de guerre, même injuste, n’est pas le fort des militaires de vocation. Jardon marcha, la mort dans l’âme.
« Dans l’âme » ? Pas seulement. Le 25 mars 1809, sur un pont dit de Negrelos, près du petit village de San Justo (Portugal), il désarma à mains nues un paysan de plus de soixante-dix ans qui résistait, armé d’une pétoire, et le renvoya chez lui « en lui fesant entendre que les français n’étaient pas en guerre contre les paysans mais bien contre les troupes réglées ». Le vieillard voyait les gentils envahisseurs autrement (Goya aussi). Il rentra chez lui, décrocha une autre pétoire, et s’en revint tuer Jardon à bout portant. Dans le silence qui suivit, on entendit un grand bruit d’ailes. C’était la déesse Némésis qui s’éloignait.
Les Portugais, moins pignoufs que les Liégeois, ont consacré un blog au bicentenaire de cette bataille et à la mémoire de Jardon. Cela s’appelle :
Ponte de Negrelos
Blog dedicado ao bicentenário da batalha da Ponte de Negrelos, aquando das 2ª invasões Francesas
Et c’est ici
La Thalamège a publié, en 1988, une curieuse biographie d’Henri Jardon, trouvée sous forme de petit carnet manuscrit sur un des rayons les plus éloignés des archives de la bibliothèque de sa ville natale. Le petit carnet se trouvait dans une enveloppe grise, qui contenait aussi une liasse de papiers tachés de son sang : ses formulaires de dépêches encore à l’en-tête de la République, où un cachet noir rageur avait barré, après Thermidor, le mot « Fraternité ».
Ce manuscrit était de la main de Jean-Louis Guérette, seul aide de camp qu’eut jamais ce général et qui lui survécut trente-six ans. Il avait tenu à mettre par écrit ses souvenirs, afin, disait-il, « d’imposer silence aux personnes mal instruites ou malintentionnées qui débitent ou font imprimer des balivernes et des contes bleus sur un homme qu’elles n’ont certainement pas connu ». Sa prose, en plus d’un siècle et demi, avait été consciencieusement pillée mais jamais publiée.
Saluons donc la mémoire d’un homme qui a risqué cent fois sa vie pour la République, refusé le grade de général de division que lui offrait Joseph Bonaparte devenu roi de Naples pour ne pas quitter le service de sa patrie d’adoption, et fait le choix désastreux d’en reprendre dans une guerre d’invasion, poussé par l’illusion qu’il allait pouvoir venger la République sous l’Empire.
« Il avait une singulière appréhension d’être obligé de coopérer à la guerre de la péninsule qui par l’injustice de ses motifs et par les atrocités qui s’y commettaient avait le droit d’en dégoûter tous les bons Militaires ; cependant il lui fut ordonné, au moment où il s’y attendait le moins, de se rendre dans cet affreux théâtre de Carnage et d’extermination, il n’y avait pas à balancer, il dut obéir et fut la victime de son devoir, il reçut la mort d’un paysan, il partagea le sort de cinquante officiers généraux et de trois cents mille braves soldats qui auraient volontiers fait le sacrifice de leur vie pour une cause plus juste et d’une manière plus glorieuse. »

Un général de vingt-six ans : Henri Jardon 1768-1809
Précis historique de la vie de Henri Jardon, général de brigade
par son aide de camp Jean-Louis Guérette
(d’après le manuscrit original inédit)
La Thalamège, Verviers, 1988, éd. numérotée,
80 pages
***
2009 succédait comme on sait à 2008, et 2008 n’avait pas été de petite bière non plus dans son genre.
La France, occupée à fêter, le 6 mai, le premier anniversaire de l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la (cinquième) République, en oublia que ce jour marquait le 250e anniversaire de la naissance du plus grand homme d’État qu’elle eut jamais : Maximilien Robespierre. Ou s’en foutit. Avons-nous dit que ces pignouferies sont dans l’air du temps?

Buste de Robespierre par Jean-Antoine Houdon
Salon de 1793
Pourquoi nous en mêler, en ce début fracassant (guerre en Irak, guerre en Afghanistan, guerre en Palestine, guerre au Pakistan, guerre au Yemen, annexion de la Colombie, invasion de Haïti à la faveur d’un tremblement de terre) de 2010 ? Parce qu’il y eut une relation très particulière entre les Liégeois et l’Incorruptible, apparemment de peu d’intérêt pour les historiens. (Ne cherchez pas, enfants, dans vos livres d’école, ces choses-là n’y sont pas.) Plusieurs lui ont dû la vie, dont le Jean-Joseph Fyon sus-nommé (deux fois), dont aussi le général sans-culotte Servais Boulanger, hébertiste, qui finit par l’accompagner sur l’échafaud.
Lorsque le quatrième général que Liège a donné à la France, Jean-Pierre Ransonnet, s’était replié sur Paris avec ses fils aînés pour échapper à la capture par les troupes des Cercles, son épouse, restée seule avec les deux plus jeunes, avait été, par les vainqueurs, incarcérée, exposée au pilori et autres douceurs d’Ancien Régime... Plus tard, échangée ainsi que d’autres otages contre des émigrés pris les armes à la main, qui sauvèrent ainsi leur tête, la générale s’en fut remercier Robespierre, artisan probable de la négociation. Il lui fut dit qu’elle serait toujours la très bienvenue, chaque fois qu’elle le jugerait opportun.
Anne-Marie Ransonnet usa et abusa de la permission, se dévoua sans compter pour ses compatriotes en difficulté, qu’ils fussent ou non «de son bord». C’est ainsi qu’elle se rendit chez Duplay pour plaider la cause de Nicolas Bassenge, chef de la Gironde liégeoise et proche ami du ministre Lebrun, arrêté sur dénonciation calomnieuse. C’est ainsi qu’une commission, réclamée par Robespierre, fut chargée d’enquêter sur cette affaire et finit par conclure à l’innocence du prévenu.
J’ai vu le mot hâtif griffonné par Bassenge le 1er Thermidor, à l’intention d’un de ses proches, le chanoine Henkart, replié sur Givet : « Mon ami, je suis libre, et c’est à Robespierre que je le dois. »
Robespierre lui avait demandé de surseoir de huit jours à la mise en circulation d’un livre polémique dont il était l’auteur : J.N. Bassenge à Publicola Chaussard. sur ce qu’il dit dans ses mémoires concernant la Belgique, du ci-devant pays de Liège*. Ils devaient se revoir le 8... Bassenge est, à ma connaissance, le seul qui n’ait pas craché sur Robespierre tombé : son livre a paru, en pleine réaction thermidorienne, avec les éloges qu’il contenait.
Quant à la générale Ransonnet, elle survécut à son mari et à ses quatre fils, tous morts au service de la France, sinon de la République.
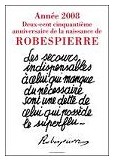
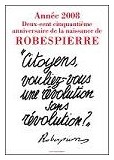
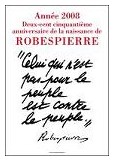
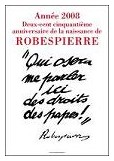
____________________
Série d’affiches réalisées en 2008 par Monsieur Louis Sassoye, Bruxelles.
(50 x 70 cm)
Si l’année Robespierre ne fut pas une autre année Mozart, du moins s’est-il trouvé, à l’autre bout du monde, un chef d’État pour saluer sa mémoire. C'est le président Hugo Chavez. qui l'a fait, d’une seule phrase il est vrai, au milieu d’un discours, mais nette et sans équivoque. Cela suffisait.
Pour notre modeste part, n’étant pas de ceux qui n’ont même pas la reconnaissance du ventre, nous avons fait l’impossible pour qu’un site consacré à Maximilien Robespierre existe le jour de son anniversaire. Ignares et fauchés comme nous le sommes, c’était une gageure. Théroigne a dû faire appel à un résigné bénévole pour sa mise à temps sur orbite. Le site en question : http://www.robespierreoulamort.com est « en construction » depuis bientôt deux ans, mais nous n’avons pas dit notre dernier mot. Ceux qui auront la curiosité d’y jeter un coup d’oeil verront que nous y avons associé Marat et Toussaint Louverture. Non seulement cette association s’imposait, mais c’était aussi leur 265e anniversaire de naissance à tous deux.
- J.N. Bassenge de Liège à Publicola Chaussard, sur ce qu'il dit, dans ses mémoires concernant la Belgique, du ci-devant Pays de Liège. Paris, an II. In-8° de 191 pages. Format PDF - 4824 Ko.
- Publicolas Chaussard : Mémoires historiques et politiques sur la révolution de la Belgique et du Pays de Liège en 1793, par Publicola Chaussard, homme de lettres, envoyé dans ces contrées, en qualité de commissaire national, par le conseil exécutif provisoire de la république française" Paris, an II. in-8° de 452 pages.
***

***
Le 30 novembre 1532, un jeune homme qui venait d’avoir trente ans ou qui allait les avoir écrivait à un grand homme de son temps.
« Je vous ai nommé “père”, je dirais même “mère”, si votre indulgence m’y autorisait. En effet, les femmes enceintes, l’expérience quotidienne nous l’apprend, nourrissent un foetus qu’elles n’ont jamais vu et le protègent des dangers du monde qui l’entoure, et qu’avez-vous fait pour moi sinon précisément cela ? Vous n’avez jamais vu mon visage, mon nom même ne vous était pas connu et vous avez fait mon éducation, vous m’avez allaité au chaste sein de votre divine science, “sic castissimis divinae tuae doctrinae uberibus”. Ce que je suis, ce que je vaux, c’est à vous seul que je le dois : si je ne le faisais pas savoir, je serais l’exemple de la plus noire ingratitude pour les temps présent et à venir. C’est pourquoi je vous salue et vous salue encore, ô vous, le plus aimant des pères, vous le père de votre patrie et de sa gloire, vous le défenseur des lettres, l’adversaire du mal, le champion invincible de la vérité. (...) Adieu et “eutychon diatelei”, que toute chance vous demeure. Lyon, le 30 novembre 1532. “Tuus quaternus suus”, à vous autant qu’il s’appartient ». Franciscus Rabelaesus Medicus.
Le jeune homme s’appelait en effet François Rabelais ; il écrivait à Érasme de Rotterdam.
Que dut penser le grand Érasme en lisant cette lettre ? Nous n’en savons rien, car il n’est pas sûr qu’il y répondit. Il avait publié, quand son admirateur avait six ou sept ans, un des livres les plus importants de l’histoire des livres, l’Éloge de la folie. C’était en 1509. La calamiteuse année 2009 a donc marqué, au milieu de ses fumants décombres et de sa démence, le 500e anniversaire, passé inaperçu, de cette «borne d’histoire terrestre » comme disait John Cowper Powys.
Qui a vu, en 1964, les fastes du quadricentenaire de la naissance de Shakespeare, pouvait s’attendre à quelque chose d’équivalent de la part d’une Europe dont la Hollande fait désormais partie... Mais non, bien sûr. Je plaisante ! Personne ne s’y attendait, personne, par conséquent, n’a été déçu. Mais M. Manuel de Diéguez, lui, a trouvé que c’était quand même un peu fort, prévisible ou pas.
*
-
Pour les très jeunes gens qui débarquent :
Manuel de Diéguez est un écrivain et philosophe français né le 11 mai 1922 à Saint-Gall (Suisse). D'origines latino-américaine et suisse, il descend, par son père, d'une famille de juristes, de poètes et de diplomates ; sa mère était une artiste lyrique. Il a étudié le droit, les lettres et les sciences politiques à l'UNIL (Université de Lausanne).
Auteur de nombreux ouvrages et de non moins nombreux articles, écrits pour de prestigieuses revues, il a été professeur invité à Middlebury College (Vermont, États-Unis), et à UCLA (Université de Californie à Los Angeles).
La Monnaie de Paris a officiellement honoré l'ensemble de l'œuvre de Manuel de Diéguez en faisant graver une médaille à son effigie en décembre 1987.
Pour davantage de détails, voyez Wikipedia
*
Nous avons donc dit : 1509, Éloge de la folie.

Érasme écrivant, par Dürer
Moriae Encomium sive Stultitiae Laus, Éloge de la Folie, Lof der Zotheid, In Praise of Folly
Quelques éditions anciennes et modernes et quelques pages, dont une illustrée dans les marges par Holbein et deux d’une édition de 1540
*
« En 1513, Louis XII, pour qui, chose étrange, le bien du peuple semble avoir été quelquefois une question importante, publia un édit par lequel il accordait à l’imprimerie ce que M. Didot appelle des lettres de noblesse, en l’exemptant d’un impôt considérable, en supprimant la taxe qui existait sur les livres et en déclarant que “les imprimeurs-libraires, vrais suppôts et officiers de l’université, doivent être entretenus en leurs privilèges, libertés et franchises, exemptions et immunités, attendu la considération du grand bien qui en est advenu en nostre royaume au moyen de l’art et science d’impression, l’invention de laquelle semble être plus divine que humaine, laquelle, grâce à Dieu, a été inventée et trouvée de nostre temps par le moyen et industrie desdits libraires, par laquelle notre saincte foi catholique a esté grandement augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée, et le divin service plus honorablement et plus curieusement faict, dit et célébré; et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées, à tout chaqu’un”. Il est certain que le titre de père des lettres est dû plus justement à l’auteur de ce noble et libéral édit qu’à François Ier, qui, nous l’avons vu, publia un édit qui défendait l’usage des presses et tolérait que livres et libraires fussent brûlés.» (Richard Copley Christie, Étienne Dolet, le martyr de la Renaissance, traduit de l'anglais par Casimir Stryienski, Paris, Fischbacher, 1886.)
Le résultat de cet édit extraordinaire (le roi renonçant à l’impôt sur les livres pour faciliter leur circulation) fut que sous son règne, la seule ville de Lyon compta jusqu’à 288 imprimeurs-libraires (lisez « éditeurs »), alors que sous celui du Quatorzième Louis, il en restera, pour la France entière, 25, tous soumis à la censure préalable.
Ce sont des considérations du même ordre (Dieu en moins peut-être) qui ont poussé un Manuel de Diéguez largement octogénaire à faire choix d’Internet pour communiquer avec ses frères simianthropes .
Ses textes, tous importants, se trouvent sur son site http://www.dieguez-philosophe.com/ ainsi que sur celui de l'agence Alterinfo.net, qui s'honore en les mettant systématiquement à la portée de ses lecteurs.
On verra à quel point sa célébration de l’Éloge de la folie tombe dans le chaudron d’une actualité brûlante.
*
Réflexion
Gaza, coeur de la folie du monde
« Moi, la folie, je parle. Ce n'est plus le temps des miracles.
Enseigner le peuple, quelle fatigue. Expliquer, cela pue la crasse de l'école. »
Erasme, L'Eloge de la folie.
Manuel de Diéguez
Dimanche 17 janvier 2010

- 1 - « Moi, la folie, je parle » (Erasme, L'Eloge de la folie)
- 2 - La dichotomie cérébrale des fous
- 3 - Où le mystère s'épaissit
- 4 - Comment diagnostiquer la folie ?
- 5 - Retour à la science politique
- 6 - L'étau de la folie se resserre
- 7 - « On commence par se faire duper et
- l'on finit en fripon » (Erasme)
- 8 - La démocratie et la logique ptolémaïque
- 9 - Et la France ?
- 10 - Le thermomètre de Zeus
- 11 - Les acteurs physiques et les acteurs invisibles de
- l'Histoire
- 12 - Clinique du chaos mental
- 13 - Une anthropologie de la folie
- 14 - Conclusion
1 – « Moi, la folie, je parle » (Erasme, l'Eloge de la folie)
Saluons le génie de l'humaniste cervantesque, swiftien et kafkaïen avant la lettre dont l'audace incroyable en son temps lança le délire à la conquête du monde sous les traits d'un personnage en chair et en os, saluons l'acteur planétaire de la modernité qui disait: « Moi, la folie, je parle. »
Comment la folie parle-t-elle de nos jours?
Pour tenter de l'apprendre, descendons l'escalier qui conduit dans les souterrains de la démence politique. Le grand Hollandais a publié son Eloge de la folie en 1509. Aucune commémoration solennelle n'a rappelé, en 2009, le cinq centième anniversaire de la parution de l'œuvre la plus célèbre du roi des humanistes, ce qui démontre, s'il en était besoin, que les grandes œuvres demeurent tellement actuelles que personne n'ose les enterrer sous les applaudissements unanimes des bien-pensants qui, eux, ne changent pas de nature d'une époque à l'autre. Aussi cette œuvre immense demeure-t-elle largement incomprise. L'audace littéraire de faire prononcer son propre panégyrique à la folie ne trouvera son écho que chez Kafka. Mais, ce que nous entendons en filigrane de l'Eloge de la folie en ce début du IIIe millénaire, c'est le miserere de la sagesse et de la raison du monde, c'est le heurt entre deux musiques de la politique, car la guerre des faux croisés de la Justice et de la Liberté reproduit le contraste érasmien entre les évangiles et un Saint Siège alors belliqueux.
L'île d'Utopie de Thomas More , paru en 1516, se présente comme une réponse indirecte et vigoureusement évangélique à la prosopopée érasmienne de la dérision. On sait que le titre grec d'Eloge de la Môria est un clin d'œil discret au futur décapité auquel l'Eloge est dédié, parce que la folie se dit môria dans la langue d'Homère et que les deux amis plaisantaient souvent sur le double sens du patronyme du grand Anglais. C'est que la folie scelle une alliance étroite avec l'utopie ; et, pour les hellénistes, "l'île d'utopie" signifie rien de moins que "l'île de nulle part". Mais pourquoi les utopies politiques et religieuses d'une humanité égarée dans les airs se cherchent-elles un ancrage, pourquoi, depuis la cité idéale de Platon jusqu'au christianisme originel et au marxisme, l'absence de tout atterrissage hante-t-elle la folie d'une humanité privée des récoltes et des engrangements topographiques qu'elle attend de ses songes ?
Le mutisme de la presse et des médias français, relayé par celui, moins massif, de la presse mondiale sur le mur d'acier en construction autour de Gaza a pris des proportions érasmiennes aux yeux de l'historien pensant et de l'anthropologue d'avant-garde, qui se trouvent tout étonnés de se vêtir non seulement en Sherlock Holmes de la géopolitique, mais en spéléologues de Clio, afin de tenter de relever les traces laissées dans la poussière par la logique qui commande les verdicts de la fatalité. Car, sous les sentiers du destin, des vestiges du tragique et de la folie décrits par Erasme se tiennent en embuscade. Du coup, les Eschyle et les Shakespeare de la démence prêtent comme jamais leurs télescopes et leurs microscopes aux scribes et aux greffiers des acteurs les plus puissants et les plus invisibles de la pièce.
Peut-être le thème de la folie du monde, qui remonte à Saint Paul, appelle-t-il la France à retrouver son territoire de "nulle part", peut-être l'heure est-elle venue, pour la nation de la liberté, de retrouver l'utopie d'un royaume de la Justice qui a donné son âme à l'humanité; car si la démence a pris la plume au début du XVIe siècle, c'est afin de demander au XXIe siècle d'élever l'intelligence politique au rang d'un glaive de la folie spirituelle dont l'esprit se nourrit.
2 - La dichotomie cérébrale des fous
Que le narrateur au petit pied se rengorge: il a vu M. Barack Obama échouer piteusement à convaincre Israël de lâcher un seul instant la poignée de son glaive . Comment un conquérant digne de ce nom cesserait-il, ne serait-ce que pour quelques jours d'étendre son territoire les armes à la main? Mais quelle scène digne de L'Eloge de la folie que celle d'un Président de la plus puissante démocratie de la planète dans le rôle du suppliant monté sur les planches du théâtre du monde pour demander à M. Mahmoud Abbas de se résigner à négocier tout seul avec son puissant exterminateur et de désarmer solitairement et la main sur le cœur un peuple de prédateurs armé jusqu'aux dents !
Mais s'il suffisait au mémorialiste du sceptre de la folie de raconter à son gentil lecteur une gentille histoire de la folie de "bécarre et de bémol", disait Pantagruel, où serait la difficulté? Certes, depuis longtemps, le délire a livré ses secrets à la littérature, certes la démence est entrée dans l'épopée avec l'Ajax d'Homère, certes, un certain Espagnol s'est illustré sur tous les continents et dans toutes les langues de la terre à peindre les malheureux dont la noblesse a basculé hors de l'arène du monde, certes, Swift n'est pas demeuré en reste, lui qui a porté la folie à la fresque. Mais Sherlock Holmes est mis à quia par la dichotomie cérébrale qui fait tonitruer M. Barack Obama contre Israël, dont le crime, à l'entendre, se rabougrirait à expulser quelque sept cents habitants de plus de Jérusalem Est, Sherlock Holmes donne sa langue au chat quand M. Bernard Guetta prend apparemment le relais du schizoïde de la Maison Blanche et condamne à son tour et avec force la poursuite ratatinée de la colonisation israélienne , Sherlock Holmes ne sait plus à quel saint se vouer quand M. Kouchner le biphasé se précipite à Jérusalem afin d'absoudre, tout au contraire, le prédateur d'un péché indigne de l'attention du monde civilisé, Sherlock Holmes jette l'éponge quand Israël réitère son coup de force à Jérusalem Est et que le Jupiter bipolaire du bureau ovale fulmine derechef et le plus évangéliquement du monde, mais sans plus de succès, puisque le diable qui le tient par la manche a déjà accordé sa bénédiction aux nouveaux saints de Jérusalem.
Isaïe prendra-t-il la relève des apôtres de la béatitude des fous de la démocratie? Ne faut-il pas rendre les armes quand saint Obama encercle Gaza d'un mur d'acier sourcilleux, ne faut-il pas couronner sa Majesté, la folie, quand le roi de la Liberté du monde renouvelle pour dix ans le versement charitable de trois milliards de dollars annuels à Israël ? Décidément, il faut convaincre la raison du monde de battre précipitamment en retraite quand M. Karl Bilt, le Président pour six mois de l'Europe polycéphale condamne à son tour et solennellement l'expansion dévote d'Israël et publie, une semaine seulement plus tard dans Le Monde une interview lénifiante, dans laquelle il revient en toute hâte sur ses pas et s'applique à réduire Mme Ashton à la fonction de femme de ménage de l'Europe. N'est-elle pas coupable d'avoir repris à son compte devant le Parlement européen les thèmes bifides développés par M. Obama et par M. Bilt quelques jours seulement plus tôt? Décidément, L'Eloge de la folie d'Erasme et L'île d'Utopie de Thomas More ont rendez-vous avec les moutons de Panurge, décidément, la flotte pantagruéline n'a pas jeté l'ancre sans malice dans l'île de Médamothi, cet autre nom de "nulle part" en grec.
3 - Où le mystère s'épaissit
Rappelons un instant ma plume d'instituteur aux embarras des Conan Doyle de la politique. Cet auteur de romans policiers semble nous mettre sur la piste; car il nous raconte un épisode énigmatique de cette histoire, à savoir que Mme Livni s'est ruée de Tel Aviv à l'Elysée pour demander à M. Sarkozy qu'il coupe la langue à l'imprudent M. Bilt et à l'atone Mme Ashton. Mais Conan Doyle nous dira-t-il comment les asilaires rebattent les cartes sans relâche, où se cache le vrai maître de l'hospice, quel est le nom de l'hôpital, qui donne aux aliénistes le pouvoir extraordinaire de changer d'une heure à l'autre la mise en scène de la pièce ? Comment départager le roman policier du roman politique dans les coulisses du théâtre qu'on appelle l'Histoire ?
Prenez l'épisode de la marche des volontaires du monde entier sur Gaza le 27 décembre dernier et l'épopée des camions destinés à secourir les affamés. Par qui et comment M. Mandela et Mgr. Desmond Tutu ont-ils été empêchés de tenir leurs engagements et de se joindre à l'expédition ? Qui a demandé et obtenu de M. Jimmy Carter, ex-Président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix qu'il présentât des excuses au Tamerlan de Gaza en échange de l'élection de son petit-fils à un siège de sénateur ? Comment l'auteur d'un roman aussi énigmatique a-t-il disposé les pièces sur l'échiquier érasmien afin que la folie du monde, dont on s'échine à mettre à nu les ressorts depuis l'Ecclésiaste et le Livre de Job, dévoilât ses mystères et que les plus fins limiers des arcanes de la civilisation de la Liberté eux-mêmes demeurassent bouche béé devant le basculement des journaux, des chancelleries, des radios et des télévisions du monde entier dans un silence aussi subit ?
4 - Comment diagnostiquer la folie ?
On savait depuis longtemps que notre espèce habite un asile et qu'un délire universel y chante sa propre gloire avec les accents mêmes du droit et de la justice, de la foi et de la liberté, de la vérité et d'un ciel dont vous connaissez les écrits de ses trois propriétaires. Mais Erasme nous a fourni les clés qui ont permis à nos aliénistes de diagnostiquer le délire de tous les siècles. Aussi nos Etats et nos Eglises se sont-ils aussitôt reconnus sous le pinceau du maître, tellement les symptômes de la maladie étaient clairement et minutieusement décrits. C'est qu'en ces temps reculés, non seulement les bien-portants reconnaissaient encore les fous au premier regard, mais les fous eux-mêmes découvraient leur pathologie à la seule lecture des signes les plus spectaculaires de leur démence. La drogue qui enfantait ce miracle, on l'appelait le rire; et le rire était tellement guérisseur que tout le monde en appelait à la trousse de ce premier médecin de la folie du monde. Mais maintenant, personne ne rit plus, et toute la difficulté des spectateurs de la tragédie est de dénicher un homme de l'art suffisamment expert en insanités pour attirer l'attention des malades sur leur état.
Qui est demeuré sain d'esprit et qui a perdu la raison ? La science médicale a égaré le thermomètre du XVIe siècle dont le grand Batave s'était servi pour mesurer le degré de folie des patients à seulement prendre leur température. Aussi, l'auscultation qui décide du panier dans lequel il convient de ranger les diagnostics en faveur des uns ou des autres, repose-t-elle désormais sur le seul décompte de la majorité des opinions, de sorte que le calcul de la proportion des sages et des fous au sein d'une population déterminée dépende du hasard qui fait pencher la balance des verdicts à l'avantage des fous ou des sages.
Mais comment départager les têtes dérangées des têtes en bon état de marche si l'enregistrement des voix fait sans cesse passer les verdicts de la raison du camp d'Erasme à celui de la folie à laquelle il avait donné la parole ? C'est ainsi, comme il est dit plus haut, que M. Obama s'indignait fort des exactions du voleur à Jérusalem, mais protégeait dès le lendemain ses rapines à Gaza. Voici donc que le clinicien d'un vaste empire a cessé à son tour de distinguer les malades des bien-portants, voici qu'un médicastre hissé au rang de chef d'Etat livre au chaos le peuple et la nation dont il est chargé de piloter l'encéphale, voici que l'Hippocrate dont la balance même pèse non point la maladie, mais le nombre des malades, donne raison à leurs régiments s'ils sont plus serrés que ceux des sages.
Au XVIe siècle, tout le monde voyait clairement que Dieu et son Eglise étaient devenus fous à lier, tellement chacun comprenait encore qu'il était dément de transporter à la pelle les riches au paradis pour le saint motif que leurs cassettes bien pleines leur permettait d'acheter leur félicité éternelle à prix d'or. Et maintenant, M. Barack Obama prend simplement la tension de sa propre popularité pour précipiter à l'asile la minorité non délirante de sa population selon l'adage de la folie qu'Erasme avait rappelé: "Ut homines sunt, ita morem geras" - "il faut prendre les hommes tels qu'ils sont".
Aussi voit-on se dessiner sur la rétine de la Maison Blanche les traits du fou de la démocratie mondiale, aussi le voit-on délivrer du Purgatoire un guerrier couvert de sang, aussi regarde-t-on avec des yeux dessillés le fou qui tape sur les doigts d'un petit délinquant pris en flagrant délit de chasser de leurs demeures les habitants d'une capitale qu'il cambriole maison par maison, puis le fou en chef, le fou porté par la folie à la tête de l'Etat le plus puissant de la terre hisse au ciel de la démocratie mondiale un assassin déguisé en évangéliste et en pédagogue de la Liberté du monde.
5 - Retour à la science politique
Personne ne savait plus quel Esculape de la boîte osseuse de l'humanité il fallait consulter, quels analystes du pouvoir politique au sein des évadés du monde animal diagnostiqueraient à coups sûr la nature de la maladie, parce qu'on cherchait en vain la balance dont les plateaux pèseraient le degré de gravité de l'infirmité cérébrale qu'illustrait la personne même de M. Obama. N'avait-il pas prononcé au Caire, le 4 juin 2009, un discours fort sensé, dans lequel il avait exhorté les musulmans, les juifs et les chrétiens à partager l'apostolat démocratique dont il se proclamait le missionnaire et à soutenir avec la sainte ardeur des évangélistes du globe terrestre son combat pour la prospérité et pour la puissance d'un empire de héros du salut ?
Réfléchissez un instant, disaient les politiques les plus chevronnés de la planète et cessez de vous imaginer sottement que la science médicale serait appelée à vous éclairer sur la folie ou sur la santé du monde en général et de M. Barack Obama en particulier. Si vous passez du rêve à la saine pesée des pouvoirs qu'exerce tout chef d'Etat en ce bas monde, comment pouvez-vous croire qu'un tel personnage se livrerait de sa propre volonté à la faiblesse et au chaos ? S'il affecte de jouer à l'instituteur vertueux dans le bureau ovale de la Maison Blanche, si son art de la feinte va jusqu'à annoncer aux journaux de la planète entière qu'il désapprouve les exploits d'un petit monte en l'air à Jérusalem Est, et si, dans le même temps, vous le voyez aider le tueur à construire un mur d'acier autour de Gaza afin d'affamer les survivants d'un gigantesque camp de concentration, vous pensez bien qu'il n'est plus un homme politique et qu'il est illusoire de placer un fantôme au timon des affaire du monde.
Mais alors, voici que les Sherlock Holmes de la politique redressent la tête: et il nous faut revenir la queue basse à l'observation des embarras qu'ils rencontrent sur le terrain. Comment se fait-il que leurs difficultés de gestion ne soient pas moins titanesques que celles des thérapeutes de la folie tout court ? Comment expliquent-ils l'alliance qu'Israël a conclue avec le parti républicain, comment se fait-il que tous deux combattent maintenant la politique de la main tendue de M. Obama en terre d'islam, comment se peut-il que les nationalistes américains entendent désormais ruiner les intérêts de l'empire à long terme dans tout le monde arabe ? Certes, il n'est pas de candidat à une parcelle de l'autorité publique au sein de l'Etat américain qui ne fasse l'objet d'une vérification préalable et minutieuse de son orthodoxie au chapitre de ses relations avec le patriotisme sioniste d' Israël. Mais de là à comprendre les ressorts d'une conspiration anti nationale et anti patriotique de la droite américaine au profit d'un Etat étranger, il y a loin. Peut-on trahir son pays aveuglément et sans le savoir ?
Et puis, pourquoi le cadavre politique de M. Barack Obama bouge-t-il encore ? Pourquoi le voit-on tressauter, pourquoi le voit-on se livrer à des convulsions et à des soubresauts d'une pathétique impuissance, puisque ses ultimes gesticulations et remuements ne font que mettre davantage en évidence soit son état mental désespéré, soit son autorité politique naufragée ? On n'achète pas davantage le royaume des cieux de la démocratie idéale à l'école des hérétiques du mythe de la Liberté que le royaume du ciel des Eglises du Moyen Age ne se laissait mettre aux enchères des prévaricateurs qui vous demandaient d'acquitter rubis sur l'ongle les bons du Trésor émis par la banque de l'Eternité.
6 - L'étau de la folie se resserre
Mais la question tant politique que cérébrale posée au XXIe siècle par d'Erasme nous conduit à une plus grande profondeur encore de l'anthropologie critique : il s'agit de savoir s'il convient de réfuter l'adage de Socrate selon lequel l'ignorance serait la source de tous les maux ou s'il faut, non point le remplacer tout d'une pièce par l'axiome qui verrait dans la sottise l'origine commune de tous les désastres cérébraux et politiques confondus, mais s'il conviendra d' analyser la généalogie commune de l'ignorance et de la bêtise et de se résigner à étudier les relations que ces deux formes de la folie entretiennent à la lumière d'une science expérimentale du politique, donc d'une discipline vérifiable à l'école des évènements.
Certes, les traités de la bêtise sont rarissimes, ignorés du grand public et le plus souvent d'une légèreté d'esprit aussi coupables que le mal qu'ils prétendent dénoncer. Mais voyez comme l'ignorance et la stupidité font alliance au Moyen Orient. Est-ce par ignorance ou par sottise que M. Obama croit sans doute que la domestication ou même la destruction de Gaza feront avancer d'un pouce la question dite "des deux Etats", alors que la politique du monde entier repose sur un faux diagnostic? Si ce n'était Gaza, ou l'Iran ou le Hamas qui faisaient figure d'obstacle à la "solution du problème palestinien", Israël recourrait à d'autres leurres, simulacres et faux- fuyants, parce que cet Etat a vocation de s'étendre, comme ses confrères, et de conquérir, l'épée d'une main et l'évangile démocratique de l'autre, tout le territoire qu'il pourra - et cela jusqu'à ce qu'une force supérieure à la sienne le contraigne à battre en retraite.
Mais comme la légitimité de cet Etat demeurera à jamais indéfendable en droit international, donc par nature et par définition, puisqu'une démocratie fondée sur la fierté d'avoir aboli la colonisation à l'échelle de la planète ne saurait, dans le même temps la ressusciter d'un seul élan au profit et à la gloire d'Israël, la vraie question sera seulement de savoir quel type d'alliance de l'ignorance avec la sottise permettra au monde entier de se refuser d'examiner les désastres politiques auxquels ce refus conduira fatalement la planète des apôtres de la folie.
7 - " On commence par se faire duper et l'on finit en fripon " (Erasme)
Il sera bien évidemment bien impossible de jamais obtenir d'Israël qu'il accueille à bras ouverts trois générations de réfugiés politiques dans son sein, bien impossible de jamais obtenir qu'il se replie dévotement sur ses frontières de 1967, bien impossible de jamais obtenir qu'il renonce béatifiquement, donc au nom des idéaux de la démocratie, à redonner son statut de capitale et de cœur de son identité biblique à Jérusalem, bien impossible de jamais obtenir qu'il se flanque gentiment d'un Etat palestinien aussi libre et puissant que lui-même, bien impossible qu'il perde le sot prestige attaché au feu inutilisable de l'apocalypse.
Dans ces conditions que fera l'empire américain pour rendre durable le vain escamotage diplomatique d'une aporie de nature psychogénétique? Comment combattra-t-il son propre enfermement dans une sainte hypocrisie et une cécité d'innocent aux mains pleines ? Comment persévèrera-t-il à brandir sans relâche l'étendard et le totem de la Liberté, de la Justice et du Droit sur la planète entière s'il lui faut se placer aux côtés d'un Etat qui ne cessera, de son côté, de bafouer les utopies apostoliques d'une humanité de nulle part ?
A tout cela, il n'existe qu'une seule solution : égarer le plus longtemps possible l'attention du monde et pour cela, fortifier sans cesse sa puissance guerrière à l'échelle de la planète des sots. En vérité, la solide alliance de l'ignorance avec la sottise est d'ores et déjà conclue: au prix de trois cent milliards de dollars par an seulement, on construira cinquante cinq navires de guerre ultra modernes, qui permettront, croit-on, de régner à jamais sur toutes les mers du globe.
Mais le pacte que l'ignorance scelle avec la bêtise n'est pas un vice nouveau et qui débarquerait de nos jours sur la terre: pour refuser de comprendre que la ruine financière est un cratère dans lequel on va immanquablement se précipiter, il faudra recourir au ligotage d'un Etat à sa propre cécité; il faudra dresser devant les yeux de la nation des obstacles politiques qu'on se sera appliqué au préalable à rendre de plus en plus insurmontables; il faudra livrer une guerre suicidaire à l' intelligence dont dispose d'ores et déjà le reste de la planète. Ces auto-ficellements, ces auto enchaînages et ces auto verrouillages, comment s'interdire de jamais les regarder en face, alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour les apercevoir ?
Pour l'instant, Israël demeure le roc d'un aveuglement contre lequel toute sagesse et toute lucidité sont appelées à se briser, parce que le globe oculaire de l'ignorance et de la sottise confondues est dans la folie d'avoir ramené sur les lieux les vaincus de Titus. Faut-il que la science politique mondiale soit demeurée ignorante et inexpérimentée pour n'avoir pas prévu les désastres de la sottise qui s'ensuivraient et qui s'enchaîneraient les uns aux autres avec une logique implacable !
Pour l'instant, les trémoussements et les soubresauts dont M. Barack Obama nous présente le douloureux spectacle ne sont que des symptômes de la maladie mortelle qui achèvera le malade. Mais les vrais diagnostics sont aussi des pronostics. Il appartiendra à l'oracle de la fatalité de désigner ses proies.
8 - La démocratie et la logique ptolémaïque
Peut-on suivre pas à pas le cheminement de la cécité semi inconsciente et en diagnostiquer les sources psychobiologiques ? Pour le tenter, observons les réflexes d'auto-défense innés dont use l'encéphale de notre espèce et les procédés traditionnels auxquels elle recourt d'instinct afin de conserver ses trésors cérébraux rouillés; et pour cela, voyons comment l'astronomie de Ptolémée, qui faisait eau de toutes parts, a résisté pendant des siècles à celle de Copernic, puis comment un créationnisme mythologique par définition a pris la relève de l'exorcistion des preuves de l'évolutionnisme darwinien.
Dans son célèbre Système du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic en dix volumes publié en 1914 et réédité entre 1958 et 1965, Pierre Duhem, membre de l'Institut, alléguait encore qu'une vraie physique devait se contenter de "sauver les apparences" et que les calculs de Ptolémée se trouvaient pleinement légitimés à conserver le précieux spectacle d'un soleil tournant autour de la terre qu'attestent à la fois les yeux et les saintes écritures. De même le créationnisme ne s'est laissé arracher que peu à peu des concessions qui fendaient le cœur des croyants. Le 23 octobre 1996, Jean-Paul II a fini par déclarer que l'évolutionnisme est "davantage qu'une hypothèse"; mais il s'est bien gardé de préciser où passait la démarcation entre des allégations religieuses et une science que son statut ambigu situerait quelque part entre une mythologie sacrée et des vérifications expérimentales soutenues par les télescopes des astronomes. C'est qu'il fallait ménager tout ensemble la foi des croyants et le témoignage des instruments d'optique des scrutateurs des étoiles. Pourquoi cette distorsion entre les preuves magiques et les victoires du raisonnement sur les faux témoignages des sens ? C'est qu'une espèce coulée dans le moule du sacré craint de perdre une forteresse cérébrale qui la rassure et dans laquelle elle se love à son aise.
Or, l'analyse psychologique de l'évolution de la prise de conscience progressive de ce que l'erreur politique d'Israël est de type ptolémaïque se calque exactement sur le modèle de la folie dont les résistance à l'adopion de l'astronomie de Copernic ont fourni l'exemple et auxquelles le refus des thèses sur l'origine des espèces de Darwin ont fourni le pendant: dans les deux cas, le sujet refuse avec une violence d'origine psychogénétique de perdre une demeure mentale jugée confortable et devenue vraie de passer pendant des siècles d'une génération à la suivante. C'est ainsi que, d'un côté, la démocratie des fous veut sauver la cassette d'un droit international bicentenaire et fondé sur la souveraineté des peuples - donc sur la légitimité de leur statut de défenseurs naturels du pouvoir des adultes de disposer d'eux-mêmes, et par conséquent de conserver le territoire de leurs ancêtres - de l'autre, les mêmes apôtres des droits de l'humanité veulent canoniser un Etat qui conteste aussi radicalement les fondements de la civilisation moderne que le géocentrisme biblique entendait réfuter l'évolutionnisme.
Malheureusement pour l'Etat hébreu, les défenseurs des convictions scripturaires du peuple juif se trouvent contraints de battre en retraite. Comment se fait-il que leur pré carré se rétrécisse comme une peau de chagrin ? C'est que la logique démocratique ne fait pas davantage de quartier que la logique mathématique. Elle ignore autant le débat sur le statut d'une hypothèse pseudo démocratique que sur le sexe des anges : à la fin, Euclide tranchera la question et dira que la démocratie est aussi incompatible avec les principes de la colonisation que la géométrie à trois dimensions avec des arpenteurs qui prétendraient réfuter le théorème selon lequel la somme des angles d'un triangle fait cent quatre-vingts degrés.
La topographie démocratique véritable a rendez-vous avec le théorème de Pythagore qui la fonde; mais il faudra verser le sang, hélas, pour que l'héliocentrisme démocratique l'emporte sur le géocentrisme israélien, parce que l' enjeu réel n'est pas de nature mathématique, mais de nature anthropologique: si imparfait et inachevé qu'il demeure, l'encéphale humain d'aujourd'hui ne se partage plus entre deux logiques incompatibles entre elles.
9 - Et la France ?
Quel sera le rôle de la France dans cette guerre mondiale entre la raison et la folie ? Le drame d'origine, donc de nature psychogénétique qui sous-tend l'âme et la raison de la science politique depuis que notre encéphale a quitté la zoologie est dans la difficulté de décider sur le terrain et au coup par coup à quel moment précis il convient de se trouver bêtement présent dans l'arène des nations afin de faire figure d' acteur visible de l'histoire et à quel moment il devient nécessaire, tout au contraire, de quitter en toute hâte un cirque par trop ensanglanté. Il ne s'agit jamais de déserter l'histoire meurtrière, mais, tout à l'opposé, de prendre place dans une autre durée de l'humanité, celle où des acteurs ennemis des carnages prennent en main les rênes du destin.
En 1940, la France des ossatures et des muscles ne pouvait se mettre aux abonnés absents: il fallait bien se résigner à légitimer la folie d' un gouvernement de gestionnaires des corps, il fallait bien que la France terrassée conservât les organes tangibles d'un Etat, il fallait bien que la nation de 1789 parût provisoirement représentée par les majordomes de ses chancelleries sur une scène internationale devenue tout entière la spectatrice réjouie ou désolée de la mise hors jeu des Gaulois sur le champ de bataille. Dans la débâcle de la France d'en-haut, l'appel désespéré au héros surréel de Verdun était la caution a priori la plus digne de l'âme de la France.
Mais à quel moment fallait-il quitter l'écume des jours pour replonger dans la vague ? Fallait-il choisir l'heure des horloges où, sur le sol français, un chef de l'exécutif proclamait son vœu ardent que l'occupant remportât la victoire en Europe, l'heure où le cadran de l'administration de la justice mettait à pied ses magistrats juifs, l'heure où les aiguilles du temps s'arrêtaient sur la rafle du peuple de Jahvé au vélodrome d'hiver ?
Soixante-dix ans après un verdict des armes plus cruel que les précédents, la France symbolique se trouve à nouveau placée en sentinelle de l'histoire de la démence du monde. Lui faut-il épouser la mer ou flâner sur le rivage ? Un gouvernement français, même amolli, peut-il légitimer sa participation physique à la direction d'une planète de l'errance dans laquelle la majorité des Etats prétendument démocratiques ont décidé de construire un mur de dix kilomètres de longueur, composé de plaques d'acier de dix-huit mètres chacune et de cinquante centimètres d'épaisseur, un mur dont les fondations iront jusqu'à trente cinq mètres sous la terre, afin d'exterminer par la famine la population entière d'une ville de seize centaines de milliers d'habitants ?
Cette croisée des chemins de l'histoire du cerveau et du cœur de la planète des fous est-elle moins visible que celle dont le basculement d'un vieux Maréchal dans le camp du vainqueur de sa nation signalait le tragique emplacement à tous les regards ? Notre République peut-elle assister les bras croisés, donc en complice silencieuse à la construction d'un camp de la mort de cette taille ? Notre connaissance réelle de l'histoire du monde ressortit-elle à la pesée du corps et des muscles des Etats, ou bien avons-nous grand besoin de nous coller une autre loupe à l'œil afin d' apercevoir les personnages réels qu'on appelle des peuples et des nations ? A quel moment les charniers tuent-ils le parfum des démocraties ? A quel moment l'encens de la Liberté et de la Justice cesse-t-il de monter des autels ? A quel moment les citoyens d'un pays de soixante-cinq millions d'habitants incommodent-ils les narines de Jupiter ? La France empuantie de Pierre Laval s'est détachée de celle des écrivains, des poètes et des philosophes de notre pays à l'heure entre chien et loup où l'esprit a pris résolument le relais de l'histoire de la nation. Alors l'éclat des derniers flambeaux de notre civilisation a fait entendre les voix de la résurrection de la France.
10 - Le thermomètre de Zeus
Pour tenter de cerner cette difficulté en anthropologue glacé, il faut, ici encore, observer avec sang froid le chaos cérébral dont le diagnostic embarrasse les aliénistes de la vie politique des Etats modernes; et pour cela, il faut faire entrer dans le cabinet d'Esculape les patients dont les troubles psychiques demeurent proportionnés à la modestie de leur emploi. C'est ainsi que M. Bernard Kouchner voulait se rendre à Jérusalem ; mais comment ignorer Gaza et son camp de concentration à ciel ouvert sans paraître pencher pour un parti au détriment de l'autre ? Et si l'on voulait éviter que le fléau de la balance penchât trop ostensiblement en faveur du bourreau, la meilleure ruse diplomatique n'était-elle pas de lui demander l'autorisation de se rendre à Gaza ?
Naturellement, le sacrificateur a refusé tout net que la France auscultât la victime exposée sur l'offertoire et même qu'elle parût pronostiquer l'évolution de sa charpente; et comme le Quai d'Orsay des fous ne pouvait paraître par trop prononcer l'éloge de l'étal d'un Etat coupable de crimes de guerre, de génocide, d'emploi d'armes prohibées par le droit international, telles les bombes au phosphore, M Bernard Kouchner a renoncé à son voyage. Quelle est la France qui s'est illustrée de la sorte? Qui a parlé en son nom sur ce propitiatoire ? Qui a détourné le regard de ce sang ?
M. Kouchner s'est montré fort dépité par cet "échec diplomatique" et il l'a caché soigneusement aux journalistes. Un résistant du Quai d'Orsay a donné secrètement l'information au Canard enchaîné. Quelle est la philosophie de l'esprit dont la France actuelle fait preuve sur la scène internationale et qui lui fait juger de bonne et saine politique de se trouver présente en chair et en os sur tous les terrains où Montoire fait la loi ? Le gouvernement est-il un véritable acteur sur le théâtre du monde quand l'occupant lui dit : "Si vous vous faites porter pâle parmi les sacrificateurs, vous serez non seulement déclaré couard, mais proclamé coupable de désertion sur le champ de bataille de la Liberté" ?
On voit combien la question de la définition folle ou sage des Etats débarque sur les planches du même théâtre de l'Histoire de la démence qu'en 1940, mais sous une autre redingote ; car si l'on songe que, quelques jours seulement plus tard, l'Elysée a jugé indispensable à l'exercice de ses responsabilités dans la conduite exclusivement musculaire de l'univers de faire diriger par un général de notre armée de terre la construction du mur d'acier dont la vocation est de hâter l'extermination jugée trop lente d'une vaste population, avec quelle France nos écrivains, nos poètes, nos philosophes ont-ils rendez-vous en ce début du IIIe millénaire ?
11 - Les acteurs physiques et les acteurs invisibles de l'Histoire
Voyez comme le tensiomète des dieux se rappelle au bon souvenir des peuples et des nations: ce sont eux et eux seuls qui décident de la température des âmes, ce sont eux et eux seuls qui condamnent l'anthropologue et le logicien de la démence du monde de se trouver au rendez-vous que l'Eloge de la folie d'Erasme a donné à la politique de la planète en ce début du IIIe millénaire. Car, disent les Célestes, l'encéphale de la France des fous se trouve livré au même chaos que celui de M. Barack Obama; et l'on se souvient que le désordre qui s'est emparé de la boîte osseuse de ce chef d'Etat le ballotte d'un vain brandissement de ses foudres verbales à l'apologie d'un mur de Berlin appelé à encercler le camp de la mort le plus vaste de la planète.
Comment se fait-il que le chaos cérébral dont témoigne la France des Laval d'aujourd'hui soit identique à celui de M. Obama, comment se fait-il qu'on distingue si mal l'original de la copie ? Alors que M. Kouchner se montre tout effaré de n'avoir pas cautionné davantage un Etat génocidaire, ce qui, en termes diplomatiques, revient à le condamner timidement et la bouche close, se rendra-t-il maintenant à petits pas et l'échine basse à la frontière de Gaza, agitera-il le drapeau aux trois couleurs sur les remparts de la forteresse qui enferme un gigantesque peuple de la mort ? M. Obama, lui, se contente de condamner de loin et la bannière étoilée à la main quelques expulsions de citoyens de Jérusalem Est. M. Kouchner va-t-il, au nom de la France de 1789, partager sous les murs de Gaza les chapons d'Orgon avec l'armée des faux dévots ?
12 - Clinique du chaos mental
Vous voyez bien, bonnes gens, combien la scission cérébrale qui frappe les acteurs de la politique internationale d'aujourd'hui appelle une pesée anthropologique de la notion même de "chaos mental". Certes, vous avez observé plus haut qu'il s'agit d'une schizoïdie inconnue du monde antique; mais s'il est devenu difficile de savoir qui est fou et qui ne l'est pas, c'est précisément en raison de la dichotomie cérébrale dont souffre Sa Majesté, la démence en personne.
Vous connaissez l'expression : "Hurler avec les loups ". Qui sont les loups ? Les Anciens savaient qu'il fallait entendre les déments; et ils disaient: "Hurler avec les fous" : "cum insanientibus delirare". Mais les fous d'aujourd'hui délirent tantôt du bout des lèvres, tantôt à grands cris. Quand Tartuffe passe de la comédie à la tragédie, c'est qu'il a débarqué dans la politique et qu'il y est devenu criard en diable. Alors, Clio en appelle à un décryptage des dévotions et de leur tapage, parce que l'hypocrisie religieuse a passé du christianisme à la démocratie et qu'elle s'y révèle plus que jamais le moteur de l'histoire idéalisée à l'école de sa propre folie. Mais que s'agit-il maintenant de cacher aux dieux ? Précisément la frontière qui sépare la légitimité de l'illégitimité des Etats démocratiques au regard des Tartuffe de la Liberté et de la Justice. Et pourquoi cacher cette frontière aux habitants de l'Olympe ? Parce qu'elle se révèle désespérément flottante. Et pourquoi flotte-t-elle, cette impie ? Parce que, depuis l'origine du temps mémorisé, l'humanité flotte entre le culte d'un pouvoir représenté par une autorité publique musclée et une lucidité qui cloue l'ossature de l'Histoire sous son regard.
Mais pourquoi, demandez-vous maintenant à Erasme, les peuples fous flottent-ils entre leurs agenouillements devant un maître de leur corps et la peur de se trouver entraînés dans ses crimes ? C'est que cette oscillation psychique du singe vocalisé, c'est sa conscience qui la juge. Mais sur quelle balance pèserez-vous la magistrature du tribunal de la conscience? Comment spectrographierez-vous ce cœur parlant, comment analyserez-vous le mélange de vénération religieuse et de rejet moral qui rend si ambigu le saint génocidaire du Déluge, l'idole commune aux trois religions du Livre, l'idole qui se révèle le paradigme universel de l'histoire meurtrière de sa créature ?
13 - Une anthropologie de la folie
Décidément, Louis XIV avait raison de dire à Molière: "N'irritez pas les dévots", puisque l'anthropologie des carnages nous conduit à mettre en scène la démocratie des massacreurs dévots à Gaza. A quel acte de la pièce sommes-nous arrivés ? Certes, Orgon s'extasie toujours sottement devant son hôte, le pieux mangeur de chapons. Et nous, allons-nous le cacher sous la table et laisser Elvire démasquer l'imposteur ? Mais pour cela, il nous faudra tenter de percer les secrets de l'alliance de l'hypocrisie démocratique avec la folie la plus abyssale, celle dont nous n'avons relevé que quelques vestiges.
Décidément, nous sommes loin de la chute du rideau. Et pourtant, une ultime piste s'ouvre à l'anthropologie des égorgements, celle de nous demander pourquoi la civilisation chrétienne a changé les fous - insanientes - en loups et la fureur en hurlements. Car "hurler avec les loups", c'est seulement du mimétisme irréfléchi, ce qui ne ressortit qu'à la sottise, tandis que "furere cum insanientibus", c'est monter sur la nef des fous, c'est écrire l'histoire du monde à l'école des "fous furieux", comme on dit. Sous le conformisme intellectuel et doctrinal qui mobilise la piété des démocraties meurtrières et sous la bannière des idéalités pseudo sacrées qui enracinent les masses dans leur obéissance à des totems verbaux, une sauvagerie plus congénitale demeurerait-elle cachée au globe oculaire des évadés du règne animal, une sauvagerie qui nous renverrait à la bête furieuse dont le proverbe latin aurait conservé le souvenir ?
Voyez comme la victime a été cachée sous l'autel de la dévotion démocratique à Gaza, voyez comme la démocratie mondiale arbore le masque des Tartuffe de la politique moderne de la Liberté et de la Justice à Gaza, voyez comme Gaza elle-même est devenue tout entière un gigantesque offertoire, voyez comme la fureur d'Israël s'est tapie sous la sainte croix d'une civilisation confite en idéalités dévotes. Qu'est-ce que le sceptre qu'on appelle maintenant la Justice ? M. Sarkozy et M. Obama rachèteront-ils à bas prix la bête du sacrifice immolée à Gaza ? Ecoutez leur confession de foi, écoutez comme ils se la murmurent tellement du bout des lèvres qu'elle aidera l'immolateur des poulets du sacrifice à lancer quelques prières dans le vent.
Mais alors, ne commençons-nous pas d'apercevoir la cohérence anthropologique et toute la logique interne de la fureur des fous ? Ne voyons-nous pas se dessiner les deux pôles cérébraux entre lesquels la sainteté des démocraties se partage et qui les fait tomber dans le chaos ? Car, d'un côté, leur fureur et leur folie confondues les range en ordre de bataille autour du mur d'acier de Gaza, de l'autre, leurs prêtres lèvent les yeux au faux ciel de leur Liberté et de leur Justice ; et la dichotomie originelle dont leur encéphale subit les secousses nourrit leurs oscillations entre les floralies de leurs oraisons et le fer de leurs massacres. C'est pourquoi les Romains nous rappellent opportunément qu'on ne hurle pas avec les loups, mais qu'on porte la folie à la fureur et la fureur à la folie, et que ces acteurs alternés de l'histoire se comblent d'éloges l'un l'autre, comme il est démontré aux anthropologues sous la sarcastique apologie érasmienne de la démence.
14 – Conclusion
Décidément, l'anthropologie historique et philosophique se révèle indispensable à la pesée des relations que la politique de la démence entretient avec les autels du sacrifice ; car si l'on ignore quel ciseau grave le souvenir réel d'un événement dans le temps des fous et des sages et comment seule une éthique de la raison décide de la définition même de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas, comment préciserons-nous le statut d'une science de la mémoire oscillante entre le meurtre et la prière ? Et s'il appartient à la température des âmes de trancher de l'historicité proprement animale ou transanimale des évènements humains, demandons-nous quel thermomètre Zeus a consulté quand il a éjecté de l'histoire réelle du monde une France qui souhaitait la victoire de l'étranger sur elle-même et demandons-lui de prononcer un jugement solennel afin de chasser de France les "célébrissimes ministres de la folie du monde" qui ont osé demander au peuple de Descartes et de Montaigne de légitimer son propre déshonneur; et demandons au dieu Mars de tirer de son fourreau le glaive de la justice que nos cœurs appellent la France.
Le 18 janvier 2010
*
In cauda venenum
Visitant hier une bibliothèque publique, je suis tombée sur un titre alléchant :
Visages de la philosophie
par Denis Huisman et Louis Monier
Paris, 2000, Arléa, 180 pages, 13 €
Il s’agit d’un petit ouvrage de vulgarisation, dont l’ambition affichée est de constituer une sorte d’annuaire des philosophes francophones rencontrés par un photographe (L.Monier), chaque portrait étant accompagné d’un texte d’identification écrit par un spécialiste ès philosophes (D. Huisman).
Un examen rapide a tôt fait d’édifier le curieux, en l’occurence la curieuse : tous les charlatans s’y trouvent. Les pseudo-philosophes et vrais propagandistes de l’oligarchie aussi. Au milieu, bien sûr, des vrais, qui, surtout les morts, ne peuvent récuser aucune promiscuité.

Placer sur un plan d’égalité le vrai et le faux, au sens où l’entend Umberto Eco, n’est pas neutre. Quoi qu’il en soit, Manuel de Diéguez ne s’y trouve pas.. M. Monier ne l’a jamais rencontré. À l’heure où l’édition Gutenberg dans sa quasi totalité dépend du bon plaisir de quelques marchands d’armes, ne pas être jugé digne de figurer aux côtés des BHL, Glucksman, Finkielkraut, Bruckner, Revel et consorts est une distinction rare, une sorte de légion d’honneur « à rebours » ou pour-de-vrai-sans-Bonaparte.
M. Koffi Cadjehoun, qui, pourtant, mérite le détour, ne s’y trouve pas non plus. Cela n’est pas étonnant. Que je sache, il n’est pas officiellement philosophe et, en plus, il est noir. Ou du moins se dit-il africain, du Dahomey. Et si M. Monier l’avait rencontré, je doute qu’il se fût laissé photographier. Pas un seul petit portrait de lui sur Internet à l’heure de Facebook ne peut qu’être l’effet d’une volonté délibérée. M. Cadjehoun, qui préside à non moins de neuf blogs à lui tout seul pourrait donc être blanc et même du genre féminin, le précédent d’Ernestine Chasseboeuf donnant à réfléchir (on ne se méfie jamais assez des oulipiens : un jour, François Le Lionnais se fait accuser publiquement d’oeuvrer pour le KGB... vingt ans plus tard Harry Mathews écrit Ma vie dans la CIA...).
Ce qui me fait pencher vers une identité réellement africaine de Koffi Cadjehoun, c’est que sa prose est une véritable corne d’abondance, généreuse et prolifique à tous les points de vue, particularités devenues si rares dans notre Occident déclinant : qu’il s’exprime en philosophe, en moraliste, en politique ou en simple littérateur, la source paraît intarissable. Et que dire de l’énergie ! Qu’on me pardonne, mais en le lisant, me revient à la mémoire cette Toscane de la Renaissance (Catherine Sforza ?) assiégée dans sa ville par des gens qui avaient pris ses fils en otage et menaçaient de les mettre à mort si elle ne se rendait, qui, du haut du chemin de ronde, soulevant ses jupes jusqu’au menton leur criait : « Tuez-les si vous voulez, j’ai de quoi en refaire d’autres ! »
*

Personnification de l'abondance de l'Afrique sous les traits de la reine Cléopâtre
Coupe en argent 1er s. av. - 1er s. ap. J.-C. trouvée à Boscoréale
Si je parle aujourd'hui et sur ce post de Koffi Cadjehoun, c'est que non seulement il a fait le même choix que M. de Diéguez mais qu'en outre il le théorise. Comme ici par exemple :
Mercredi 9 décembre 2009
Externet
« Le système va changer ! Il faut que le système change ! Et il faut que les écrivains soient conscients qu'ils doivent changer ce système. C'est à eux de le faire. C'est pas les éditeurs qui vont le faire ! (...) Les lecteurs sont responsables pour une grande part de l'incompréhension de l'écrivain par la critique ! »
Marc-Édouard Nabe, Café littéraire, France 5, 13 avril 2009.
On interne quand Gutenberg?
On entend critiquer Internet. Qui critique? Toujours les mêmes. Des experts sentencieux et statisticiens qui vous entretiennent doctement des risques d'Internet, la pornographie, la pédophilie, la violence, la mauvaise liberté, les risques pour nos chères têtes blondes... D'où critiquent-ils? Quand le système critique, c'est qu'il entend récupérer la critique. Jugement à préciser (grandement) : le changement vient du centre, jamais des périphéries. Le centre du système n'est pas le centre de la mode du système, mais le centre de la mentalité - du système. Internet a été produit au départ par les militaires américains autour du Pentagone. C'est une arme stratégique de l'atlantisme qui aura produit l'innovation la plus frappante en matière d'expression depuis Gutenberg.
Communiquer a aujourd'hui un sens publicitaire assez péjoratif. Internet pourtant a niqué toutes les communications. Internet a tout niqué en fait, en premier lieu la pornographie qui sévit sur ses bornes passantes et à laquelle on aimerait tant réduire la Toile pour mieux la dénigrer et la déniaiser. Sûr : le spectacle fornicatoire est si répétitif qu'il provoque l'ennui et la pauvreté fantasmatique. L'art contre les dollars, c'est toujours l'art contre X. Internet est le nouveau lieu de l'expression, à commencer par l'artistique, qui est la plus haute forme d'expression humaine.
Dans cette conception, la forme religieuse est liée à l'art et lui est supérieure, mais c'est une forme qui se réclame d'une inspiration divine. La liberté classique est la liberté qui n'est ni finie, ni individuelle. La liberté classique contredit radicalement et vigoureusement la liberté d'obédience libérale. La liberté n'est jamais figée. La révolution Gutenberg a été radicale, puisqu'elle a propagé spécifiquement le processus protestant et qu'en fait elle a développé l'esprit bourgeois contre l'aristocratie qui sortit du fécond Moyen-Age et qui amorça l'esprit moderne.
Actuellement, les positions expertes émanent de cette mentalité bourgeoise, marchande, capitaliste, libérale, immanentiste. Le grave problème est qu'à l'époque de la révolution Gutenberg, l'impression papier et le système éditorial portent en eux le changement par rapport au système dominant tenu par les scribes au service de l'aristocratie chrétienne (pour utiliser une expression globale et fédératrice). Le papier cotre le parchemin; les éditeurs contre les moines copieurs.
Le changement est du côté de Gutenberg. L'individualisation de l'expression porte en elle le changement au départ, au moment de Gutenberg. La prise de pouvoir de cette conception est politico-artistique et se fait dans le cadre des Lumières et des Révolutions démocratiques. Au dix-neuvième siècle chrétien, cette conception se trouve institutionnalisée. Gutenberg porte le gage de la démocratisation de l'expression et du savoir. Par la suite, avec le vingtième siècle, cette conception se sclérose, spécialement après la Seconde guerre mondiale.
Un signe qui ne trompe pas vient de la faillite de la qualité : les éditeurs si influents (l'inverse du Gutenberg initial) sortent de plus en plus d'écrivains, ils progressent quantitativement, au point qu'ils remplacent la qualité par la quantité. Leur objectif devient mercantile, alors qu'il coule de source que la quantité est une fin immanentiste qui nuit gravement à la fin artistique. Il est vrai que les artistes sous le système Gutenberg remplacent les prêtres, ainsi que l'entend un Nietzsche.
C'est quand le système devient purulent et en voie de décomposition qu'il atteint la plénitude de sa puissance finie. Cas de l'Occident d'après la Seconde guerre mondiale. Dans ce système, on célèbre des écrivains moyens comme des génies (Camus, Sartre, Aron, Duras, Yourcenar...) et de décennies en décennies le niveau baisse. La nausée est atteinte avec l'avènement d'écrivains emblématiques comme les BHL ou Modiano. Et puis au nom de l'individualisme foisonnant on oublie les écrivains, leur nom, leur production. L'important devient d'éditer. Les éditeurs deviennent écrivains. Cas d'un Enthoven père, dont le fils empire la prose de la saga familiale; cas d'un Roberts, d'un Millet et d'autres impérissables cooptés du même style. Le plus charismatique de cette génération est l'insupportable, narcissique et oligarchique Sollers, qui réussit à aimer Nietzsche et le christianisme, Venise et la démocratie, Balladur et le socialisme.
Il est vrai que Sollers a une mentalité impérialiste qu'il a héritée de sa jeunesse bordelaise et néo-anglaise. Il n'est pas possible d'envisager que ce type d'écrivains figés et conformistes puissent changer quoi que ce soit. Ce qu'ils conçoivent comme principe du changement est la subversion, au point de louer les délires érotico-stylistiques d'un Sade. Selon eux, le changement passe par l'extrémisation de l'individu, au point de prôner les formes les plus radicales et poussées de l'individu-fondement.
Ces rebelles sont les suppôts du système qu'ils combattent mollement, entre nombrilisme sentencieux, libertarisme libertin, anarchisme de droite et dépolitisation germanopratine. Il n'est pas sérieux d'attendre d'un milieu conservateur, récupéré et statique, qu'il change quoi que ce soit. La critique qui surgit contre Internet pose problème en ce que c'est un grand corps malade et gangrené qui attaque le corps jeune et vigoureux de celui qu'il pressent comme son successeur inéluctable. De ce point de vue, les critiques de la mentalité Gutenberg contre Internet respirent le pathétique.
Les journalistes sont les emblèmes de ce système en ce qu'ils se réfugient dans le factuel et l'objectif pour ne rien dire, rien écrire, rien penser. Les journalistes sont les thuriféraires du système, les élitistes mimétiques et proclamés de Gutenberg. Les journaux dominants et officiels sont l'incarnation de la révolution Gutenberg. Les médias officiels expriment la mentalité officielle. Qu'est-ce qu'un médium? Ce n'est pas un hasard si la révolution Internet affecte en premier lieu les subsides des médias officiels.
Ils souffrent en tant que premier rang du bataillon Gutenberg. Mais il n'est pas raisonnable d’attendre que Gutenberg sécrète sa propre évolution. Le milieu Gutenberg est devenu le milieu de l'édition. On se coopte, on se choisit, on s'élit. C'est la démocratie journalistique et artistique. L'art a pour fonction de relier entre elles les idées idéologiques. L'art est devenu la caisse de résonance du système immanentiste. L'art abstrait, l'art contemporain manifestent cette propension désartique en ce que l'art dépouille ses formes d'expression pour ne porter que l'idée exsangue et désincarnée. Pour porter l'idée, rien de tel qu'une mauvaise idée. Déportez, vous n'êtes mêmes plus porteurs.
Qui vous écoute? Les bobos? Les babas? Les gogos? Les gagas. Chacun sait que le changement est nécessaire et que le changement est arrivé. Il est né, le divin changement. Bonne nouvelle : Internet. Mauvaise nouvelle : enterrer Gutenberg. Va nous enterrer? En attendant que le milieu Internet connaisse le même sort que toute forme qui s'institutionnalise, remarquons qu'Internet a plus de marge que Gutenberg.
Internet sécrète une marge de manœuvre supérieure à Gutenberg. Gutenberg permettait un choix imposé, quand Internet change les conditions du choix. On peut mal choisir, mais on a désormais le choix de choisir. Laissez choir Gutenberg ! Courez les expos et les vernissages, bande de petits vernis au venin rance et sec ! C'est terminé, vous êtes dépassés. Sollers au ton chuintant a des accents de vieille rombière sur la veille. Dire que ce jouvenceau maoïste est devenu un cireux ultra-libéral en dit long sur sa décrépitude d'éditeur qui joue les écrivains de premier plan. Les écrits vains, sans aucun doute.
Dire que les éditeurs sont au centre de l'expression est symptomatique d'une dérive oligarchique, soit d'une appropriation par les classes possédantes de la création. Quand les maîtres s'emparent de la création, le changement opère une farandole ironique en décentrant les conditions d'expression. Gutenberg était faisandé, sclérosé, récupéré ? Changez ! Le changement est venu du cœur du système immanentiste, de ces militaires qui lancent des innovations au service de la guerre. La polémique : guerre du style au service d'Internet. Interner le consensus et le compromis.
Résultat des courses : c'est le système qui s'enterre lui-même en voulant propager les conditions de son renouvellement et de sa pérennité. Réflexion sur le changement : le changement est dans l'ironie. Également dans la diminution. Certainement pas dans la synthèse surmontée. Démontez la synthèse ! Mot d'ordre contre les maux du désordre. Hegel est un piètre changeur. Hegel donne le change au système immanentiste en introduisant sa pincée de transcendantalisme et en ménageant grâce à ce compromis honteux la chèvre et le chou. Hegel est la chèvre - le système ?
Levez le bouc émissaire : le changement est ironique en ce que le changement est la diminution de l'antithèse. On est loin de la synthèse. On synthétise son Hegel et pendant ce temps on perd son temps. On répète, on pète, c'est saoulant. Chez Clément Rosset l'immannentiste terminal qui personnifie jusqu'à la nausée sartrienne la mentalité oligarchique et dominatrice d'obédience grande bourgeoisie cernée entre la rue d'Ulm et la Sorbonne décriée (c'est tendance d'être dans le système qu'on attaque), le changement n'existe pas vraiment.
Selon Rosset, le matérialisme ne saurait être révolutionnaire au motif que le changement fait partie du réel et que rien ne fait relief dans le champ du réel. Le changement est relégué aux calendes grecques et aux oubliettes de l'ontologie, précisément ce que Rosset reproche à la métaphysique classique concernant ses thèmes de prédilection - le hasard ou le tragique. Le système se détruit de l'intérieur et se détruit dans ce qu'il estime être son apogée et son essence.
Du coup, le changement vient de l'extérieur pour remplacer la destruction tout à fait interne. C'est ainsi que la destruction de Gutenberg vient du Pentagone - comme la destruction du 911 (avec le centre symbolique des affaires de New York il est vrai) ? Les comploteurs du 911 n'ont pas compris qu'ils détruisaient leur beau joujou - comme les militaires du Pentagone n'ont pas compris qu'ils fracassaient leur Gutenberg avec Internet.
Contre la sclérose qui dose, le changement ose. Le changement d'Internet, c'est l'interactivité et le côté insaisissable. Incontrôlable et irrécupérable. Les médias traditionnels sont dépassés. Prenez le cas d'école Rue 89, un média français lancé par des sbires immanentistes de Libération, l'ancien quotidien libertaire repris par le banquier ultra-libéral Rothschild. Rue 89 essaye de se montrer plus osé pour donner le change, mais sa récupération s'est déjà fracassée contre l'incroyable vitalité et diversité des blogs. Pour récupérer Internet façon Gutenberg, il faudrait détruire Internet. Couper Internet. Aller contre l'histoire. Franchir le mur du son.
Ce qui va détruire le système immanentiste, c'est Internet. Vive le Pentagone ! Gutenberg aura été une courroie de transmission vers Internet. C'était bien, Gutenberg, mais ça patine. Ça rame. Ça atteint ses limites. Ça décroît pour les meilleures raisons du monde. Le changement est au cœur du système au sens où la destruction est au cœur du système. Le changement est à l'extérieur du système au sens où le changement est au centre du système. Le changement est inscrit dans l'excellence d'un système. C'est un principe de vie et il serait naïf de croire que la vie est maintenue dans les limbes de l'individuel.
Souvent, on entend dire avec raison qu'Internet dépasse tous les sens que les analystes peuvent lui conférer. Évidemment, on a beau jeu de constater que les pires productions d'Internet émanent de la récupération par le système Gutenberg : la pornographie n'est pas le propre d'Internet, mais de l'époque immanentiste qui est pornographique de A à X. Dans les années soixante-dix, on pouvait encore miser sur le côté subversif de la pornographie. On s'est rendu compte que l'on s'était trompé de cheval depuis. Faire aujourd'hui de la subversion, c'est miser sur un bourrin perclus de rhumatismes. Un vieux canasson décati.
Notre subversion a des relents de perversion dépassés et infects. Au lieu de confondre la récupération d'Internet par Gutenberg avec l'originalité d'Internet, revenons au changement révolutionnaire qu'induit Internet. Selon Marx, la révolution exprime le changement de paradigme dans lequel les élites sont renversées par leur immobilisme. Le problème de cette définition tient dans le matérialisme de Marx qui fige le changement, en particulier les révolutions. La révolution est une profonde évolution qui a pour principe final d'amener la croissance.
Marx ne croit pas dans la croissance car il décroît. Déjà. Si le changement est dans la croissance, il est curieux d'estimer que le changement profond échappe au sens. Wittgenstein pensait que le langage n'est pas explicable. Internet serait-il supérieur aux mots de son temps ? Il est vrai qu'Internet est d'ores et déjà au-dessus des maux qu'on veut lui faire porter, comme un chapeau ravalé et effrayant.
En réalité, l'opération critique d'Internet par les supports Gutenberg consiste à tenter de révoquer le cauchemar Internet, de l'assimiler et de le réduire à Gutenberg. Qu'a donc Internet que Gutenberg n'aurait pas ? Formellement et factuellement, l'étendue de l'insaisissabilité. Quand on contrôle Gutenberg en contrôlant les supports, les supports sont devenus avec Internet incontrôlables. On contrôle encore les bornes passantes, mais pratiquement on dépasse les bornes. Le mythe Internet vient de ce qu'il est impossible pour un individu de contrôler l'ensemble de la Toile. Internet est déjà un monstre mythologique qui a échappé au pouvoir de ses géniteurs humains.
Frankenstein était sympa, Internet encore plus. On interne quand Gutenberg ? On peste après la virtualité d'Internet et il est certain que toutes les virtualités ne sont pas des vertus. Mais la vertu fondamentale est dans la virtualité au sens où l'actualisation de la puissance passe par la virtualité. Leibniz à la suite de Platon professait la virtualité dynamique, et c'est fort de cette appellation calibrée que nous allons étudier ce qu'est la dynamique appliquée à l'étude des phénomènes : la dynamique, c'est le changement et plus précisément, c'est la prévision des changements.
Quand on étudie de manière dynamique un phénomène, on le calcule en fonction de divers instants qui ne désignent jamais l'intégralité des instants de ce phénomène, mais une suite non négligeable. Dans cette suite non linéaire, la dynamique consiste à rappeler que la compréhension d'un phénomène réside dans son extension temporelle - non dans sa fixité donnée et finie.
Ce qui compte, c'est l'infini - et l'infini se mesure par la notion de processus opposée à la notion de donné, notamment popularisée par Rosset dans un essai de jeunesse (Le Monde et ses remèdes). Décréter que l'événement est fini est une erreur. C'est dans une conception finie et fixe du réel, où le donné l'est une bonne fois pour toutes, que l'on peut énoncer qu'un événement dépasse la compréhension qu'on en a. A vrai dire, on est toujours dépassé par la compréhension d'un événement, surtout quand cet événement est complexe et diffus.
Tout événement considéré comme processus dynamique dépasse toujours le sens puisque le sens s'attache à finitudiser l'événement. Quand on relie ce raisonnement à Internet, on comprend qu'Internet dépasse nécessairement la production des sens singuliers. Internet est une production qui est du ressort de ce que les classiques nommeraient de la dynamique. Dynamique virtuelle correspond d'autant mieux à la situation que le concept de dynamique renvoie à la puissance et à la potentialité, de même que le virtuel, qui est la vertu en tant qu'actualisation de la puissance.
La dynamique du virtuel est d'autant plus redondante que si l'on y réfléchit, c'est par le recours au virtuel que la puissance advient. Il n'est de dynamique en fin de compte que virtuelle. C'est par le recours au virtuel que l'homme peut donner cours aux abstractions et à l'imaginaire. En fait, Internet n'est que l'incarnation technologique de la virtualité qui courait dans l'air du temps depuis que l'homme est doté de conscience. Dès que l'on entend des récriminations contre Internet au motif que le virtuel serait symptôme de déréalisation, on oublie que l'on ne comprend le réel qu'avec du virtuel, qu'il n'est pas d'action sans virtuel et que les idées décrites par Platon ne sont pas des abstractions dénuées de réalité.
A vrai dire, si l'on réfléchit à la portée du virtuel, on découvre que sans virtuel, il n'est pas de contact avec le réel. A la limite, on pourrait fustiger une certaine déréalisation dans le passage à une virtualité artificielle, quoiqu'il faille sur ce point se montrer des plus méfiants. Après tout, comme l'enseigne un adage populaire, ce sont les idées qui changent le monde, conception classique selon laquelle sans le recours aux idées et au monde virtuel, l'homme n'a pas accès au changement ni à la fameuse pratique d'obédience politique.
C'est un argument simpliste que de stigmatiser le virtuel en l'opposant à l'action et à la politique Le plus sûr moyen d'agir, surtout en politique où les idées sont primordiales, c'est de recourir au virtuel. Sans virtuel, pas d'action. La richesse du virtuel, qui fonde la spécificité humaine, vient du fait que le virtuel possède une faculté d'influence et de changement sur l'action hors de l'action, dans sa démarche propre.
L'énoncé selon lequel Internet dépasse le sens est assez prévisible. Si l'on veut signifier qu'il est dynamique, c'est un fait établi; si l'on veut signaler l'incroyable foisonnement d'Internet, la vraie question consiste à se demander si l'on peut définir la démarche d'Internet, qui constitue son aspect révolutionnaire et avant-gardiste. Wittgenstein rappelle que l'on parle le langage sans le définir. Le langage dépasse le sens au sens où il est le sens et que définir un donné de l'intérieur est impossible.
La spécificité de toute production humaine qui dure est de s'inscrire dans un processus dynamique qui dépasse le sens défini. La constatation de Wittgenstein est un brin inutile. Surtout elle est dangereuse si elle introduit un élément d'irrationnel selon lequel les nombreux éléments incompréhensibles nous conduisent à considérer que le réel est indéfinissable et échappe à l'esprit humain.
Dans cette conception, la connaissance humaine est fatalement décalée - quasi impossible. L'homme perdu dans le réel ne peut s'en remettre qu'à ses sens comme au moins incertain. Il est conduit à accepter le mystère et à s'en tenir à des valeurs empiristes et utilitaristes qui le conduisent vers l'abime nihiliste. C'est le péril de la connaissance impossible qui appliqué à Internet donne des résultats dévastateurs. Si l'on considère que cette impossibilité est démentie par l'histoire et que la connaissance ne cesse de prospérer au fil des tâtonnements, Internet redevient définissable en tant que tout processus est définissable.
Le processus dynamique n'est définissable qu'en limitant la faculté de définition à ce qui change. In change we feed. Internet est ce qui correspond au plus près à l'inverse exact de ce qu'on nomme communication dans le jargon branché des publicitaires électriques, soit à la conception la plus radicale et réductrice du langage humain dans la norme immanentiste. Selon cette norme, la communication est un donné définissable et préexistant du langage - quand selon Platon, le langage est processus dynamique en ce qu'il réside dans le dialogue.
Le dialogue ne contient pas à l'avance son résultat. Ce résultat s'obtient par la dynamique du dialogue, ce qui indique que le possible n'est jamais donné à l'avance et que ce qu'on nomme liberté tenait dans la conception selon laquelle le possible n'existe pas à l'avance, n'est pas donné nécessairement. La richesse d'un événement tient au fait qu'il n'est pas réductible à un donné, soit qu'il peut changer. C'est ce qu'on appelle la liberté et c'est ce qui s'applique si bien à Internet.
Considérons Internet comme une projection du langage dans le monde technique. Internet fait mentir Heidegger selon lequel la technique est dénuée d'Être. En considérant la technique que de manière finie, Heidegger voit le problème du mécanisme et du matérialisme, il approche de l'immanentisme, mais il n'est pas capable de définir l'Être comme processus dynamique et comme connexion virtuelle. Heidegger est un lecteur d'Aristote, pas de Platon et de Leibniz. C'est surprenant pour cet érudit, mais c'est prévisible quand on se rappelle que la création ne sort quasiment pas de l'érudition.
Liberté et changement sont ainsi dynamiques. Mais la dynamique n'est pas définie. Le virtuel consiste à considérer que le réel est formé de possibles qui n'existent pas à l'avance mais que nous actualisons en fonction de nos possibilités. Le possible est le passage de la multiplicité des virtuels vers l'unicité du sensible. De ce point de vue, le réel est multiple si on ne le réduit pas au sensible. La notion de nécessité ontologique est dépourvue de sens. Spinoza et Nietzsche sont disqualifiés comme des ontologues simplistes et dangereux.
Le virtuel est la faculté par laquelle l'homme passe pour actualiser les possibles qui s'offre à lui. Le virtuel est puissance en ce qu'il est les différents possibles qui s'offrent à l'homme. Le virtuel est le réel. Le changement passe par le virtuel. L'opération dialogique dans Internet indique contre la communication qu'Internet est du côté de la dynamique. Le virtuel aussi. Maintenant, les transcendantalistes parviennent à dire que la dynamique est dans le processus dialogique, mais ils n'arrivent pas à dire pourquoi.
Il va sans dire qu'Internet est de ce côté et que c'est pour cette raison qu'il est aussi inépuisable. Internet restaure la forme du dialogue socratique quand Gutenberg en était venu à un pesant monologue contrôlé et prévisible. Poussif et massif. Le changement s'explique par le processus néanthéiste qui remplace le prolongement transcendantaliste. http://aunomduneant.blogspot.com/
Dans cette optique, ce que Hegel considère que l'action de surmonter et de dépasser, Aufhebung, ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Platon s'en tient à la méthode dynamique du dialogue sans préciser d'où vient l'énergie de la liberté. Le mécanisme de la virtualisation n'est jamais subsumé. Hegel croit dépasser Platon avec son schéma ternaire, mais c'est surtout sa conception statique et prévisible du changement qui interpelle. Nous nous situons dans un schéma donné à jamais.
On ne dépasse que dans une mentalité où l'on prend ce qui est donné dans la thèse et ce qui est nié dans l'antithèse. Le néant se trouve inscrit dans le donné. L'action de dépasser ou de surmonter indique que l'on est dans un schéma proche du marxisme, selon lequel l'étape finale du communisme est inscrite dès les limbes et s'inscrit dans un schéma donné qui contient quatre étapes (esclavage, féodalisme, capitalisme, communisme). On retrouve la nécessité de la domination dans une conception du réel qui est finie.
Dans un fini défini, la domination se manifeste par le dépassement de la synthèse. L'action de dépasser n'est concevable que dans un schéma ontologique fini. En même temps, ce schéma contient son paradoxe, car le fait de surmonter à l'intérieur d'un schéma donné n'est pas rationnel et logique. Soit l'on dépasse et l'on passe à un autre schéma - auquel cas la théorie hégélienne est fausse; soit l'on reste dans le schéma - et il apparaît peu plausible de dépasser le stade de l'opposition.
C'est d'ailleurs la position idéologique et pragmatique la plus usitée dans l'atlantisme de type idéologico-libéral, si l'on se souvient de l'adage ordo ab chao, qui se contente d'observer prudemment que les changement surviennent grâce à la violence de l'opposition au premier rang de la guerre. Au passage, dans une conception de ce style, il est cruel et logique d'instaurer un coup d'État comme le 911, qui libère l'espace du changement (la guerre contre le terrorisme et le Nouvel Ordre Mondial remplaçant les États-nations post-Westphalie).
La proximité de Hegel le pseudo-idéaliste de type métaphysique avec la doctrine matérialiste de Marx indique que la conception métaphysique de Hegel est une tentative de réconciliation et de synthèse entre la métaphysique classique et les positions matérialistes contemporaines (dont Marx est un rejet à peine postérieur). Si Marx réduit Hegel à un renversement simple et définitif, leur parenté indique en fait que Hegel est un immanentiste qui tente de concilier l'immanentisme et le transcendantalisme.
Comme les deux pratiques sont incompatibles, il arrive surtout à inscrire le transcendantalisme dans l'immanentisme, ce qui n'a pas de sens, défigure le transcendantalisme et contribue à asseoir l'immanentisme. Au lieu de pinailler sur les différences (évidentes) entre Hegel et Marx, il importe de comprendre que le lien entre ces penseurs est plus fort que les divergences. Dans un schéma néanthéiste, nous sommes en mesure d'expliquer la vacance sémantique transcendantaliste.
C'est que le prolongement ne peut que déboucher sur l'erreur bigarrée de Hegel. Quand on prolonge, l'on commence par suspendre l'expression du schéma, l'on finit par surmonter - expliciter le schéma. Hegel ne fait qu'expliciter l'erreur en germe dans le prolongement transcendantaliste. Il apparaît invraisemblable que ce soit l'opération inverse au prolongement qui soit l'adéquate. Et pourtant. C'est en considérant que le changement est diminution ou régression que l'on comprend pourquoi le changement résiste aux opérations courantes de sens et de compréhension.
En quoi aussi le changement résiste à la définition définitive. Diminution/régression n'est pas réduction. La réduction exprime la diminution dans un schéma fini, quand la diminution véritable s'exprime dans un schéma infini où l'enversion succède au prolongement. C'est toute la conception du prolongement qui est à revoir car elle implique que seule l'augmentation soit possible, quand de fait, c'est l'inverse qui se produit.
Dans le schéma de l'enversion, il faut diminuer pour contacter la partie du réel qui n'est pas le sensible. Dans le schéma transcendantaliste, cette partie majoritaire et mystérieuse correspond à l'Être. L'Être est perfection idéale, quand le sensible est la forme dégénérée du grand Tout complet. Cette conception souffre d'une dimension inaccessible et incompréhensible à partir du moment où l'on ne parvient jamais à contacter ce qui est parfait parce qu'au-dessus (qualitativement).
Dans une optique où la réel manquant n'est pas au-dessus, mais en dessous, la lacune s'explique et le sens se rétablit. Le changement devient l'opération de la diminution. Si l'on ne parvient pas à envisager tous les possibles, c'est parce que la création est diminution. Le langage est l'opération qui indique que l'homme pioche dans le rapport d'enversion et qu'il diminue pour effectuer cette opération à la fois simple et aveuglante.
Si l'on ne parvient à expliquer pourquoi Internet est inexplicable, c'est qu'on cherche à surmonter quand il faudrait diminuer. L'inexplicable cache certes la profondeur du changement et permet d'instituer la passerelle du sens, mais avec le rapport d'enversion diminutive, l'on peut expliquer ce qui était jusqu'alors inexplicable. Si Internet résiste aux tentatives d'explication générale, de sens, de prévision, c'est parce qu'il n'augmente pas, mais qu'il - diminue.
On constate notamment que les efforts de récupération d'Internet par Gutenberg ne fonctionnent pas. Dans une conception statique, seule l'augmentation est concevable. on essaye d'empêcher Internet d'augmenter. Internet croît parce que la croissance n'est pas dans l'augmentation. Elle réside dans la diminution. Les interconnexions et les myriades démultipliées de dialogues virtuels indiquent ce qu'est le virtuel Internet : une actualisation de la puissance énergétique dans le paradigme technique.
Le dialogue de type socratique qui s'est accru dans le dialogue Internet (dialogue à définir) se définit comme la possibilité de croissance à partir de l'enversion diminutive. De ce point de vue, Internet n'est que la technologisation du processus du langage, selon lequel on utilise le langage comme mode d'expression de l'enversion. Le langage exprime l'opération de conscience (savoir que l'on sait) parce que ce que nous nommons conscience est le rapport d'enversion et de reflet indéfini.
Reste à décrypter pourquoi l'on ne parviendrait jamais à saisir le sens profond d'une manifestation complexe comme le langage - ou Internet. La réponse coule de source : c'est parce qu'on devrait l'appréhender de manière externe et qu'il est impossible d'appréhender le Tout ou la forme complète. C'est une explication transcendantaliste qui souffre d'un problème explicatif : s'il est impossible de signifier le Tout, alors le sens partiel souffre d'un défaut de liaison sur lequel il s'appuie pourtant. On nous explique que le sens est fondé à partir de son lien cosmique et mystique avec le Tout.
Si tel est le cas, le tout est le prolongement sémantique de la partie - ou il n'est pas. Qu'il soit le prolongement ne parvient à expliquer la carence du sens. Il est en diminuant car ce qui n'est pas est diminution par rapport à ce qui est. Internet signale que la vertu du virtuel est de rappeler que la puissance s'obtient dans la diminution. Si l'on ne peut cerner ni le langage, ni Internet, c'est parce que c'est la même opération qui consiste à interdire la non-fluctuation.
Dans un réel mouvant, il est plus malaisé de rappeler que le changement passe par la diminution. Si l'on ne parvient à signifier chaque partie du réel, c'est que son aspect manquant mène vers le rapport d'enversion et vers la diminution. Dans cette logique, Internet n'est pas autre chose que la transposition du langage vers le virtuel technicisé. Dans cette optique, Internet n'est rien moins que l'ensemble du sens. Dans la logique néanthéiste, l'ensemble du réel devient accessible par l'opération du reflet et de l'enversion.
L'infini est le reflet indéfini. Comprendre l'infini, c'est passer par la diminution. Comprendre Internet, c'est comprendre que le caractère insaisissable d'Internet réside dans cette possibilité de diminution qui est infinie et qui ne peut que déjouer les tentatives de contrôle. Dans ce combat explicite, où par des lois sans cesse perfectionnées l'industrie Gutenberg essaye de figer une bonne fois pour toutes l'expression créative à un stade figé de mercantilisme, nous tenons l'affrontement de deux conceptions du réel : l'une figée et statique, l'autre dynamique et mouvante.
Ce n'est pas l'affrontement de l'immanentisme novateur contre le transcendantalisme dépassé. Gutenberg contre le papyrus. C'est l'affrontement de Gutenberg dépassé contre Internet révolutionnaire. Dans ce jeu de rôles, la dupe est Gutenberg. L'issue du combat est certaine : le réel l'emporte toujours sur les aspirations démesurées de ses parties, mêmes humaines. C'est la préfiguration qui attend tous ceux qui parient sur le prévisible et le certain au motif qu'ils coïncident avec le fini. Place au néanthéisme; mort à l'immanentisme. Place à Internet. Mort à Gutenberg.
Publié par Koffi Cadjehoun à l'adresse 04:17 0 commentaires.
***
Réflexion suivie, le 14 janvier, sur son même blog http://aucoursdureel.blogspot.com/, d'une précision complémentaire :
jeudi 14 janvier 2010
Nababcodinosaure
Il faut être bien dans le système pour condamner le système tout en reprenant les valeurs du système.
Seul ce qui est gratuit est profond.
J'aime bien Nabe parce qu'il a écrit le Vingt-septième livre, qu'il a une bonne plume, qu'il aime Oum Kalsoum et qu'il défend les Palestiniens. Est-ce que j'aime tout Nabe? Voyons, voyons... Pas si sûr. Pas si grave. Après tout, la critique rend dynamique. Nabe veut sortir de la norme pour être au-dessus de la norme? Du moment que la norme (bourgeoise) est sauvegardée... Du coup, Nabe ne veut pas changer de norme, mais préserver la norme pour mieux la dépasser, dans un schéma hégélien très nihiliste. Nabe est rebelle dans la mesure où le rebelle est la figure du minoritaire supérieur. Le minoritaire supérieur a besoin de la majorité des ploucs pour dépasser la norme instituée. Nabe fait son commerce littéraire du dépassement de la norme en ce qu'il ne veut surtout pas changer cette norme et qu'il la renforce sous prétexte de la contester.
Deux exemples de cette anarchie très systémique :
1) sa détestation revendiquée des conspirationnistes, qui le rapproche de Taguieff et qui montre qu'il est prêt à critiquer le système en s'installant contre le système - surtout pas en adoptant la position qui appelle à changer le système. Nabe est pour les musulmans, pour les Irakiens, pour les Palestiniens, pour Oussama, pour tout ce qui est contre le système occidental dominant, à condition de provoquer sans la changer la norme bourgeoise occidentale. Nabe serait véritablement en faveur du changement (de la vraie rébellion) s'il osait lancer avec sa virulence talentueuse que le 911 est un complot systémique ourdi par le cœur du système impérialiste occidental. Arme fatale? Pourquoi Nabe ne peut-il endurer cette vérité criante d'anticomplotisme et gorgée d'un complot crevard et suicidaire? Nabe ne perdrait pas son temps à critiquer le complotisme, qui n'est jamais que la maladie dérivée des complots véritables et vérifiables - et qui sous la plume de propagandistes retors comme Taguieff permet d'amalgamer les complots authentiques avec les théories du complot paranoïaques.
2) sa révolution surévaluée de l'auto-édition avec sa plate-forme littéraire de format Internet. Nabe a la haine contre le milieu littéraire parisianiste qui l'a exclu. Exclusion assez relative, puisque Nabe continue de vendre ses toiles à des stars du système médiatique et qu'il continue à être invité sur les plateaux médiatiques par des figures médiatiques comme son ami Taddeï. On a déjà contemplé exclusion plus radicale. Nabe est-il l'exclu du système? Non, Nabe est l'un des exclus du système médiatique, à condition de comprendre que le système médiatique est le mirage aux alouettes du système politique et que le petit monde des médias a besoin de figures d'exclus. Le compère Soral joue une autre partition, lui encore plus en colère contre le système - à condition que le système désigne le seul système médiatique dont il a été banni? Nabe devrait se trouver honoré par cette exclusion, tant un écrivain qui est détesté par Savigneau ou Beigbeder ne saurait être foncièrement mauvais.
Ne reste plus à Nabe qu'à démasquer l'imposture Sollers et la boucle sera bouclée. Encore que. Il me revient à l'esprit que Nabe a envoyé au diariste Matzneff, précurseur de l'auto-fiction, écrivain sous-gidien à tendance pédophile-érotomane (voire mensongère), un petit mot de remerciement admiratif. Nabe ferait mieux de s'en prendre à un écrivain authentique et mineur comme Matzneff qu'à des éditeurs-écrivains ou à des hommes de lettres. Nabe a conçu son système d'auto-édition comme système d'anti-édition : contre la république des lettres et contre le système édiroial de Gutenberg. Il a racheté ses droits d'auteur et il vend à des prix peu modiques ses anciens ouvrages. Mieux : il publie sur ce format d'auto-édition Gutenberg son nouveau roman moyennant un prix assez élevé. Nabe note qu'avec ce système, il devient écrivain-éditeur, ce qui lui permet d'empocher des marges plus importantes (environ 70%) et de devenir le véritable gérant/garant de son œuvre.
Même si on comprend sa réaction outragée, vu la liste interminable des édités du petit milieu Gutenberg qui ne lui arrivent pas à la cheville, les médiocres primés et autres perroquets désavants, on reliera l'incompréhension par Nabe de ce que représente le phénomène Internet avec le contresens que Nabe entretient au sujet du 911. Il faut être bien dans le système pour condamner le système tout en reprenant les valeurs du système. Il faut être bien dans le système pour croire que des musulmans révoltés par l'Occident ont commis le 911. L'Islam n'est pas le terreau du terrorisme. Il faut être bien dans le système pour sortir de l'édition parisianiste tout en important avec importance les valeurs marchandes du système Gutenberg sur un site Internet.
Si Nabe voulait vraiment écrire par amour de la littérature, il publierait ses œuvres pour rien, gratuitement, parce que seul ce qui est gratuit est profond. Il demanderait peut-être un petit quelque chose, une contribution, un don, une obole, au sens où le don dépasse le caractère fini de la somme d'argent. Nabe se meut-il dans l'infini, dans la littérature, dans l'art? Qu'il lâche les dollars! Qu'il revienne à l'art! Qu'il intègre l'ère de l'art! Qu'il se place au niveau de la révolution de son époque! Qu'il externe Internet! Allah est dans Internet! L'or de l'art est dans Internet! L'infini est dans Internet. Pas Sollers. Pas Oussama. Pas Nabe?
Publié par Koffi Cadjehoun à l'adresse 22:32 4 commentaires
***
Si j'étais M.-E. Nabe, je prendrais très au sérieux ce diable de M. Cadjehoun, et je le méditerais bien à fond, entre deux placardages de dazibaos de mes oeuvres sur les murs de Saint-Germain des Prés. C'est pour le coup que je ferais la preuve de mon intelligence !
Sans compter que les accents céliniens les moins indignes du Voyage et de Mort à crédit qu'ait réussi à produire notre temps post-tout-ce-qu'on-veut, c'est chez lui qu'on les trouve. Qu'on aille voir si je mens ou si je m'abuse sur son autre blog http://chroniquesdeleurafrique.blogspot.com/ la pièce dédiée à Silvia Cattori (12 décembre 2009) ou celle intitulée Le temps des fleurs (22 novembre 2009), entre tant d'autres.
Catherine L.

12:19 Écrit par Theroigne dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, palestine, portugal, philosophie, boulanger, dolet, titanic, folie, rabelais, cleopatre, erasme, gaza, principaute de liege | ![]() Facebook |
Facebook |